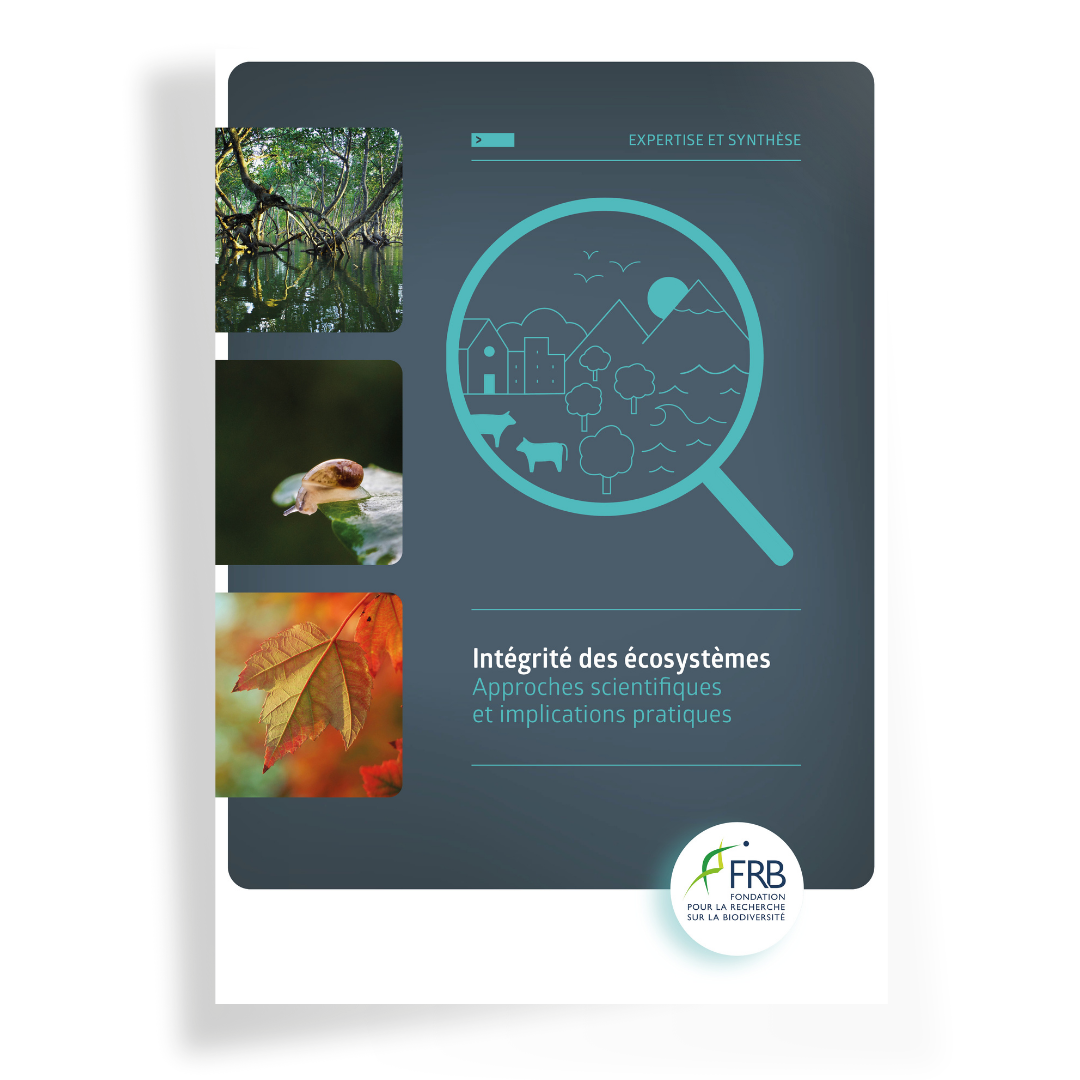Bien que l’augmentation de la capacité éolienne soit cruciale pour atténuer le changement climatique, ses effets potentiels sur la biodiversité nécessitent des ajustements pour que la perte de biodiversité n’aggrave pas le changement climatique ou ne dégrade pas sur la production alimentaire ou la santé humaine. Il a en effet été estimé que plus de 11 millions d’hectares de terres naturelles sur la planète pourraient être perdus à cause des énergies éolienne et solaire, ce qui aurait un impact sur plus de 3,1 millions d’hectares de zones clés pour la biodiversité et sur plus de 1 500 espèces d’animaux vertébrés menacées, en particulier dans les zones tropicales.
La perte d’habitats causée par le défrichement d’espaces boisés lors de la phase de construction a des effets négatifs sur les espèces animales forestières. Au cours de la phase d’exploitation, les principales perturbations des éoliennes sont dûes au mouvement du rotor, au bruit, aux vibrations, aux lumières vacillantes et à une présence humaine accrue. Ces perturbations entraînent, chez de nombreuses espèces animales, décès ou changements de comportement tels que l’évitement et la modification des trajectoires de vol, en particulier chez les espèces migratrices.