Le suivi de la biodiversité en France : un système en structuration


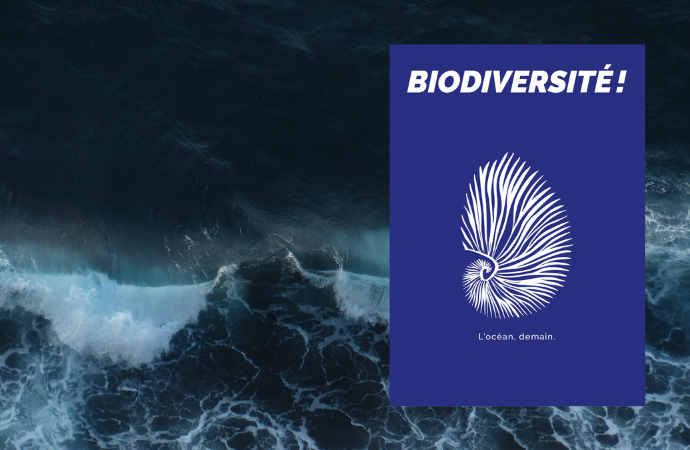
La revue Biodiversité ! poursuit son exploration des liens entre l’humain et l’ensemble du vivant. Après deux premiers volumes, ce troisième opus paraît autour d’un thème essentiel et urgent : l’avenir de l’Océan.
Disponible dès aujourd’hui en précommande, ce nouveau numéro propose un regard croisé entre scientifiques, explorateurs, anthropologues et artistes pour repenser notre rapport à l’Océan, non plus comme une ressource, mais comme un partenaire vivant et fragile.
·
Dans un monde marin en pleine mutation, où la montée des eaux, l’acidification, l’effondrement des espèces et les pollutions multiples menacent les équilibres planétaires, une chose devient claire : il ne suffit plus d’alerter. Il faut désormais imaginer. Imaginer de nouveaux récits, de nouvelles alliances, de nouvelles manières de coexister. Les voix réunies dans ces pages — scientifiques, artistes, explorateurs, mais aussi celles que nous avons choisies de prêter aux animaux marins eux-mêmes — convergent vers une même intuition :
· S O M M A I R E ·
Edito · Partie 1. L’océan pour la Nature – Entretien avec François Sarano, océaonographe – Qui sont les “mal aimés” de l’Océan ? – Réveiller l’empathie pour les océans : un enjeu pour l’avenir de la planète – Réduire les collisions avec les baleines : une urgence environnementale inspirée du ciel · Partie 2. L’océan comme culture – Entretien avec Frédérique Chlous – Rahui : quand une pratique ancestrale polynésienne protège l’océan – Requins et communautés locales : une alliance pour préserver les océans – Les Haenyeo de Jeju : gardiennes de la mer, héritières d’un monde durable · Partie 3. L’océan pour la société – Entretien avec Céline Liret, directrice scientifique et culturelle et conservatrice d’Océanopolis – Changement climatique et pêche : quelles perspectives pour la biodiversité marine ? – Comment rendre les initiatives côtières plus équitables et résilientes face aux défis climatiques – L’observation des cétacés en Méditerranée : une activité sous haute surveillance · Récit : “Le rêve de l’albatros”.
Consulter le dossier de presse
·
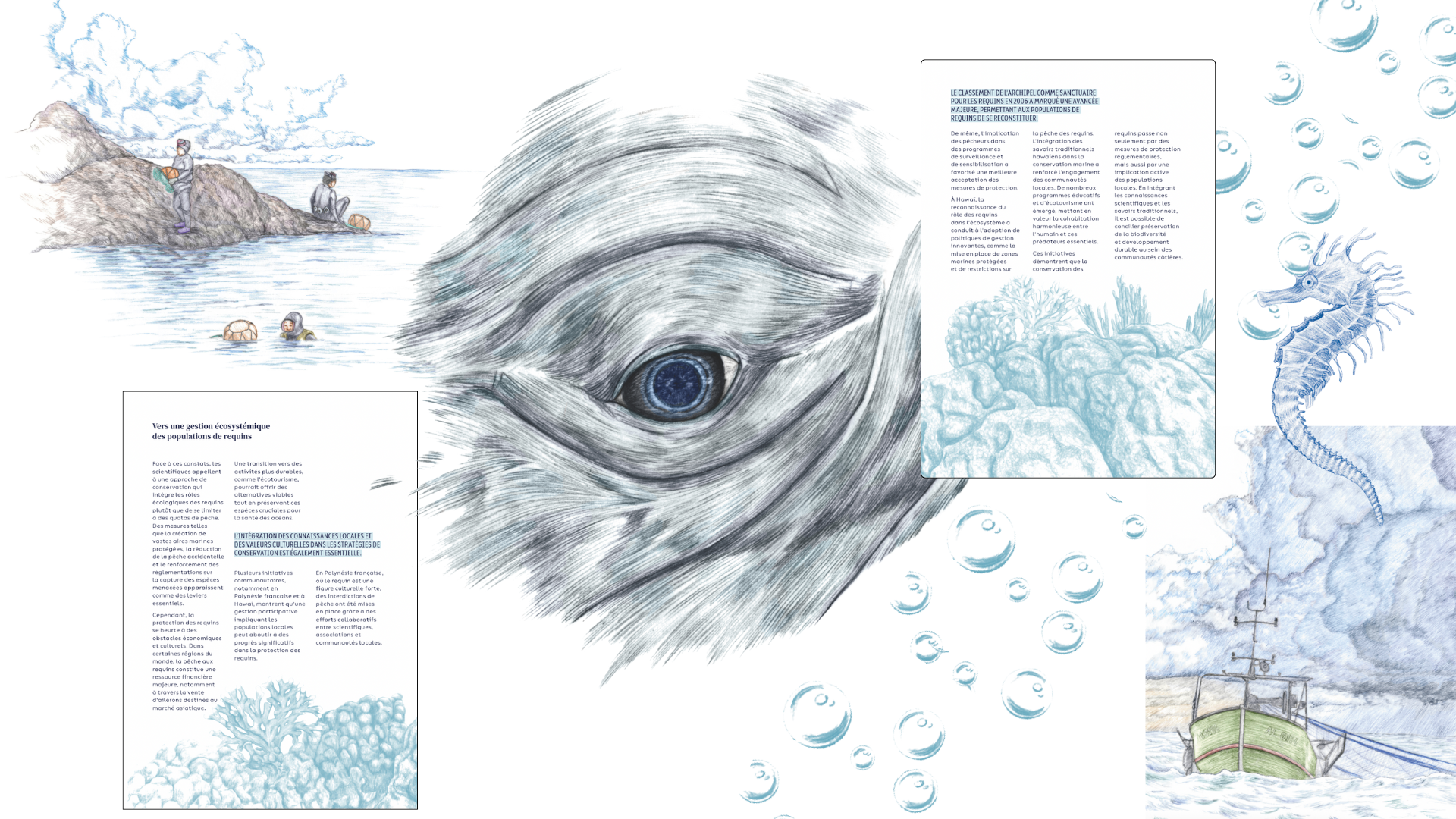
· C H E R C H E U S E S & C H E R C H E U R S ·
Tamatoa Bambridge, anthropologue et directeur de recherche au Criobe · Céline Liret, docteure en océanologie biologique, directrice scientifique à Océanopolis · François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau et cofondateur de l’association Longitude 181 · Frédérique Chlous, professeure d’anthropologie, directrice générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation, l’Enseignement au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) · Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
·
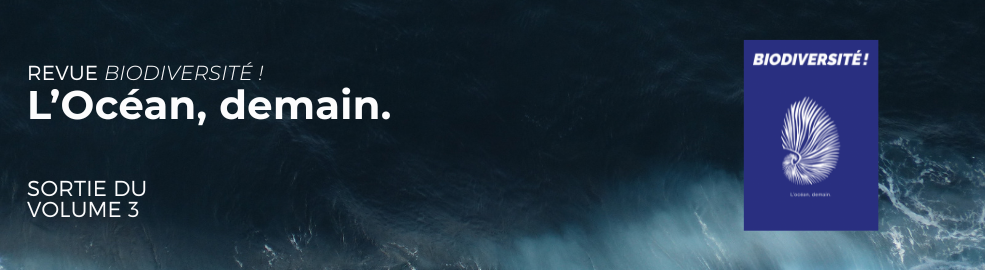
En présentant différentes publications de la Fondation, Biodiversité ! valorise le rôle clé de la recherche dans la construction d’un monde plus durable et présente des leviers et des recommandations, issus de différents résultats de la recherche française, susceptibles de favoriser ce changement si important pour enrayer le déclin de la biodiversité.
VOLUME 3
Et si nous repensions notre rapport à l’Océan ? Non plus comme à une ressource inépuisable à exploiter, mais comme à un partenaire vivant, précieux et vulnérable ? L’Océan n’est pas qu’un vaste réservoir de solutions pour le climat, la santé ou l’alimentation. Il est un monde en soi, aux équilibres complexes, une matrice du vivant dont dépendent nos vies. C’est à cette prise de conscience que Biodiversité ! souhaite contribuer. Acheter le volume
VOLUME 2
À travers divers contextes pour la biodiversité, utilisation durable, conservation de la biodiversité, protection et restauration, la revue montre la manière dont les valeurs de la nature, leur diversité, sont embarquées dans nos vies, ouvrant de nouvelles perspectives. Acheter le volume
VOLUME 1
Avec ce premier volume, découvrez les solutions fondées sur la nature proposées par la recherche pour atténuer le déclin de la biodiversité et le réchauffement climatique. Privilégier des aires marines protégées de façon stratégique ou étudier de près le microbiome des arbres sont autant de pistes scientifiques à lire dans cette nouvelle revue. Acheter le volume
En proposant une série d’articles, de portraits et de regards accessibles au plus grand nombre la Fondation saisit une nouvelle fois l’occasion de donner plus de place à la connaissance scientifique dans le débat public.

La théorie de l’évolution a fait ses premiers pas sur une île – et ce n’est pas un hasard. En 1835, lors de son voyage aux Galápagos, Charles Darwin observe des pinsons avec attention. Ce sont les différences dans la forme de leur bec d’une île à l’autre qui le mettront sur la piste des mécanismes évolutifs (lire la clé pour comprendre sur l’évolution darwinienne).
Les îles sont de véritables joyaux de biodiversité. Leur isolement géographique, combiné à des conditions écologiques particulières, favorise l’émergence d’espèces uniques, souvent endémiques. C’est pourquoi, bien qu’elles ne représentent que 7 % des terres émergées, les îles abritent près de 20 % de la biodiversité mondiale. Cette richesse est également d’une très grande vulnérabilité : les trois-quarts des extinctions contemporaines enregistrées ont eu lieu sur des îles.
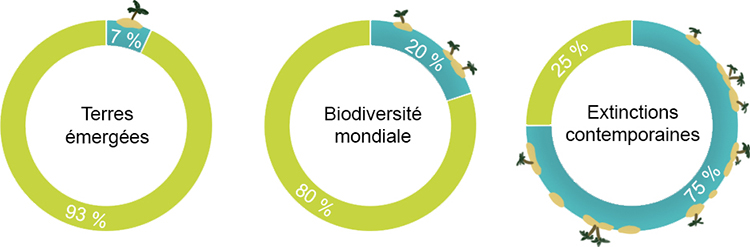
Pourcentages clefs de comparaisons entre les îles (bleu) et les continents (vert). Détail des sources dans Fernández-Palacios et al. 2021.
Ce contraste entre biodiversité exceptionnelle et vulnérabilité extrême est précisément ce qu’explore le groupe FRB-Cesab Rivage, qui propose un cadre spécifique d’évaluation des milieux insulaires (Bellard et al. 2025). Mais avant d’y revenir en détail, prenons le temps de comprendre : Alors, comment ces îles si riches en vie peuvent-elles être si fragiles ?
L’extraordinaire biodiversité des îles s’explique par leur isolement, mais c’est précisément cette particularité qui rend leurs écosystèmes fragiles. On parle ainsi du « syndrome des îles ». De nombreuses espèces insulaires ont évolué dans des environnements dépourvus de certains prédateurs ou compétiteurs, ce qui les a conduites à perdre des défenses devenues inutiles (on peut penser au fameux dodo de l’île Maurice ou encore au cagou de Nouvelle-Calédonie, qui sont des oiseaux ayant perdu la capacité de voler).
Qui dit petits territoires dit également petites populations, ce qui limite fortement la diversité génétique et donc la capacité d’adaptation face aux perturbations. Enfin, un environnement isolé implique une mobilité réduite. En cas de menace, les individus ne peuvent pas fuir vers d’autres territoires plus accueillants.

Dodo de l’île Maurice (éteint) et cagou de Nouvelle-Calédonie (statut UICN en danger). © Violette Silve.
À cette vulnérabilité intrinsèque s’ajoutent des pressions extérieures qui s’intensifient :
Les invasions biologiques : une menace mondiale pour les vertébrés terrestres
Dans une publication préliminaire à la création du groupe FRB-Cesab Rivage (Marino et al. 2024), des scientifiques ont croisé les données sur 1 600 espèces d’animaux terrestres (oiseaux, mammifères et reptiles) avec celles de 304 espèces exotiques envahissantes connues pour leur nuire. Ils estiment qu’au moins 38 % des terres émergées sont déjà concernées par ces invasions — un chiffre probablement sous-estimé, l’étude ne prenant en compte que 10 % des espèces envahissantes recensées dans le monde.
Mais être exposé ne signifie pas forcément être en danger. Pour mieux cerner la situation, les scientifiques ont aussi considéré la sensibilité des espèces natives à cette menace. Cette approche leur a permis de dresser des cartes mondiales de vulnérabilité aux invasions biologiques. Le constat est clair : les îles apparaissent comme les zones les plus fragiles, particulièrement pour les populations d’oiseaux qui y vivent. Les analyses semblent montrer des zones épargnées par les invasions biologiques, mais cela pourrait être dû aux manques de données et d’informations. Un angle mort dans la collecte de données, préoccupant pour la conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale
Pourtant, même si la biodiversité des îles joue un rôle crucial, elle reste largement ignorée dans les évaluations globales, qui se concentrent surtout sur les continents et le climat. Par exemple, dans la Convention sur la diversité biologique (CDB), seule 1 cible sur 23 cite explicitement les îles comme priorité pour la conservation.
Dans ce contexte, il devient urgent de mieux évaluer la vulnérabilité des écosystèmes insulaires. C’est précisément l’objectif du groupe FRB-Cesab Rivage, qui propose dans son premier article un cadre d’évaluation inédit spécifiquement adapté à la biodiversité insulaire (Bellard et al. 2025).
Ce cadre évalue la vulnérabilité selon trois dimensions :
La vulnérabilité globale de la biodiversité peut ainsi être définie comme la somme de l’exposition et de la sensibilité, à laquelle on soustrait la capacité d’adaptation des espèces.
Contrairement à d’autres approches qui considèrent souvent une seule pression à la fois (le plus souvent le changement climatique, ou plus récemment les invasions biologiques avec l’article de Marino et al. 2024), le cadre proposé par Rivage intègre plusieurs pressions simultanément, en incluant leur intensité et leur ampleur, tout en tenant compte des caractéristiques propres aux espèces et de leur capacité d’adaptation. Cet outil vient ainsi compléter des indicateurs plus globaux, comme le pourcentage d’espèces menacées dans la liste rouge de l’UICN. L’objectif n’est pas de reproduire les mêmes résultats, mais de mettre en évidence les différences entre approches afin d’affiner l’analyse et de guider l’action là où l’urgence est la plus grande. Une comparaison détaillée entre l’indice de Rivage et les indicateurs existants est d’ailleurs présentée dans leur prochain article, accessible dès à présent en preprint (Marino et al. in review).
En proposant cet indice adapté aux spécificités des écosystèmes insulaires, les scientifiques du groupe Rivage appellent à agir pour mettre les îles au cœur des priorités.
En savoir plus sur le groupe FRB-Cesab Rivage :

Directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie et Environnement, Philippe Grandcolas s’interroge depuis plusieurs années sur ces tensions entre savoir et pouvoir, expertise et action. À l’occasion de la publication prochaine de son ouvrage La biodiversité, urgence planète – Notre monde vivant en danger expliqué à tous (éditions Tallandier, septembre 2025), il revient pour nous sur les blocages culturels, politiques et cognitifs qui freinent encore la transition écologique.
Dans cet entretien, le scientifique plaide pour un sursaut collectif : repenser nos représentations du vivant, renouveler les formes de médiation scientifique, et replacer la biodiversité au cœur de nos choix de société.

L’agriculture industrielle se caractérise par un recours accru aux pesticides. Ces derniers se retrouvent dans l’environnement et leurs impacts sur la biodiversité sont de plus en plus documentés. Mais où sont ces pesticides dans l’environnement ? Malheureusement, la disponibilité des données permettant de réaliser des analyses temporelles à grande échelle spatiale, nécessaire pour l’évaluation de l’impact de ces molécules sur la biodiversité et la santé humaine, reste insuffisante. Pour combler ce manque, des chercheurs de l’INRAE et de la FRB proposent un indice d’exposition inédit ainsi qu’une carte de répartition des pesticides les plus toxiques à l’échelle française entre 2013 et 2022.


L’homogénéisation des paysages agricoles et forestiers, conséquence directe de décennies d’intensification, mine les services écosystémiques dont dépend notre bien-être. La note politique intitulé “La diversité des paysages améliore la santé humaine”, souligne qu’une plus grande diversité du paysage – entendez : une mosaïque de cultures, de forêts, de haies, de prairies – soutient une biodiversité florissante, qui elle-même favorise la santé mentale, limite les effets des canicules et améliore la qualité de l’air.
La note souligne notamment que des forêts diversifiées, par la variété de leurs espèces et la densité de leurs canopées, atténuent efficacement le stress thermique et filtrent les particules fines. En zone urbaine, elles peuvent réduire la température ressentie de près de 9°C. Autre enjeu de santé publique : même une modification mineure de l’usage des terres, comme l’épandage ou le rejet d’eaux usées, peut contribuer à la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques dans les rivières.
La note politique de Biodiversa+ recommande de restaurer la complexité des forêts européennes, d’intégrer des arbres autochtones dans les plans d’urbanisme, et de mieux encadrer les usages agricoles autour des cours d’eau.
Consulter le policy brief :
Second pilier mis en lumière par les chercheurs : la biodiversité dans les systèmes agricoles. La note “La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine” rappelle que la diversité fonctionnelle – c’est-à-dire la diversité des rôles biologiques joués par les espèces dans un écosystème – est essentielle pour maintenir la santé des cultures, la fertilité des sols et la qualité nutritionnelle des aliments.
À travers les projets FunProd, NutriB2, VOODOO et SuppressSoil, les chercheurs démontrent que la santé des abeilles, par exemple, dépend d’une grande diversité florale, non seulement en quantité mais aussi en qualité nutritionnelle. Réduire cette diversité augmente les risques de transmission de pathogènes entre abeilles sauvages et domestiques. De même, la diversité microbienne des sols permet de réguler les maladies fongiques et les ravageurs, limitant ainsi la dépendance aux pesticides.
Les recommandations sont claires : encourager les pratiques comme la rotation des cultures, la réduction du travail du sol, l’usage du fumier, et inscrire la réduction des intrants chimiques dans la stratégie « De la ferme à la table » de l’UE. La note propose aussi d’intégrer les pollinisateurs sauvages aux législations sur les produits phytosanitaires, jusqu’ici centrées sur les abeilles domestiques.
Consulter le policy brief :
Troisième volet : la biodiversité comme barrière naturelle contre les épidémies. “La note La biodiversité réduit les risques pour la santé” s’attaque à l’un des enjeux sanitaires majeurs de notre siècle : l’émergence de maladies infectieuses, en particulier zoonotiques. Près de 75 % des nouvelles maladies humaines proviennent d’animaux, souvent sauvages. Leurs transmissions aux humains sont favorisées par la fragmentation des habitats, l’urbanisation, le commerce illégal de faune sauvage, mais aussi la perte de diversité microbienne.
Les données issues de six projets de recherche révèlent des dynamiques complexes. Dans certains cas, une grande diversité réduit la prévalence des agents pathogènes (effet de dilution). Dans d’autres, elle peut au contraire favoriser la transmission si certaines espèces vectrices sont surreprésentées. Une approche fine, locale et interdisciplinaire est donc cruciale.
La note politique de Biodiversa+ appelle à renforcer l’approche « Une seule santé » (One Health), qui lie santé humaine, animale et environnementale. Une surveillance renforcée des pathogènes dans la faune et l’environnement, une meilleure régulation des échanges de faune sauvage, et la restauration ciblée d’habitats clés sont autant d’actions proposées.
Consulter le policy brief :
À travers ces trois notes politiques, c’est une vision intégrée (nexus !) de la santé qui se dessine. Les enjeux ne sont pas seulement écologiques ou agricoles, ils sont sanitaires, sociaux, économiques. La biodiversité est un bien commun, un allié puissant contre les dérèglements de notre époque.
La stratégie biodiversité 2030 de l’UE, la nouvelle loi sur la restauration de la nature ou encore la réforme de la PAC sont autant de leviers. Encore faut-il que ces recommandations scientifiques trouvent une traduction politique à la hauteur de leur urgence.
Bonjour Nils. Tu as souhaité parler de la “participation transformative “. Pourquoi est-ce important ?
La participation transformative est une approche qui vise à impliquer activement les citoyens et les parties prenantes dans les processus de changement social et écologique, en allant au-delà de la simple consultation, pour permettre une réelle co-construction des solutions, et aller vers leur mise en œuvre.
Aujourd’hui, l’enjeu fondamental est de voir comment la production scientifique peut engendrer des impacts concrets. Cela traverse les discussions menées au sein de l’Ipbes ou à la FRB et à travers le sujet de “changement transformateur” : comment les connaissances peuvent-elles contribuer à améliorer la qualité de vie et à la durabilité des écosystèmes ? Pour cela, en tant que scientifiques, il est crucial de réfléchir à la manière d’adapter nos pratiques et nos relations avec les autres acteurs pour mieux intégrer la science, la société et la politique. Cela signifie préserver la rigueur scientifique tout en augmentant le potentiel transformateur des connaissances, pour qu’elles puissent véritablement influencer et enrichir les décisions collectives ! Et il ne s’agit pas seulement de produire et transmettre “mieux” des connaissances – approche classique antérieure -, mais de s’engager dans un travail collaboratif différent avec les acteurs non scientifiques, et de construire et suivre ainsi ensemble des chemins de changement. Notre hypothèse de base est que la modélisation participative va amorcer des transformations en réponse aux besoins des acteurs.
![]()
Peux-tu nous définir ce qu’est la “participation transformative”, ses grands principes ?
La participation transformative repose sur plusieurs principes fondamentaux visant à engager efficacement les acteurs :
Notre démarche s’appuie sur la création de dispositifs de participation, l’utilisation d’outils et méthodes accessibles, qui légitiment et mobilisent activement les acteurs. Au contraire de “l’acceptologie”, où les citoyens sont simplement invités à approuver des décisions déjà prises, nous défendons une approche où les acteurs s’impliquent, ensemble, dans la co-construction des solutions, la considération de futurs viables. L’élément clé n’est pas de produire un plan final, mais de créer un processus collectif qui aboutisse à une vision partagée et à des actions cohérentes.
![]()
Concrètement, comment se met en place la recherche transformative ? Comment réussissez vous, dans ton équipe, à faire travailler ensemble une grande diversité d’acteurs ?
Tout d’abord nous ne travaillons que dans et sur des projets de recherche intervention portés à la demande d’acteurs “de terrain” : élus, administrations, associations. L’existence d’un besoin, d’une demande est fondamentale, même si elle n’est pas initialement partagée par tous et toutes localement. Cela peut choquer certains collègues par cette dépendance assumée, mais elle est cruciale pour la mobilisation et la pertinence des travaux.
Nous sommes un groupe très interdisciplinaire, incluant des spécialistes de la modélisation — écologues, économistes, sociologues, et autres experts — pour élaborer des protocoles qui facilitent la coopération entre acteurs divers.
La méthode est très cadrée, elle repose sur quatre piliers : c’est pour mieux assurer un processus de collaboration et un espace de co-construction !
As-tu des cas pratiques à nous fournir où vous avez mis en place cette méthode ?
Notre méthodologie a été appliquée avec succès dans divers contextes à travers le monde. Voici deux exemples dans lesquels il est possible de retrouver les piliers précédents :
![]()
En somme, les approches de “participation transformative” ont démontré leur efficacité dans divers contextes ?
Oui, ancrée dans la modélisation participative et l’inclusion active des acteurs, les expérimentations de “participation transformative” ouvrent la voie à des transformations réelles et durables, adaptant la recherche scientifique aux besoins concrets des sociétés et des écosystèmes. En revanche, nous cherchons encore les chemins d’une généralisation et d’un impact à l’aune des défis actuels.
Vous souhaitez approfondir ces concepts et les exemples cités ? Vous pouvez consulter le livre Transformative Participation for Socio-Ecological Sustainability, accessible librement en ligne.
Consulter le livre en ligne (ENG)
Hassenforder E., Ferrand N. (eds). Transformative Participation for Socio – Ecological Sustainability – Around the CoOPLAGE pathways. Editions Quae, 2024. 270 pages

La crise actuelle de la biodiversité soulève des enjeux écologiques, économiques et sociétaux majeurs. Aussi, des bases de données en écologie se multiplient pour évaluer les tendances de la biodiversité. Les résultats de ces évaluations influencent l’opinion publique et les décideurs. Or, bien qu’elle soit une condition nécessaire à la fiabilité des tendances estimées, la qualité de ces jeux de données fait rarement l’objet d’investigations poussées.
Les données sur les insectes n’échappent pas à ce constat. Les insectes assurent des services essentiels dans les écosystèmes (pollinisation, recyclage de la matière organique, source de nourriture pour de nombreuses espèces, contrôle des bioagresseurs …). Leur déclin est donc particulièrement préoccupant mais il est très difficile de mesurer précisément son ampleur et ses déterminants en raison de leur grande diversité taxonomique et d’un manque de données concernant certains groupes.
Ainsi, une évaluation minutieuse de la seule base de données mondiale sur les insectes, InsectChange, publiée dans Ecology en 2021, montre qu’il est crucial de mieux prendre en compte la question de la qualité des bases de données. InsectChange rassemble les données utilisées dans la méta-analyse de van Klink et al. publiée dans Science en 2020, qui montrait un déclin des insectes terrestres de 9 % par décade, et une augmentation des insectes d’eau douce de 11 % par décade. Cette méta-analyse ne mettait pas en évidence d’impact de l’agriculture sur le déclin des insectes. Elle argumentait au contraire que l’amélioration des pratiques agricoles était un facteur explicatif de l’augmentation des insectes d’eau douce. Cette méta-analyse, plutôt rassurante par rapport à d’autres résultats antérieurs, a fait néanmoins l’objet de plusieurs analyses critiques de la part de la communauté scientifique internationale, dont une publiée dans Science la même année. Les auteurs de l’article débattu ont publié une correction, mais celle-ci n’a considéré qu’à la marge les critiques énoncées, et la publication a continué à être fortement médiatisée. L’analyse complète de InsectChange, en révélant une accumulation d’erreurs et de biais dans les données, démontre que les tendances estimées et leurs déterminants ne sont pas fiables.
Cette analyse critique révèle plus de 500 erreurs et problèmes méthodologiques dans la constitution de cette base de données à partir de 165 jeux de données. Ces problèmes, parfois transmis depuis une autre base de données, relèvent de 17 types : chiffres mal reportés, biais d’échantillonnage, insectes comptés deux fois, unités de mesures non standardisées, etc. La méthode développée pour évaluer la base de données définit des critères spécifiques et regroupe les problèmes en quatre catégories : erreurs, incohérences, problèmes méthodologiques et déficit d’informations.
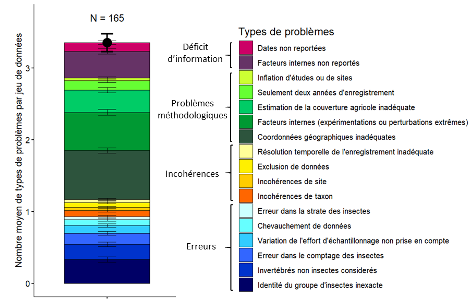
Illustration de la répartition et du nombre moyens des 17 types de problèmes rencontrés par jeu de données dans la base InsectChange, auquel s’ajoute le problème général de non-standardisation des données (non représenté sur le graphique). Ces types de problèmes appartiennent à quatre catégories : les erreurs, les incohérences, les problèmes méthodologiques et les déficits d’information.
Ainsi, l’analyse détaille quatre problèmes majeurs qui ont conduit à fausser l’analyse des tendances des insectes et celle de leurs déterminants.
Un problème majeur de la base de données réside dans le fait que les métriques (abondance, biomasse) sont disparates, les méthodes d’échantillonnage sont différentes et les unités de mesure ne sont pas standardisées. L’analyse montre que la transformation mathématique log(x+1) de ces données hétérogènes effectuée dans la méta-analyse de Science compromet la comparaison des pentes entre les séries temporelles et l’estimation des tendances globales des insectes. Elle ne permet pas, comme il était spécifié, de travailler sur des variations temporelles relatives et donc comparables entre jeux de données. Ce problème suffit ainsi à lui seul à invalider l’estimation faite des tendances des insectes dans le monde.
La base de données présente plusieurs d’erreurs et d’incohérences comme :
En plus de ces erreurs, un problème majeur a conduit à sous-estimer le déclin des insectes à partir de cette base de données. En effet, beaucoup de jeux de données comprennent des invertébrés qui ne sont pas des insectes, comme des moules envahissantes, des escargots, des vers et des crustacés. C’est le cas de près de la moitié des jeux de données d’eau douce concernant l’abondance des insectes (le nombre d’individus) et plus de trois quarts de ceux concernant leur biomasse (le poids cumulé des individus). Ce type d’erreur peut avoir des impacts importants sur l’évaluation des tendances : ainsi, un jeu de données d’un lac du Kazakhstan montre, en près d’un siècle, une augmentation exponentielle « d’insectes » … alors qu’il s’agit pour la plupart de coquillages envahissants, atteignant à la fin de la période considérée 95 % de la biomasse de l’assemblage total d’invertébrés pris en compte.
De plus, un examen minutieux des données sources a permis d’identifier les jeux de données pour lesquels il était en fait possible de séparer insectes et non insectes. Dans ces jeux de données, bien souvent la biomasse des seuls insectes diminuait, alors que celle des assemblages d’invertébrés présentés comme des insectes augmentait. Il a pu ainsi être démontré que la prise en compte de l’ensemble des invertébrés, et non des seuls insectes, conduisait à surestimer la tendance des « insectes » d’eau douce.
Une faille méthodologique réside dans le fait que plus de la moitié des publications sources étudiaient les dynamiques des insectes dans des contextes très spécifiques (mesures de restauration, création de nouveaux habitats, feu, sécheresse, traitements insecticides, etc.). Ces contextes étaient des perturbations extrêmes ou des facteurs étudiés comme pouvant influencer les dynamiques observées et testés au travers d’expériences contrôlées (avec manipulation du milieu) ou d’expériences naturelles (comparaison de sites naturellement perturbés avec d’autres restés intacts). Mais ces contextes spécifiques ne sont la plupart du temps pas reportés dans la base de données. Or ils créent des situations non représentatives de la diversité des conditions de vie des insectes dans le monde qui favorisent cinq fois plus fréquemment l’augmentation des insectes que leur diminution. L’utilisateur est laissé ignorant des biais dans les tendances, artificiellement causés par ces facteurs influents, et de la sous-estimation du déclin global des insectes qui en résulte.
Alors que les contextes spécifiques aux études sources – facteurs les plus directement influents sur la dynamique des insectes – ne sont souvent pas reportés dans la base de données, cette dernière extrait depuis des bases externes des données concernant les facteurs anthropogéniques susceptibles d’influencer localement les tendances observées. Plus précisément, les données d’évolution des insectes dans InsectChange sont appariées via les coordonnées géographiques des sites d’échantillonnage avec d’autres bases de données mondiales décrivant l’évolution de l’utilisation des terres (agriculture, urbanisation) et du climat. Or, une analyse détaillée montre que pour deux tiers des jeux de données, l’appariement des bases de données est compromis parce que la zone d’échantillonnage est plus grande que la zone définie comme échelle locale dans la base de données externe, ou n’est pas localisée au bon endroit dans InsectChange. Par ailleurs, la base de données qui code la couverture des terres du globe à partir d’une interprétation automatisée d’images satellites, peut confondre les cultures agricoles avec des prairies, des steppes, etc. Ainsi, une analyse exhaustive montre que les sites considérés sans culture agricole au niveau local sont bien non cultivés, tandis que les sites considérés comme cultivés ne le sont en général pas, ou moins que ce qui est reporté. Cette surestimation importante de la couverture des terres cultivées conduit les auteurs de la méta-analyse à écarter ainsi de façon erronée les pratiques agricoles comme cause possible du déclin des insectes. À cause d’une méthodologie doublement inappropriée, InsectChange ne permet donc pas d’identifier les déterminants des tendances des insectes.
Ce travail minutieux et complet d’évaluation montre l’insuffisante attention accordée à la qualité des données d’InsectChange et amène à réfléchir sur la nécessité d’une évaluation systémique des grosses bases de données construites pour estimer les tendances de la biodiversité. À ce titre, la méthodologie reproductible développée pour évaluer InsectChange peut contribuer à l’élaboration d’une méthode généralisable d’évaluation de la qualité des bases de données en écologie.
Ce travail d’ampleur met également en garde contre les risques d’une science toujours plus rapide. Il appelle les revues scientifiques à améliorer leur processus d’évaluation par les pairs et à garantir la prise en compte des commentaires post-publication, afin de préserver la qualité des connaissances scientifiques. Cela concerne tout particulièrement les revues de renom, intermédiaires privilégiés des journalistes.
Enfin, cette démarche inédite met en lumière le rôle fondamental de l’organisation de chercheurs à but non lucratif Peer Community In. En publiant, comme elle l’a fait pour cette réanalyse des données de InsectChange, des commentaires critiques sans restriction éditoriale, selon une démarche de science ouverte et un processus d’évaluation indépendant et transparent, cette organisation participe à préserver l’intégrité scientifique et la qualité du débat scientifique.
Cet article a d’ores et déjà fait l’objet de différentes communications et reprises dans la presse. Merci à Laurence Gaume, chercheuse en écologie au CNRS, et Marion Desquilbet, chercheuse en économie de l’environnement (INRAE) d’avoir pris le temps de revenir sur ce texte pour la FRB.

Bonjour Michela. Tu as souhaité nous parler de la pollution sonore et de ses effets sur la biodiversité. Mais qu’entends-tu par “pollution sonore” et pourquoi est-il important de l’étudier ?
La pollution sonore désigne les bruits indésirables ou nuisibles générés par les activités humaines, telles que la circulation routière, aérienne, les chantiers ou encore les activités industrielles. Elle se caractérise généralement par des niveaux sonores dépassant 55 décibels. L’intensité du bruit est souvent liée à l’imperméabilisation des sols, et les effets de cette pollution peuvent s’étendre jusqu’à 2 km autour des axes routiers. Pour mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène, il est possible de représenter spatialement la distribution de ces sources de bruit à travers des cartes détaillant les niveaux sonores à l’échelle nationale. En France, cette cartographie révèle qu’il ne reste que quelques zones véritablement silencieuses, principalement situées dans les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), en Europe, ces nuisances sonores toucheraient environ 125 millions de personnes, soit un Européen sur quatre, et constituerait un problème majeur de santé publique !
Le bruit n’a pas seulement des conséquences sur les humains ; il perturbe également la faune. Chez de nombreuses espèces animales, le son est crucial pour la détection des prédateurs, la communication ou la localisation des proies. Cependant, le bruit anthropique – généré par les activités humaines – tend à masquer les sons naturels, perturbant ainsi les comportements des animaux. De plus, ces bruits indiquent souvent la présence d’une source perturbante, ce qui pousse les animaux à fuir ces zones bruyantes. Bien que les impacts du bruit sur la faune sauvage soient activement étudiés par la communauté scientifique, ils restent souvent négligés lors de l’élaboration des politiques environnementales.
Dans le projet Acoucène, vous travaillez sur les effets de la pollution sonore sur les oiseaux, mais pourquoi s’intéresser aux oiseaux ?
Dans le cadre du projet FRB-Cesab Acoucène, nous nous intéressons au chant des oiseaux, car il joue un rôle central dans leur vie : il sert à rechercher des partenaires, à défendre leur territoire et à assurer la garde parentale. Les oiseaux dépendants donc fortement des sons, ils sont particulièrement sensibles à la pollution sonore. Cette dernière provoque chez eux un stress accru, perturbe leur communication, réduit leur taux de reproduction et leur survie. Sur le cours de plusieurs générations, la sélection naturelle dans des habitats bruyants peut même induire des modifications génétiques et des réponses adaptatives.
C’est pourquoi, étant des indicateurs clés de la biodiversité et très vulnérables au bruit, l’étude des oiseaux est cruciale, notamment pour la création d’une carte des réseaux de communication animale. Cartographier la présence de “barrières sonores” dans les habitats permettrait d’identifier et de localiser les zones riches en biodiversité, où la diversité sonore naturelle est préservée et peu affectée par les bruits anthropiques. Cette carte servirait à repérer la fragmentation acoustique dans le paysage ainsi que des zones jugées comme problématiques, c’est-à-dire des lieux où des mesures locales pourraient être mises en place pour limiter les nuisances de la pollution sonore.
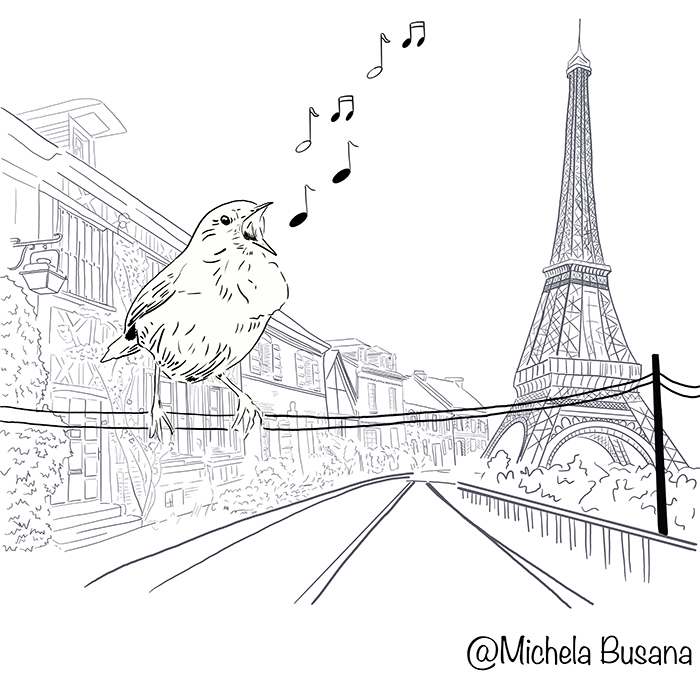
D’accord, je comprends déjà mieux l’intérêt d’étudier l’impact de la pollution sonore sur les oiseaux ! Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les études que vous avez menées depuis le début du projet ?
Tout d’abord, nous avons analysé des enregistrements des chants en France de 117 espèces d’oiseaux sous différents aspects : la fréquence, la complexité, le rythme et la durée des chants. Ces caractéristiques acoustiques permettent de comprendre la diversité ainsi que la spécificité du chant de chaque espèce. Nous avons également intégré des données provenant de plusieurs sources d’observation citoyennes et scientifiques. Par exemple, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) nous offre des données sur l’abondance des espèces tandis que des atlas ornithologiques fournissent des informations sur leur présence ou absence en France. Enfin, nous avons utilisé la plateforme Xeno-Canto, un site collaboratif de partage d’enregistrements sonores d’animaux sauvages. Cela nous a permis de travailler sur une base impressionnante de 24 936 enregistrements : de quoi extraire où et quand les oiseaux chantent le plus souvent !
Ces données nous ont aidés à répondre à deux grands objectifs :
Ces résultats nous donnent non seulement une meilleure compréhension des impacts du bruit sur les oiseaux, mais aussi des pistes pour mieux protéger ces espèces face à un environnement de plus en plus bruyant en raison de l’expansion future des zones urbaines et de l’augmentation de la population humaine.
Comment ces résultats peuvent-ils être utilisés sur le terrain, par les acteurs dans les territoires ?
Nous avons réalisé une carte préliminaire montrant la vulnérabilité des oiseaux à la pollution sonore en France, en se basant sur le risque de masquage et le niveau de pollution sonore actuels. Cette carte permet d’identifier les zones présentant des vulnérabilités élevées au bruit, ainsi que les zones qui pourraient bénéficier de mesures de réduction.
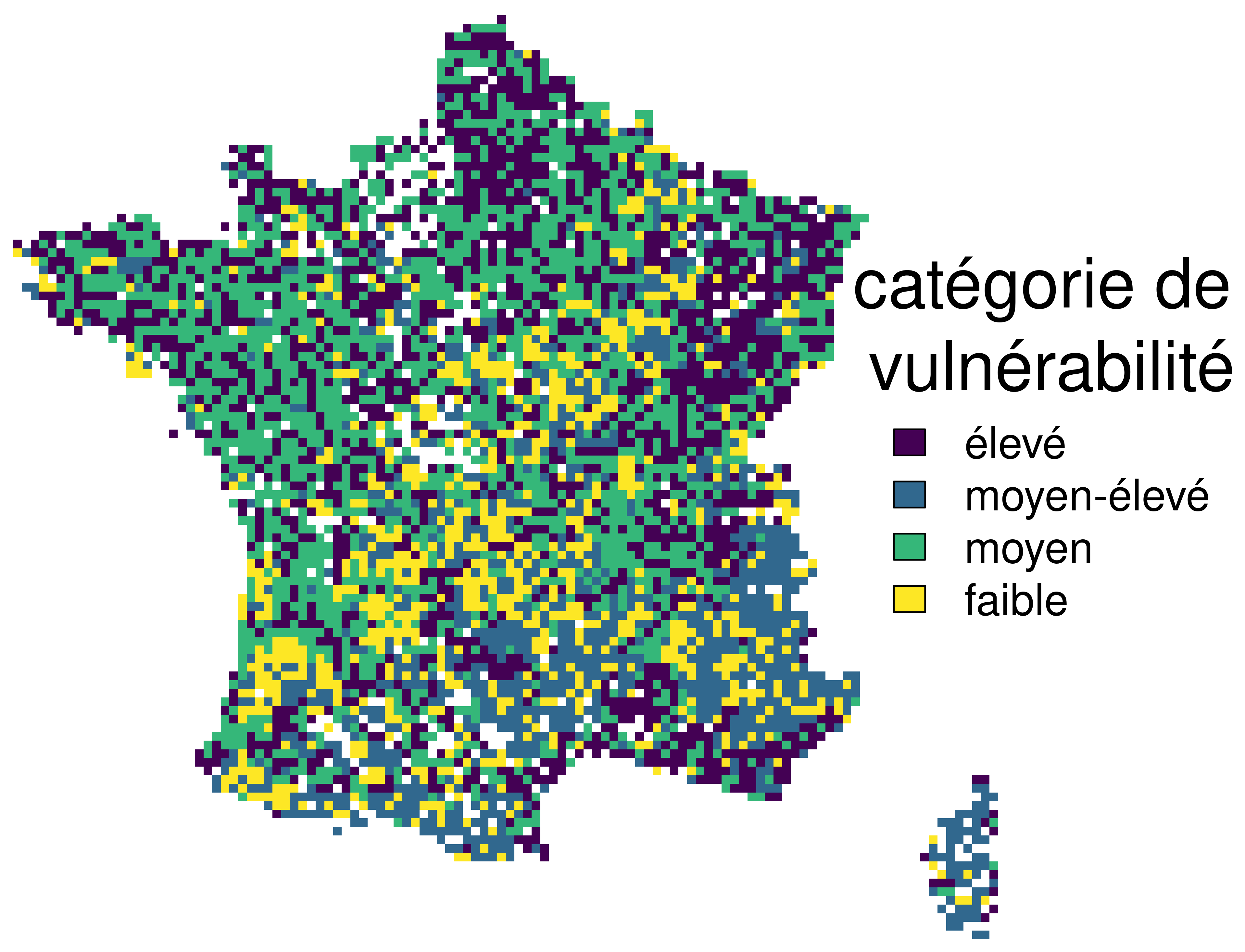
Carte des risques posés par la pollution sonore sur le chant des oiseaux (cellules de 10 km2).
Les pixels en violet indiquent des zones avec un bruit élevé et un risque élevé pour les oiseaux, les pixels en bleu indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen mais une vulnérabilité élevée pour les oiseaux, les pixels en vert indiquent des zones avec un bruit élevé mais un risque faible pour les oiseaux, et les pixels en jaune indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen et un risque faible pour les oiseaux.
Tu parles de mesures de réduction du bruit, comment aller plus loin ?
Pour aller plus loin, il faudrait mener des enquêtes à plus petite échelle dans les zones identifiées comme particulièrement vulnérables. Ces études ciblées permettraient d’identifier et de localiser précisément les points noirs de bruits afin d’adopter des mesures efficaces pour en atténuer les effets.
Deux approches principales s’offriraient alors :
Ces actions, qu’il s’agisse de réduire le bruit à la source ou de rendre les habitats plus accessibles, constitueraient des solutions concrètes et applicables pour mieux protéger les communautés sauvages dans des environnements de plus en plus bruyants.
Plus d’informations sur le groupe :
En apprendre plus sur les impacts évolutifs des activités anthropiques :

La modélisation : un outil clé pour comprendre et préserver la biodiversité
La modélisation joue un rôle crucial en écologie, notamment pour la compréhension et la protection de la biodiversité. Parmi eux, les modèles de distribution d’espèces sont particulièrement utiles en conservation. Ils permettent de prédire les zones où les espèces sont susceptibles de se trouver, aidant ainsi scientifiques et conservateurs à identifier les habitats critiques et les régions riches en biodiversité. De plus, ces modèles éclairent les stratégies pour atténuer les effets du changement climatique, gérer les espèces envahissantes et améliorer la connectivité des habitats.
Un défi de taille : la complexité des habitats
Cependant, ces modèles sont particulièrement complexes à paramétrer dans des environnements fragmentés. La pression exercée par les activités humaines contribue à l’isolement des populations animales et à la perte de biodiversité. Par exemple, selon le rapport mondial de l’IPBES de 2019, 75 % des surfaces terrestres ont été modifiées par l’humain. En Europe, la moitié des terres se trouvent à moins de 1,5 km d’une route. Ces infrastructures créent des barrières physiques qui compliquent les déplacements des espèces, augmentent les risques d’extinction locale et diminuent la diversité génétique. Face à cette fragmentation, la connectivité des paysages est devenue une priorité dans les stratégies de conservation. Elle est d’ailleurs explicitement mentionnée dans cinq des cibles du cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité, qui soulignent l’importance d’améliorer les corridors écologiques.
Une solution innovante : intégrer des distances non-euclidiennes dans les modèles de distribution d’espèces
Traditionnellement, les modèles de déplacement dans les paysages fragmentés utilisent des distances dites “euclidiennes”, c’est-à-dire une ligne droite entre le point de départ et celui d’arrivée. Cependant cette simplification ne reflète pas toujours la réalité comme le résume Maëlis Kervellec, première auteure d’un article récent du groupe FRB-Cesab Discar : « Imaginez que vous deviez acheter des pâtisseries. Iriez-vous à la boulangerie juste en face de chez vous, mais de l’autre côté d’une rivière, ou alors à celle sur votre route vers votre travail ? ». De la même manière, les animaux privilégient souvent des itinéraires accessibles ou sûrs, plutôt que le chemin le plus court.
Pour répondre à cette problématique dans le cadre des modèles, les scientifiques du groupe Discar ont développé une approche novatrice en intégrant des distances dites “non-euclidiennes” dans les modèles de distribution d’espèces. Cette méthode repose sur la distance de “temps d’échange”, issue de la théorie des circuits, qui évalue les multiples chemins possibles entre deux points. Contrairement aux approches traditionnelles, cette méthodologie prend en compte les barrières et les corridors présents dans l’environnement, offrant une vision plus réaliste des déplacements des espèces dans des paysages fragmentés.
Applications concrètes : le cas de la loutre et du lynx
Pour illustrer leur méthode, les chercheurs ont appliqué ce modèle à deux espèces de carnivores en recolonisation en France : le lynx boréal dans le Jura et la loutre d’Europe dans le Massif central. Les résultats montrent que les autoroutes agissent comme des barrières pour le lynx, ralentissant son expansion, tandis que les rivières facilitent le déplacement de la loutre. Cette approche a permis de quantifier les effets des infrastructures humaines sur la recolonisation des espèces, ouvrant la voie à des stratégies de gestion plus adaptées.

Olivier Gimenez, chercheur principal du groupe Discar, a exploré un autre défi important des modèles de distribution d’espèces : l’autocorrélation spatiale. En écologie, ce phénomène se produit lorsque des données sont récoltées proches géographiquement et partagent une probabilité similaire de présence d’une espèce. Cela créé des dépendances qui peuvent biaiser les analyses si elles ne sont pas prises en compte. Dans les modèles de distribution d’espèces appliqués aux habitats aquatiques, comme les réseaux de rivières, l’autocorrélation spatiale est souvent modélisée à l’aide de distances euclidiennes ce qui ne reflète pas la réalité des rivières dont les parcours sont sinueux (coudes, méandres, etc.). En intégrant l’autocorrélation spatiale et en tenant compte des distances non-euclidiennes décrites précédemment, Olivier Gimenez a mis au point une approche plus réaliste. Testée sur la loutre d’Europe, cette méthode a montré que les résultats des modèles correspondaient beaucoup mieux aux observations de terrain.
Un outil au service des décisions de conservation
En publiant ces articles, le groupe Discar illustre comment la recherche académique peut avoir des applications directes dans les politiques de conservation. L’innovation de cette approche réside dans sa capacité à intégrer des incertitudes tout au long du processus d’analyse. Les cartes finales reflètent non seulement les meilleures estimations de connectivité, mais aussi le degré d’incertitude associé à ces estimations. Cela peut aider gestionnaires et décideurs à prendre des décisions plus éclairées en matière de conservation, en tenant compte à la fois des tendances observées et de leur niveau de confiance. À terme, cette méthode pourrait être appliquée à d’autres espèces et régions, renforçant ainsi les décisions de conservation.
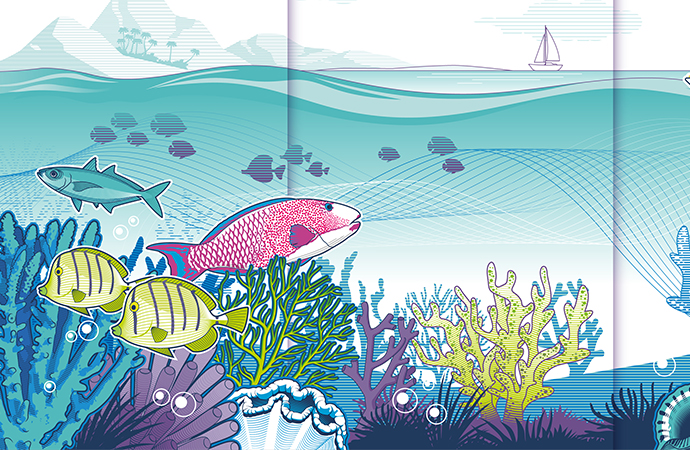
À l’occasion de ce lancement, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ?
Ces exemples illustrent comment les crises liées au changement climatique, à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à l’alimentation sont indissociables. Chacune de ces dimensions est une pièce du puzzle qui façonne notre avenir. Il est devenu essentiel de comprendre que les perturbations dans l’une d’entre elles entraînent des répercussions immédiates sur les autres.
La disparition des chauves-souris au nord des États-Unis provoque des effets en chaîne sur l’agriculture, l’économie et la santé publique. Leur rôle crucial dans la régulation des insectes est irremplaçable : sans elles, les agriculteurs ont intensifié l’utilisation d’insecticides, bien moins efficaces. Résultat : une baisse de la qualité des récoltes, une perte de 28,9 % des revenus agricoles (26,9 milliards de dollars) et des conséquences délétères sur la santé infantile. Les dommages combinés pour l’agriculture et la santé s’élèvent à 39,4 milliards de dollars. Ce lien de causalité illustre l’interdépendance entre biodiversité et bien-être humain.
Article source :
Eyal G. Franck et al. (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science
Le gaspillage alimentaire, qui comprend les pertes à différents stades de la chaîne d’approvisionnement — production, manutention post-récolte, transformation, et distribution — a des conséquences écologiques et sociales importantes. Réduire ce gaspillage de moitié permettrait de préserver 12 % des ressources mondiales en eau, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 4 %, et nourrir jusqu’à 1,9 milliard de personnes supplémentaires. Ces chiffres illustrent le lien de causalité entre nos habitudes de consommation, les pertes alimentaires et l’épuisement des ressources planétaires.
Article source :
Kummu et al. (2012) Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. Science of the Total Environment
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.092
L’eau douce, la biodiversité, la santé humaine, le changement climatique et la sécurité alimentaire forment un réseau de relations interdépendantes. La surexploitation de l’eau pour l’agriculture entraîne une dégradation des écosystèmes aquatiques, accentuée par la pollution chimique et l’introduction d’espèces invasives. Ces pratiques contribuent au changement climatique, qui, à son tour, exacerbe la perte de biodiversité et fragilise la sécurité alimentaire. En retour, cette fragilité accroît les risques pour la santé humaine, soulignant un cercle vicieux où chaque perturbation alimente les déséquilibres globaux.
Article source :
Carpenter et al. (2011) State of the World’s Freshwater Ecosystems: Physical, Chemical, and Biological Changes. Annual Review of Environment and Resources
DOI : 10.1146/annurev-environ-021810-094524
Les récifs coralliens, sous la pression croissante du changement climatique, subissent une dégradation alarmante. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, fournissant des ressources à des millions de personnes. Leur déclin entraîne une diminution des services écosystémiques, compromettant les stocks de poissons et les moyens de subsistance des communautés côtières, tout en fragilisant les équilibres environnementaux globaux.
Article source :
Hughes et al. (2017) Coral reefs in the Anthropocene. Nature
Qu’est-ce que le projet PEPR ATLASea ?
Avant de s’intéresser à le définir, il est important de comprendre pourquoi il est important ! Les approches systématiques sont cruciales afin de dresser des inventaires de biodiversité, notamment pour obtenir des génomes. Le génome est comme une pelote de laine compacte dans le noyau des cellules, où chaque fil d’ADN porte des instructions qui codent le vivant. Séquencer un génome, c’est dérouler et enregistrer toutes ces informations.
Au niveau international, l’échelle génomique est en pleine activité, avec des nombreux projets globaux tels que :
C’est dans ce cadre, en tant que contribution dans ces initiatives plus générales, que la France a choisi de participer à l’effort international en lançant un PEPR (Programme et Équipement Prioritaire de Recherche). Ce dispositif français, dédié au financement de la recherche publique, s’inscrit dans le plan France 2030. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour le programme ATLASea, dont l’objectif est de séquencer, sur une période de huit ans, le génome de 4 500 espèces marines de métropole et des territoires ultramarins.
Ce projet AtlaSEA est coordonné par Hugues Roest Crollius, chercheur au CNRS et Patrick Wincker, directeur du Génoscope. Le Génoscope est le centre national de séquençage qui s’est chargé il y a plus d’une vingtaine d’années du génome humain et qui est désormais largement tourné vers le séquençage de la biodiversité. Il y a également de nombreux partenaires qui viennent étayer ce projet, et qui unissent leurs forces afin d’explorer la biodiversité marine que l’on connaît encore mal.
Comment vous y prenez-vous pour construire cet Atlas ?
Le projet ATLASea s’articule en trois chevrons :
![]()
Nous nous concentrons exclusivement sur la biodiversité française, en échantillonnant tout au long de la Zone Économique Exclusive (ZEE). La carte ci-dessus montre l’étendue des données dont nous disposons actuellement. La majorité de ces données est concentrée le long des côtes, avec quelques radiales correspondant aux campagnes récurrentes de l’Ifremer pour évaluer les stocks halieutiques. En effet, pour le projet ATLASea nous nous appuyons sur des moyens à la mer existants, c’est-à-dire ceux des stations marines ainsi que ceux mobilisés par les campagnes Ifremer. Notre échantillonnage est structuré par l’exploration de divers gradients, tels que les zones de transition terre-mer ou encore les différents niveaux de préservation.
En métropole, nous prévoyons de séquencer 3 900 génomes, auxquels s’ajouteront 600 génomes issus des zones ultramarines. L’année dernière, nous avons déjà mené une campagne d’échantillonnage en Nouvelle-Calédonie, et je me prépare à partir pour les îles périphériques de la Guadeloupe. D’autres campagnes sont également prévues, notamment à Saint-Paul et Amsterdam, en Polynésie, à Mayotte… Autant de territoires fascinants que nous avons à cœur d’étudier.
Vous dites séquencer 4 500 espèces, est-ce que c’est beaucoup, ou en tous cas suffisant pour représenter la biodiversité marine ?
Effectivement, la question mérite d’être posée ! Le long des côtes métropolitaines, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) répertorie 13 600 espèces, dont plus des trois quarts sont des animaux. Le quart restant se compose de plantes (comme la posidonie de Méditerranée ou les algues vertes et rouges), de chromistes, de champignons, et de quelques unicellulaires. Nous souhaitons explorer chacune de ces lignées pour produire des génomes.
Le saviez-vous ?
La biodiversité animale recouvre une grande diversité de groupes taxonomiques. Chez les organismes marins, les arthropodes sont le groupe le plus représenté, suivis par les mollusques, les annélides, et enfin les chordés, qui incluent les poissons. Lorsque l’on évoque la “biodiversité marine”, on pense souvent aux poissons, mais en réalité, il faudrait d’abord penser aux crevettes, aux vers et aux mollusques !
La vie est apparue dans les océans, et de nombreuses lignées ne se trouvent que dans le milieu marin. D’un point de vue phylogénétique, il est donc extrêmement intéressant pour nous de pouvoir produire des génomes pour chacun de ces grands groupes.
En définitive, nous travaillons, bien sûr, sur les groupes taxonomiques les plus représentés, mais nous veillons également à échantillonner au sein de chaque groupe pour refléter au mieux la diversité du vivant.
Concrètement, comment se passe la récolte de données sur le terrain ?
Nous allons chercher les organismes sous l’eau soit en plongée soit à l’aide d’engins tels que des dragues de 80 cm, puis nous les ramenons à terre où nous avons mis en place une chaîne de tri. Les échantillons ramenés sont fractionnés par classe de taille à l’aide d’une série de tamis. Chaque fraction de taille est triée par grand phylum puis les taxonomistes identifient les spécimens le plus finement possible. Ensuite chaque spécimen vivant est photographié, afin de conserver une information sur ses couleurs avant d’être conservé dans l’alcool qui les fait disparaître. Nous nous attachons donc à documenter toutes ces étapes.
Pourriez-vous nous donner un exemple de toute cette chaîne de procédés, de la capture sur le terrain jusqu’à la mise en ligne du génome ?
Bien sûr ! Je vous invite à me suivre à travers le parcours de la praire Venus verrucosa, un mollusque bivalve, et première espèce intégrée dans le projet ATLASea.

Source : Dominique Horst
En avril 2022, ce spécimen a été récolté sur le terrain, à la station marine de Roscoff. Après la récolte, une phase d’identification a eu lieu avec le soutien de notre réseau de taxonomistes (pour la praire, cette étape n’était pas trop complexe). Ensuite est venu le séquençage du génome. Comme le séquençage est une initiative internationale, nous devons d’abord vérifier que la praire n’est pas déjà en cours de séquençage dans un autre projet. Il s’est avéré qu’elle faisait partie des espèces d’intérêt pour le projet Darwin Tree of Life, mais comme nous avons été les premiers à la collecter, nous avons pu lancer notre propre séquençage.
Les spécimens ont été photographiés, puis le Génoscope a pris le relais. Les tissus ont été prélevés avec soin pour éviter toute contamination, puis l’ADN a été conservé à l’aide de la technique de congélation rapide (“flash freezing”). Cette méthode, qui consiste à plonger le spécimen dans de l’azote liquide et à le conserver à -80°C permet d’éviter la dégradation de l’ADN. Les tissus de cette praire ont ensuite été analysés avec différentes techniques de séquençage en parallèle pour établir son génome de référence. L’objectif est d’obtenir la carte chromosomique complète de chaque séquence, en utilisant la technique HiC, ainsi qu’une grande profondeur de séquençage pour garantir la précision des données. Pour annoter les génomes et comprendre la fonction des gènes, la méthode la plus efficace est d’extraire et séquencer l’ARN. Au total, au moins quatre séquençages différents sont réalisés en parallèle pour chaque spécimen.
Et voilà, notre praire est désormais le premier génome entièrement séquencé du projet ATLASea ! Elle est désormais répertoriée sur un tableau de bord public (ici !), où l’on peut retrouver le génome obtenu, ainsi que visualiser une carte de distribution de l’espèce, semblable à celles produites par le GBIF (Global Biodiversity Information Facility, soit le Système mondial d’information sur la biodiversité).
Ok j’ai compris, séquencez-les tous ! C’est bien beau, mais les séquencer pour quoi faire ?
Ce projet nous permet de plonger au cœur de la taxonomie, un enjeu majeur pour la recherche. Aujourd’hui, environ 250 000 espèces ont été découvertes dans le milieu marin, et chaque année, en moyenne, 2 700 nouvelles espèces s’ajoutent à cette liste. On estime que la biodiversité marine encore inconnue est aussi vaste que celle des milieux terrestres. Ainsi, on évalue qu’il reste environ 80 % de la biodiversité marine à découvrir.
Au-delà de l’intérêt taxonomique, cette vaste banque de données génomiques que nous construisons peut avoir de multiples applications, comme en phylogénomique ou encore en génomique comparative. Dans le cadre des PEPR, l’ANR va lancer des appels à projets thématiques que nous avons choisi d’articuler autour de deux axes :
Tant de possibilités intéressantes en perspective !
![[Biodiversité, une coordination européenne et internationale] (Re)découvrez l’Ipbes](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/11/ipbes-11.png)
À quelques jours de sa 11e plénière et de la sortie de 2 nouveaux rapports : l’Ipbes !


Face à cette urgence, un constat s’impose : il est impératif de protéger la biodiversité marine. Dans ce contexte, la création d’aires marines protégées (AMP) est devenue une priorité mondiale. Toutefois, leur efficacité à protéger durablement la biodiversité reste une question complexe, soulevant des interrogations sur leur mise en place, leurs statuts et leurs impacts réels. Embarquons ensemble pour un périple au fil de l’eau, à travers des articles scientifiques publiés récemment et issus, pour la plupart, de travaux permis par la FRB à travers son Cesab.
![[Aires marines protégées] Des rares opportunités cartographiées à l’échelle globale](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/04/mouillot_parc_marin_cap_course-scaled.jpeg)
Les facteurs socio-économiques ayant plus d’influence que les facteurs environnementaux dans la mise en place des aires protégées, identifier les zones favorables et défavorables à l’implémentation de nouvelles aires protégées en tenant compte de ces critères permettra une stratégie de conservation plus réaliste et efficace.
Pour obtenir ces cartes d’opportunités et de contraintes locales en conservation, le groupe de chercheurs comprenant des scientifiques de l’Université de Montpellier, de l’EPHE-PLS, du CNRS et du CEA a divisé la surface du globe en près d’un million de cellules de 10 x 10 km. Pour chacune de ces cellules ils ont obtenu des données relatives à des facteurs environnementaux mais aussi socio-économiques, en se basant sur plus de 18 bases de données mondiales différentes. Ces données ont servi à construire un modèle prédictif qui estime la probabilité qu’une zone du globe soit protégée en fonction des différents facteurs étudiés, qu’ils soient environnementaux (température, altitude, précipitations par exemple) ou socio-économiques (PIB, indice de développement humain, présence d’ONG locales etc.).
Même sans information sur la biodiversité d’une zone, il est possible d’inférer de manière très fiable la probabilité de présence d’une aire protégée en n’utilisant qu’un petit groupe de facteurs socio-environnementaux. Les facteurs socio-économiques montrent même une plus grande importance que les facteurs environnementaux dans ces modèles prédisant la mise en place de futures aires protégées. Par exemple l’indice de développement humain et le nombre d’ONG favorisent la présence d’aires protégées terrestres alors qu’en mer l’accessibilité et la dépendance aux stocks de poissons sont les principaux obstacles de blocage à la mise en place de nouvelles aires marines protégées.
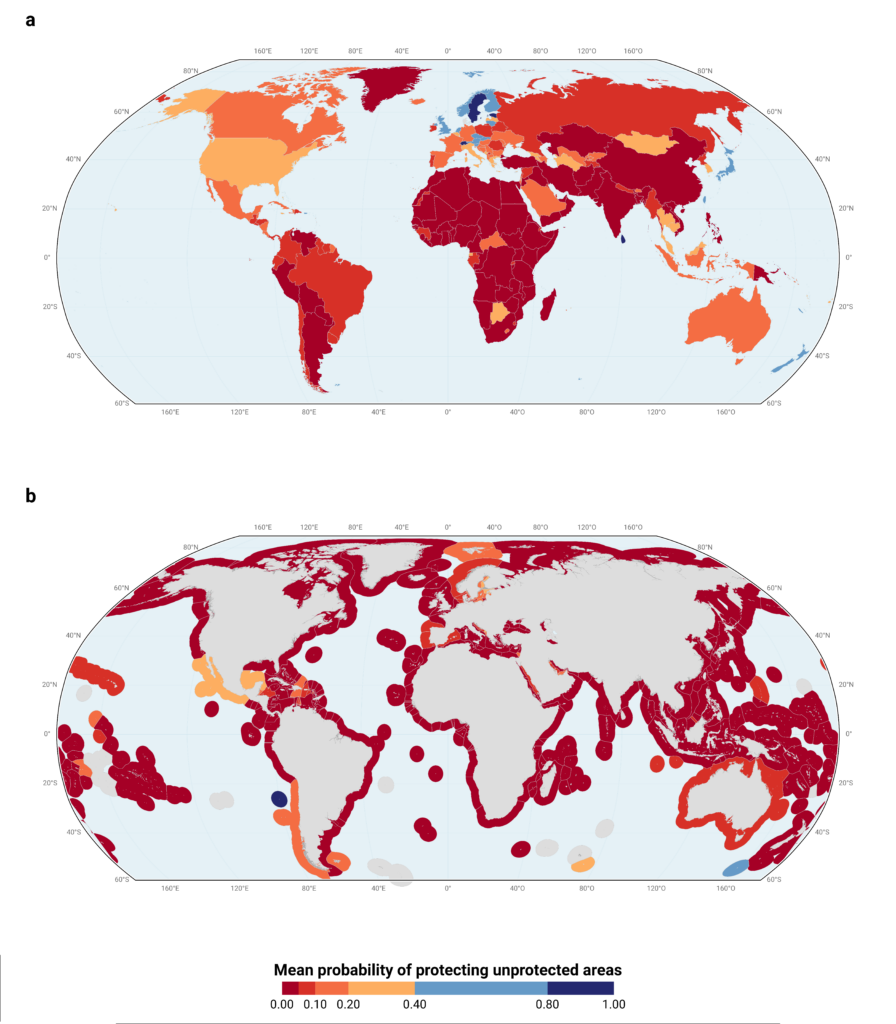
Ce modèle a ensuite été utilisé pour cartographier les zones où les besoins en conservation des vertébrés (poissons, mammifères et oiseaux) sont les plus urgents mais aussi celles où les facteurs socio-économiques limiteraient ou favoriseraient la mise en place d’une aire protégée.
Pour aller + loin
Quid du devenir des zones de conservation prioritaires mais qui cumulent également les critères socio-économiques défavorable au statut d’aires protégées ? Bien souvent, les enjeux sociaux-économiques et les besoins des populations locales sont indissociables de la mise en place d’aires protégées. Ainsi, en Afrique et en Asie, certaines zones à haute valeur de conservation restent impossibles à protéger, face aux enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles. Implémenter les facteurs socio-économiques s’avère donc primordial pour optimiser la mise en place des zones de protection, dont les décisions actuelles se concentrent majoritairement sur les facteurs environnementaux qui influencent la biodiversité. Encore une preuve qu’assurer des conditions sociales et économiques minimales est un prérequis pour la mise en place de stratégies de conservation efficaces et durables.
Aux acteurs et décideurs politiques maintenant de prendre pleinement la mesure des actions nécessaires pour parvenir à l’objectif de 30% d’aires protégées d’ici à 2030.
Cette étude est le fruit d’un travail collaboratif animé par la FRB et son Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) au sein des groupes Pelagic et Parsec. Ce travail a été permis grâce aux financements de la ZSL, du WWF, de l’Université de Montpellier et aux Cesabbatic de Jessica Meeuwig et Tom Letessier.
![[Biodiversité, une coordination européenne et internationale] (Re)découvrez la CDB](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/10/Logo-CDB.jpg)
Premier arrêt sur image, à quelques semaines de la Cop16 : vous reprendrez bien un peu de CDB ?

Derrière le terme de finance durable s’affiche l’ambition d’une finance qui intègre dans ses logiques les défis environnementaux et sociaux. En reprenant les concepts de l’Ipbes portant sur les changements transformateurs, il s’agit de combiner amélioration du bien-être humain et respect des limites planétaires, notamment maintien et restauration de la biodiversité. En cela, la finance a un rôle majeur dans le devenir des systèmes de production, économiques, en relation avec l’ensemble des parties prenantes.
La finance durable doit en particulier contribuer à optimiser le potentiel de solutions fondées sur la nature, se préoccuper de l’intégrité des écosystèmes, à soutenir les pratiques les moins impactantes et son corollaire, ne plus soutenir les pratiques les plus destructrices, avec des mécanismes de financement innovants. Les crédits biodiversité en sont un exemple, intégrés dans le Cadre mondial de la biodiversité, en particulier au sein de la cible 19 dédiée à l’augmentation sensible et progressive des ressources financières permettant la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. Ils sont d’ailleurs à l’ordre du jour de la 16e Conférence des Parties (Cop16) de la Convention pour la diversité biologique (CDB) d’octobre 2024.
Adopté en décembre 2022 dans le cadre de la Cop15 de la Convention sur la diversité biologique, le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal vise à inverser la tendance de déclin du vivant d’ici 2030. À travers 4 objectifs et 23 cibles, il définit les pistes d’action :
Crédits ou certificats biodiversité : de quoi parle-t-on ?
Les crédits biodiversité ont été définis comme un instrument financier qui représente une unité certifiée, mesurée et fondée sur des preuves de résultat positif en matière de biodiversité, durable et additionnel par rapport à ce qui se serait produit autrement (d’après BCA, 2024). Cette définition nécessite d’être adaptée ou précisée en fonction des cas d’usages des crédits : par exemple la conservation ou la restauration.
Pour éclairer la mise en place de ce type de mécanisme, la FRB, le MNH et Carbone 4 ont publié un rapport sur les risques et opportunités associés aux certificats biodiversité. Le terme certificat est lié à un gain positif constaté pour la biodiversité. Il nécessite un processus de certification (non abordé dans le cadre du programme de recherche présenté ci-après).
Les marchés volontaires de crédits biodiversité sont en cours de développement. Sur le plan international, ils font l’objet d’une attention politique croissante.
Un programme de recherche sur les certificats biodiversité
Le MNHN, la FRB et Carbone 4 ont lancé en novembre 2023 un programme de recherche sur les certificats biodiversité.
L’économie moderne et ses dogmes jouent un rôle majeur dans l’effondrement de la biodiversité.
Dans une opinion publiée sur le site de la FRB en juin 2020, le chercheur Harold Levrel préconisait de passer d’une “économie de la biodiversité” à un “projet économique de conservation de la biodiversité”. Il recommandait que les objectifs légaux de conservation de la biodiversité soient envisagés comme le point de départ des réflexions en matière de transition écologique des secteurs économiques.
Dans ce nouveau contexte, un acteur économique “emprunte” à la biodiversité – qui est un bien commun – de quoi développer ses activités et doit se préoccuper des modalités de “remboursements” de ces “emprunts”. Au-delà de la “nécessité d’une certaine refonte” des outils de régulation et d’évaluation économique selon Harold Levrel, ce changement de paradigme impose aussi la recherche de nouveaux mécanismes financiers comme les certificats biodiversité. Ces derniers peuvent présenter des risques et des opportunités et doivent faire preuve d’une gouvernance adéquate.
Pour fiabiliser le mécanisme, le programme de recherche FRB-MNHN-C4 sur les certificats biodiversité comprend deux volets complémentaires :
Plus précisément, cet axe s’intéresse à l’évaluation des gains biodiversité obtenus par des pratiques favorables à la biodiversité. La méthode est basée sur l’hypothèse que, sur la base du partage de leur expertise en matière de biodiversité, des chercheurs peuvent aboutir à un consensus pour interclasser des pratiques favorables à la biodiversité et leur affecter un gain biodiversité. La méthode est donc basée sur une taxonomie des pratiques pour un socio-écosystème donné et la possibilité d’affecter à chacune de ces pratiques un gain biodiversité relatif attendu.
Le livrable de ce programme de recherche sera une grille de référence des gains biodiversité attendus associés à chacune des pratiques identifiées pour deux socio-écosystèmes test : les écosystèmes agricoles et les écosystèmes forestiers en milieu tempéré.
Un projet favorable à la biodiversité est décomposé en une somme de pratiques bénéfiques par socio-écosystème.
La FRB a réalisé une revue de la littérature scientifique sur les risques et opportunités qui découlent de la mise en place d’un mécanisme de crédits ou certificats biodiversité. Cette revue a été intégrée à un travail plus global, publié en septembre 2024, afin de pouvoir être communiqué à la Cop16 de la CDB.
L’approche scientifique contribue ainsi à une meilleure compréhension de ces mécanismes, dans la perspective de mettre en œuvre des crédits biodiversité qui contribuent de façon crédible et significative aux objectifs globaux pour la biodiversité, tout en étant juste sur le plan socio-économique.
Focus sur les principaux risques (et opportunités) :

Ces valeurs doivent nous aider à percevoir que nous sommes des acteurs parmi d’autres, dans des systèmes écologiques d’une grande diversité et complexité ; elles doivent nous aider à distinguer les enjeux et finalités associés aux « contributions matérielles » de la nature, résolument anthropocentrées, le plus souvent développés aux dépens des écosystèmes naturels et de la biodiversité sauvage. Ces valeurs doivent nous servir à percevoir les enjeux et finalités associées aux « contributions régulatrices » comme la régulation du climat, la pollinisation, le contrôle biologique, etc. des écosystèmes « naturels » tels que les forêts et les zones humides, qui eux sont au bénéfice aussi bien des humains que de la biodiversité sauvage. Intégrer cette diversité de valeurs doit nous permettre de mieux penser la question de la fin et des moyens. Se préoccuper des « contributions régulatrices » et des « contributions immatérielles » de la nature peut ainsi être une fin en soi, une façon de préserver le bien-être humain. Cette préoccupation peut aussi être un moyen au service d’une autre finalité : la protection de la biodiversité sauvage. L’ambiguïté de l’ambition a des avantages, en permettant de bâtir des consensus plus solides, entre des parties prenantes qui envisagent la nature de manières fort différentes, d’étroitement utilitariste à transcendantale.

· S O M M A I R E ·
·
À travers divers contextes pour la biodiversité, utilisation durable, conservation, protection et restauration de la biodiversité, ce numéro montre la manière dont les valeurs de la nature, leur diversité, sont embarquées dans nos vies, ouvrant de nouvelles perspectives
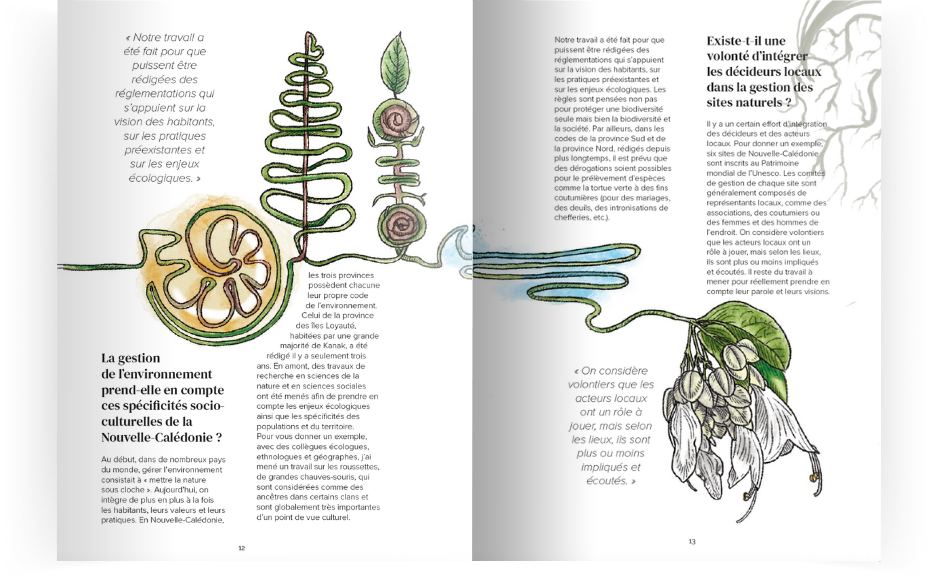
·
· T R A N S M E T R E P A R L ‘ I M A G E ·
Le dessin, qu’il soit scientifique ou artistique, intrigue, interpelle et rassemble. Lors d’expéditions, il est à la fois vecteur de connaissances scientifiques et source d’échanges entre chercheurs, artistes et populations locales. Il favorise les liens autour des savoirs et usages traditionnels. Par ces différentes illustrations, les artistes naturalistes Delphine Zigoni et Julien Norwood partagent leurs rencontres lors d’une expédition menée en Guyane française en 2021. Cacaoyer, bois-canon et arouman, à travers ces trois plantes emblématiques, ils dévoilent les pratiques et usages des habitants rencontrés. Les liens que les populations locales entretiennent depuis toujours avec l’environnement, dans lequel humains et non-humains cohabitent, sont des exemples de savoirs traditionnels, où l’usage durable favorise la protection de la biodiversité.

· F A V O R I S E R L E L I E N E N T R E C H E R C H E U R S & A R T I S T ES ·
Les chercheurs et chercheuses
Didier Bazile, chercheur au Cirad et membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Arnaud Béchet, directeur de recherche à la Tour du Valat · Aurélien Besnard, directeur d’études de l’école pratique des hautes études au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive · Yoann Bressan, chargé de recherche à l’Office français de la biodiversité (OFB) · Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Géraldine Derroire, chercheuse au Cirad · Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement (Inee) du CNRS · Bruno Hérault, chercheur au Cirad · Florence Pinton, professeure de sociologie à AgroParisTech · Camille Piponiot, chercheuse au Cirad · Xavier Poux, ingénieur agronome et docteur en économie rurale · Catherine Sabinot, docteure en ethnoécologie au Museum national d’Histoire naturelle · Plinio Sist, directeur d’unité au Cirad · Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Virginie Maris, chargée de recherche CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (Cefe)
/
Les artistes
Julie Borgese · Julien Norwood · Melody Ung · Delphine Zigoni

Les travaux menés par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), notamment à travers son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), apportent de multiples éclairages pour une meilleure compréhension de la manière dont les espèces s’adaptent aux changements globaux, des zones à haut potentiel de protection, mais aussi des enjeux de gouvernance (pouvoir, justice, impacts et efficacité des mesures, etc.), de la place des parties prenantes, etc.
Retour sur les derniers articles publiés ces dernières semaines dans des revues scientifiques majeures (Nature Ecology and Evolution, Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), One Earth, etc.), offrant un regard pluriel afin de mieux comprendre le présent, préparer l’avenir et affiner la définition des efforts nécessaires à la réussite des défis de la transition écologique.
L’imidaclopride est l’insecticide de la famille des néonicotinoïdes le plus utilisé au monde. Commercialisé en France depuis 1991, il a progressivement été interdit par l’Union européenne (UE) et pour toutes cultures en 2018. Il a depuis fait l’objet de dérogations, notamment pour les cultures de betteraves sucrières, et son interdiction continue d’être contestée par plusieurs syndicats agricoles. Quand et où a-t-il été utilisé en France ? C’est ce que révèle une étude parue en juin dans la revue Science of the Total Environment, première étape d’un projet qui vise à mieux comprendre l’impact de l’imidaclopride sur la biodiversité.
Lire l’article :
Un des axes d’action de l’Union européenne pour réduire ses émissions de carbone consiste à renforcer le recours au transport fluvial par voies navigables intérieures (fleuves, rivières, canaux). Le transport de marchandises par bateau émet en effet moins de carbone que par la route. Or le développement des infrastructures nécessaires modifie les caractéristiques éco-morphologiques des cours d’eau douce avec de sérieux risques sur leur biodiversité. Dans un contexte de déclin avéré de la biodiversité, une telle mesure ne peut être mise en œuvre sans que ses impacts ne soient compris ni que des solutions pour limiter les pressions exercées ne soient pensées en accord avec les objectifs et cibles du Cadre mondial pour la biodiversité. C’est sur ce sujet que travaille depuis 4 ans un groupe de chercheurs et chercheuses internationaux dont les résultats sont sortis en mai dernier dans la revue Nature Ecology and Evolution.
Lire l’article :
Du fait du changement climatique et de l’augmentation globale des températures, la distribution des surfaces gelées (glace, neige, pergélisol) régresse à un rythme effréné sur terres et dans les océans. Ceci n’est pas sans conséquence sur la biodiversité et ses réponses adaptatives sont encore mal connues. Or, mieux comprendre ces réponses s’avère indispensable pour mieux anticiper le devenir de la biodiversité et de nos sociétés. Ces dernières semaines, trois papiers majeurs sont parus à ce sujet dans des revues scientifiques (Nature Reviews Earth & Environment, Proceedings of the National Academy of Science, Global Change Biology) : le fruit d’un travail conséquent mené par un consortium de 23 chercheurs et chercheuses de 8 nationalités différentes, réunis au sein du groupe FRB-Cesab Bioshifts.
Lire l’article :
Protéger les océans est une nécessite environnementale mais rencontre d’énormes difficultés sociales, politiques, de justice, etc. Réunissant 23 scientifiques de 12 nationalités différentes, le projet de recherche Blue justice, financé par la FRB au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité (Cesab), propose un cadre de réflexion pour identifier et lever ces asymétries qui constituent des entraves à la justice environnementale. Dans une étude parue en mai dernier dans la revue Nature Ecology and Evolution, le groupe propose trois pistes d’amélioration : réduire les asymétries de pouvoirs en matière d’accès à la biodiversité et aux services écosystémiques, rapprocher politiques publiques et pratiques, développer les capacités d’anticipation et de scénarisation.
Lire l’article :
Face au déclin de la biodiversité, les efforts de conservation se multiplient dans le monde entier et des études récentes rassurent quant à leur efficacité pour ralentir le déclin voire améliorer l’état de la biodiversité (Langhammer et al., 2024 dans Science). Cependant, la plupart des évaluations se concentrent uniquement sur les mesures écologiques, sans tenir compte ou très peu de la manière dont les projets sont construits, et des implications politiques et sociales de la conservation. Comment les peuples autochtones et communautés locales sont impliqués dans la conservation ? Comment leur influence, leurs connaissances et leurs actions contribuent au succès des projets ? Face aux manques de connaissances, ce sujet fait aujourd’hui débat dans le monde de la conservation. Un groupe de chercheurs et chercheuses internationaux, dont plusieurs membres de la Commission des Politiques environnementales, économiques et sociales de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), se sont réunis pendant plusieurs années au sein du Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité, le Cesab de la FRB. En mai 2024, ils publient une importante étude dans One Earth, s’appuyant sur près de 650 articles scientifiques. Ils apportent ainsi une meilleure compréhension de ce qui fonctionne le mieux, pour les humains et pour la nature et appellent à un changement profond en faveur d’une justice sociale et d’une gouvernance équitable.
Lire l’article :
La complexité des enjeux de conservation de la biodiversité a conduit à un engagement accru des parties prenantes par le biais de processus participatifs, mais souvent sans que l’on comprenne clairement comment ou si ces processus conduisent effectivement à de meilleurs résultats en matière de biodiversité. Depuis 2021, les membres du projet FRB-Cesab PowerBiodiv tentent de mieux comprendre comment les multiples dimensions du pouvoir imprègnent ces processus et peuvent conduire à leur amélioration dans un objectif de conservation de la biodiversité. Une quinzaine de chercheuses et chercheurs internationaux mettent ainsi en commun leurs expertises en science politique, sociologie, biologie de la conservation, géographie, facilitation, gestion de conflits, écologie et anthropologie. À la suite de la publication de certains de leurs résultats dans la revue People and Nature, rencontre avec Lou Lecuyer, post-doctorante au Cesab de la FRB sur ce projet.
Lire l’article :

Environ 20 000 observations de communautés de poissons et de macro-invertébrés d’eau douce sur 32 ans ont été combinées avec des données sur le trafic intérieur en eau douce et les infrastructures de navigation (ports, écluses, canaux) pour mieux comprendre l’impact de la navigation sur la biodiversité. Ce colossale travail de synthèse a été mené grâce au projet de recherche Navidiv, financé par la FRB à travers son Centre de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité (Cesab). Les résultats attestent de l’impact du trafic fluvial sur la biodiversité. Deux conséquences en particulier ressortent, à savoir :
Ces conséquences affectent particulièrement les populations d’espèces rares et celles vivant et se reproduisant dans le lit des rivières. Il ressort également de cette étude que le trafic s’avère être un indicateur pour la biodiversité beaucoup plus important que les infrastructures de navigation, en faisant ainsi l’aspect le plus important du secteur de la navigation à prendre en compte en ce qui concerne les coûts liés à la biodiversité.
Outre ces relations entre navigation et biodiversité, les chercheurs et chercheuses se sont demandé si la pression exercée par le transport fluvial sur la biodiversité était amplifiée dans les paysages modifiés par les humains. Dans les paysages largement anthropisés (milieux urbains, terres agricoles par exemple), l’impact négatif du transport fluvial est fortement amplifié pour les communautés de poissons. La diminution de la diversité taxonomique et des traits est plus prononcée dans les zones où la couverture urbaine et agricole est plus importante. D’autre part, les effets négatifs liés aux canaux et cours d’eau redressés sont plus marqués dans les zones où la forêt riveraine a disparu.
Ces résultats mettent en évidence le coût potentiel pour la biodiversité qu’il est nécessaire de prendre en compte face à une augmentation européenne de la navigation en eau douce dans les années à venir. Ces effets négatifs sur la biodiversité sont probablement plus importants qu’ils ne pourraient l’être si la biodiversité avait été prise en compte dans la conception du développement de ces infrastructures. Dès lors, investir davantage dans la gestion et la réhabilitation des voies navigables et dans l’atténuation des effets les plus néfastes de la navigation est indispensable. La création d’habitats à faible débit et de zones où l’impact des vagues des navires est limité pourrait atténuer les pressions sur les espèces vivant dans les lits des rivières. La réduction des polluants issus de la navigation et l’augmentation des habitats riverains le long des voies navigables pourraient également constituer des mesures d’atténuation cruciales. Un nouvel exemple de la nécessité de penser conjointement les enjeux climatiques et biodiversité.

La littérature scientifique démontre que l’imidaclopride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, de par son usage, contamine les milieux et est responsable du déclin de la biodiversité. Ces néonicotinoïdes, famille d’insecticide la plus utilisée au monde, sont interdits en Europe depuis 2018 mais font l’objet de nombreuses dérogations ou demandes de dérogations dans de nombreux pays. Alors que les études en laboratoires montrent les effets indéniables de ces insecticides sur un grand nombre d’espèces allant des insectes aux mammifères, l’évaluation de leurs impacts sur l’environnement restent peu étudiée.
Depuis leur introduction dans les années 1990, les néonicotinoïdes sont devenus les insecticides les plus vendus au monde. Leurs utilisations, principalement sous forme d’enrobage des semences, ont été présentées comme des pratiques à faible risque pour l’environnement. Pourtant, il a depuis été démontré qu’ils contaminent les environnements terrestres et aquatiques, affectant par conséquent la biodiversité. Commercialisé en France dès 1991, l’imidaclopride est le principale néonicotinoïde utilisé en France. Il a ensuite été réglementairement interdit en 2013 dans l’Union européenne (UE) pour les cultures florales, puis en 2018 pour toutes les cultures. Toutefois, des dérogations annuelles ont été accordées pour les cultures de betteraves sucrières entre 2021 et 2022. Si l’ensemble des néonicotinoïdes, dont l’imidaclopride, a été complètement interdit pour toutes cultures dans l’UE en 2023, cette décision est néanmoins toujours contestée par plusieurs syndicats agricoles.
En effet, seuls 2 % à 20 % des néonicotinoïdes enrobant les semences sont réellement absorbés par les cultures. Le reste demeure dans le sol ou s’infiltre dans les eaux de surface. Solubles dans l’eau, les molécules sont ainsi transportées et contaminent des écosystèmes aquatiques et terrestres, même dans les zones reculées où les néonicotinoïdes n’ont pas été appliqués, comme les prairies, les haies et les champs cultivés en agriculture biologique. En raison de cette contamination généralisée et de leur efficacité à tuer les insectes non ciblés à très faibles doses, ces insecticides sont actuellement identifiés comme une cause majeure du déclin des insectes et autres invertébrés terrestres et aquatiques dans diverses parties du monde. De cette manière, l’usage de néonicotinoïdes contribue au déclin des espèces se nourrissant d’insectes, tels que les oiseaux et les poissons, en plus de leurs effets mortels sur de nombreux organismes.
Malgré la reconnaissance du risque de ces produits pour la biodiversité, leur utilisation temporelle et spatiale reste mal connue dans de nombreux pays. Ces informations sont pourtant essentielles pour évaluer les impacts potentiels de ces pesticides sur la biodiversité et pour orienter les mesures visant à établir des zones protégées ou à restaurer la biodiversité.
Dans une étude parue en juin 2024 dans la revue Science of Total Environment, un vaste ensemble de données publiques a été agrégé pour caractériser l’utilisation temporelle et spatiale en France de l’imidaclopride et des échantillonnages sur la contamination de l’eau entre 2005 et 2022 ont été analysés afin d’évaluer la pression de l’imidaclopride sur l’environnement.
Les résultats de cette étude montrent que l’usage de l’imidaclopride apparait plus important dans les régions nord et ouest en France métropolitaine, particulièrement en lien avec les cultures de céréales et de betteraves. De plus, il s’avère que la contamination des cours d’eau à l’imidaclopride est bien corrélée aux ventes, et plus élevée dans les départements traversés par la Loire, la Seine et la Vilaine, avec des concentrations suffisantes pour pouvoir impacter la biodiversité de ces territoires. Cette corrélation est plus importante pour les départements à sols alluviaux, à grès ou rocheux. La contamination est également plus marquée dans les territoires à plus fortes précipitations cumulées. Elle a été stable entre 2005 et 2011, en augmentation de 2012 à 2018, et en baisse entre 2018, année où l’usage de cette molécule a été interdit.
Cette étude est la première évaluation de la pression de l’imidaclopride sur la biodiversité en France et montre une corrélation spatiale et temporelle entre pratiques agricoles et niveau de contamination des eaux douces. Elle est une étape préalable nécessaire à la quantification des impacts sur la biodiversité de l’utilisation de ce néonicotinoïde. Ces travaux montrent que les niveaux de contamination présentent des risques potentiels pour la biodiversité, et que cette contamination provient bien de l’utilisation de cette molécule pour les cultures végétales. Ces résultats permettront, dans la suite du projet, d’estimer le préjudice environnemental induit par l’utilisation de cette molécule en France métropolitaine et d’identifier les zones prioritaires pour les mesures d’atténuation et de restauration.

Le mot biodiversité a été formulé pour la première fois en 1985 par le biologiste Walter G. Rosen lors du Forum national sur la biodiversité1. L’objectif de cet événement était de faire sortir le concept de diversité biologique de la communauté scientifique et de sensibiliser les économistes, les agronomes, les experts et les médias à la sauvegarde de la diversité biologique2. L’objet de cet article est de s’intéresser à son émergence à la télévision française jusqu’en 2009, soit deux ans après la tenue du Grenelle de l’environnement.

La corruption est un des obstacles régulièrement mis en avant mais il est loin d’être le seul. D’autres processus sont également à l’œuvre et bien plus difficiles à combattre, car ils sont légaux et présentés comme légitimes. C’est le cas par exemple de la composition des organes de gouvernance lorsqu’ils incluent majoritairement des acteurs privés au fort pouvoir économique, des acteurs publics et des gouvernements dont la priorité reste le développement économique. Certains groupes, voire certains pays, en sont ainsi régulièrement exclus. La mise en place des zones marines protégées est un bon exemple de ces processus de décision qui manque d’inclusivité : celles avec des niveaux de protection élevés continuent d’être mises en œuvre préférentiellement dans les zones à faible intérêt économique pour les secteurs industriels, mais à fort intérêt économique et patrimoniaux pour les communautés côtières qui dépendent fortement des ressources océaniques.
Pour contrer ces mécanismes, les scientifiques préconisent un recours au concept de justice procédurale, qui permet de diminuer les asymétries de pouvoir en donnant la parole aux parties prenantes silencieuses (les plus pauvres, les femmes, les jeunes, la biodiversité). Autre piste abordée : défragmenter la gouvernance pour moins travailler en silos et veiller à ce que les décisions favorables à un enjeu humain (par exemple la production d’énergie renouvelable) ne nuisent pas de façon grave et irréversible à un autre enjeu humain (par exemple la biodiversité ou la pêche artisanale).
La participation du plus grand nombre aux décisions nécessite un changement profond de culture et de processus qu’il faut accompagner, mais qui est tout à fait possible.
Le savoir, la connaissance et les données qui sont utilisées pour prendre les décisions sont également un point clé des injustices environnementales. Les impacts sociaux et environnementaux des activités sont souvent négligés par rapport aux retombées économiques de ces mêmes activités. De même, les décisions doivent considérer tous les services écosystémiques potentiellement favorisés ou impactés. S’agissant d’océan, la pêche est souvent au cœur des débats. Par ailleurs, il est important de ne pas appliquer des principes de justice simplifiés et généralisés (par exemple des pays du Nord vers les pays du Sud). Les différences et les singularités entre pays ou entre territoires sont importantes et doivent être prises en compte pour que les actions soient adaptées à chaque contexte socio-environmentalo-économique.
Au niveau mondial comme au niveau local, des actions sont possibles. Dans le premier cas, un organisme intergouvernemental holistique sur les océans ou un réseau d’organismes existants, intégrant une diversité d’acteurs et leur système de connaissance, pourrait voir le jour afin de garantir une meilleure coordination intersectorielle fondée sur des données probantes et des valeurs. Dans le second, une planification territoriale marine intégrée et inclusive doit inclure tous les acteurs, intégrer les données sociales et environnementales et garantir une répartition juste des bénéfices. En parallèle, fournir des moyens à la recherche et aux chercheurs et chercheuses des différents pays permet de garantir une meilleure évaluation des bénéfices économiques et immatériels adaptés au contexte.
Enfin, le dernier point de levier consiste en l’identification des bénéficiaires de la ressource : sont-ils nombreux ou limités ? Équitable ou concentrés ? Le mécanisme international de partage juste et équitable des avantages issus de la biodiversité ne concerne que les ressources génétiques : les scientifiques préconisent dans l’étude de l’étendre aux ressources marines (les poissons, les algues, etc.) et aux services écosystémiques que nous retirons de l’océan (la régulation du climat, le tourisme, etc.). D’autre part, les gouvernements nationaux, les agences multilatérales et les organisations internationales peuvent investir dans des pratiques organisationnelles qui déclenchent le dialogue sur le pouvoir, notamment en invitant des entités indépendantes à revoir leurs pratiques.
Des changements mineurs dans le fonctionnement global du système sont régulièrement mis en œuvre. Ils sont importants, pour initier l’engagement de tous les acteurs, mais restent insuffisants. C’est en effet un véritable changement transformateur profond qui est à présent nécessaire pour augmenter l’équité et la justice bleue.
![[Biodiversité et changement climatique] Mieux comprendre la redistribution du vivant pour mieux anticiper l’avenir](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/06/Bioshifts-article.jpg)
Ces dernières semaines, trois papiers majeurs sont parus à ce sujet dans des revues scientifiques différentes (Nature Reviews Earth & Environement, Proceedings of the National Academy of Science, Global Change Biology) : le fruit d’un travail conséquent mené par un consortium de 23 chercheurs et chercheuses de 8 nationalités différentes, réunis au sein de BioShifts, un groupe de recherche financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), à travers son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab).
En montagne, les neiges éternelles marquent une limite entre le royaume des glaces de l’étage nival et les étages sous-jacents. C’est la manifestation visible et tangible de l’isotherme du 0°C. Avec le réchauffement, l’isotherme du 0°C remonte inexorablement, et de manière accélérée, vers les sommets en altitude et vers les pôles en latitude, et avec lui la limite des surfaces gelées. Alors qu’il était jusqu’à présent largement accepté que les migrations du vivant suivaient cette même logique, une étude publiée en avril par le consortium BioShifts dans la revue Nature Reviews Earth & Environment montre que seulement 59 % des migrations d’espèces documentées dans la littérature scientifique sont conformes aux directions attendues (c’est-à-dire vers les pôles en latitude ou les sommets en altitude). En analysant les données publiées à travers plus de 250 études, les scientifiques confirment la migration des espèces mais révèlent qu’elles ne se déplacent pas toutes dans les mêmes directions (35 % partent même dans des directions opposées) ni même à la même vitesse que la migration des isothermes. D’autres paramètres que la température entrent donc en jeu pour expliquer les différences entre la redistribution et la vitesse de migration des espèces attendues et celles finalement observées.
Une première piste proposée par le groupe incite à considérer la connectivité spatiale des habitats et donc des isothermes. Celle-ci est par exemple plus importante et resserrée en montagne que dans les régions de grandes plaines, ce qui pourrait expliquer des différences de vitesse de migration (cf J. Lenoir, PNAS 2024). La seconde piste concerne les traits d’histoire de vie ou caractéristiques fonctionnelles des espèces. Dans une autre étude, parue cette année dans la revue Global Change Biology, les chercheurs et chercheuses du groupe BioShifts montrent cette fois que le degré d’exposition au changement climatique affecte différemment la redistribution des espèces en fonction de leurs caractéristiques fonctionnelles (durée de vie, capacités de dispersion, etc.). Bien que leur prise en compte soit complexe, ne pas les prendre en compte peut amener à conclure, à tort, que les traits d’histoire de vie ne sont pas importants. Un phénomène décrit avec précision dans l’étude qui dresse une feuille de route avec des recommandations adressées aux chercheurs pour mieux les intégrer par la suite dans leurs études.
Grâce aux méthodes pointues de synthèses de données et de connaissances, les travaux menés par les scientifiques du groupe Bioshifts offrent aujourd’hui une vision plus claire de la manière dont les espèces s’adaptent au changement climatique. Des informations précieuses pour perfectionner les scénarios et mieux éclairer les décideurs.

Depuis 2021, les membres du projet FRB-Cesab PowerBiodiv tentent de mieux comprendre comment les multiples dimensions du pouvoir imprègnent ces processus et comment cette compréhension peut conduire à leur amélioration dans un objectif de conservation de la biodiversité. Une quinzaine de chercheuses et chercheurs internationaux mettent ainsi en commun leurs expertises en science politique, sociologie, biologie de la conservation, géographie, facilitation, écologie et anthropologie. Fin mai 2024, une partie de leurs résultats a été publiée dans la revue internationale People and Nature. Rencontre avec Lou Lecuyer, post-doctorante sur ce projet.
Les travaux du groupe PowerBiodiv ont permis d’établir une typologie des formes de pouvoir, c’est notamment ce que vous mettez en avant dans le dernier article publié. Pouvez-vous nous expliquer le cadre conceptuel que vous proposez ?
Nous sommes partis du constat que, bien que l’importance des relations de pouvoir soit de plus en plus reconnue comme un facteur clé pour obtenir de meilleurs résultats dans les processus participatifs pour la biodiversité, peu de publications s’appuient sur la théorie existante ou expliquent comment prendre en compte le pouvoir. Nous avons donc exploré d’autres domaines, comme celui du développement, pour voir ce qui avait été écrit à ce sujet et avons décidé de nous inspirer du cadre théorique proposé par Just Associates en l’appliquant à des cas concrets sur lesquels nous avons travaillé.
Notre cadre reconnaît qu’il existe toujours plusieurs dimensions de pouvoir en jeu, parfois simultanément (cf Figure ci-après). Le “pouvoir sur” est ainsi constamment remis en question par le “pouvoir transformateur” (par exemple, les mouvements de résistance) et cela peut se manifester dans différentes arènes, de diverses manières, et à travers plusieurs échelles.
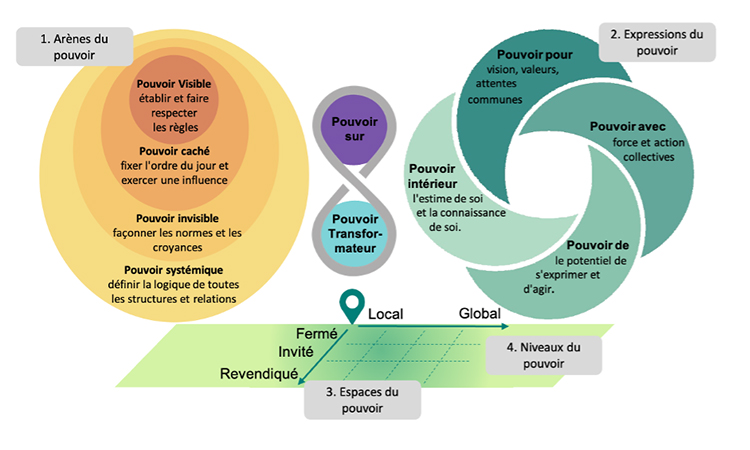
Figure : Cadre des dimensions multiples du pouvoir adapté du cadre du pouvoir de Just Associated (2023) et de l’Institute of Development Studies (Gaventa, 2006) et du Power Cube. (Adapté de Lecuyer et al. 2024)
Par exemple, dans le cas d’un processus participatif visant à décider des moyens de gestion d’un parc dans le nord de la Thaïlande, il fallait surmonter une forte dimension systémique. Les minorités ethniques y étaient perçues par les décideurs, employés du parc et personnes extérieures, comme inéduquées et utilisant des pratiques polluantes pour le bassin versant. Passer au-dessus de ces aprioris a demandé la mise en place d’une démarche qui prenait en considération les différentes dimensions du pouvoir – les femmes sont ainsi venues en plus grand nombre, permettant d’ouvrir plus largement l’espace de dialogue et mobilisant leur “pouvoir avec”. En parallèle, le directeur du parc a aussi utilisé une forme de “pouvoir de” en décidant de ne pas prendre parti à certaines étapes du processus, limitant l’impact possible (cf Figure). Dans un cas comme celui-ci, l’utilisation du cadre en amont des processus permettrait de mieux anticiper cela, en identifiant que, si les femmes viennent en plus grand nombre, elles sont plus à même de prendre la parole et en mettant donc en place les stratégies nécessaires pour faire venir plus de femmes ; ou bien de mettre des stratégies en place pour s’assurer de la participation des personnes qui ont les pouvoirs de décisions.
Quelle place tiennent les connaissances scientifiques dans ce cadre conceptuel ? En particulier, quelle est place est donnée à l’incertitude, à la fois comme composante systémique ou comme mécanisme d’influence, dans les dynamiques de pouvoir ?
Les connaissances scientifiques sont le fondement de notre cadre conceptuel, qui repose sur les travaux théoriques et empiriques de nombreux auteurs, notamment les travaux de Lukes sur les dimensions du pouvoir. Nous avons choisi cette représentation, car elle permet de considérer le pouvoir à différents niveaux : à la fois au niveau des acteurs (leur capacité à agir seuls ou en groupe) et au niveau structurel (intégré dans notre manière de percevoir et de penser le monde, ou dans la reconnaissance de certaines connaissances au détriment d’autres).
L’incertitude peut s’exprimer à différents niveaux. Dans les arènes du pouvoir, l’incertitude peut être utilisée pour maintenir le statu quo et repousser l’action, se manifestant ainsi par des stratégies cachées. Dans les dimensions du pouvoir, l’incertitude réelle peut affecter le “pouvoir de”, le manque de connaissance limitant la capacité d’agir.
Le pouvoir est souvent lié aux questions de connaissance et donc d’incertitude. Il est crucial de se demander quelles connaissances sont prises en compte, considérées comme légitimes, et influencent la prise de décision. Ces questions sont essentielles dans les processus participatifs pour la biodiversité.
Les résultats de vos recherches amènent à l’idée que le changement transformateur (concept fort de l’Ipbes) passe par un changement des dynamiques de pouvoir, pouvez-vous nous en dire davantage ? Quel enjeu y a-t-il notamment à prendre en compte davantage les non-humains dans ces processus ?
L’importance des dynamiques de pouvoir pour induire des changements transformateurs est reconnue depuis longtemps. Ce qui nous semblait important cependant était de savoir, une fois que l’on dit que les relations de pouvoir sont importantes, comment pouvons-nous les analyser ? Il s’agit de ne pas se concentrer uniquement sur le pouvoir coercitif, mais aussi sur le pouvoir d’agir, car pouvoir et contre-pouvoir sont toujours en relation.
Nous avons également cherché à comprendre comment les questions de biodiversité influencent ces dynamiques de pouvoir. Nos études de cas montrent des situations variées : certaines compagnies utilisent leur pouvoir lors de ces processus pour essayer de privatiser des ressources, entraînant une perte de biodiversité, tandis que certains processus participatifs pour la biodiversité, en essayant d’améliorer la conservation des espèces, risquent de renforcer les inégalités existantes entre participants si elles ne prennent pas en compte les dynamiques de pouvoir en place. Dans certains cas, les connaissances scientifiques dominent le processus, tandis que dans d’autres, différentes formes de connaissance sont prises en compte. Je reconnais que en revanche aucun des cas utilisés dans l’étude n’a tenté de représenter explicitement les non-humains. Cependant, grâce à l’expérience des professionnels de la facilitation impliqués dans notre groupe, nous suggérons que des approches plus sensibles, telles que l’utilisation de représentations artistiques comme le théâtre forum ou de nouvelles formes de narrations plus proches de l’histoire contée que du rapport scientifique, pourraient aider à mieux les intégrer.
Concrètement, comment les enseignements tirés de vos travaux peuvent-ils être opérationnalisés de manière à en voir les effets vertueux, pendant ou en amont d’un processus participatif ?
Ce cadre théorique constitue la première étape de notre projet. À partir de ce cadre, nous avons élaboré une grille d’analyse pour mener une revue systématique de la littérature (ndlr : une méthode robuste de synthèse de connaissances), afin de mieux comprendre le lien entre la prise en compte des multiples dimensions du pouvoir et les impacts sur la biodiversité. Bien que ce travail soit en cours, nous constatons déjà qu’il existe peu de publications détaillant à la fois les relations de pouvoir dans les processus participatifs en lien avec la biodiversité et les impacts de ces processus sur la biodiversité. Cependant, nous pouvons identifier quelles dimensions du pouvoir sont fréquemment analysées (comme le “pouvoir avec”, à travers des questions de confiance, par exemple) et lesquelles le sont moins (comme les questions de pouvoir caché et invisible).
Nous travaillons également à utiliser ce cadre théorique comme grille de lecture pour développer des pratiques réflexives sur les dimensions de pouvoir avant, pendant ou après un processus participatif. En tant que commanditaires, organisateurs, facilitateurs ou participants d’un processus participatif, vous pouvez vous interroger sur les dimensions de pouvoir en jeu : Y a-t-il des différences systémiques entre les participants qui permettent à certains d’être plus influents ? Que se passe-t-il en dehors du processus participatifs pour la biodiversité qui pourrait avoir un impact sur celui-ci ? Quelles alliances existent ou se forment au cours du processus ? Etc.
Enfin, un dernier axe sur lequel nous souhaitons travailler est de déterminer, une fois l’analyse des dimensions de pouvoir réalisée, comment utiliser ces informations. Comment les communiquer ? Quels sont les risques ? Quel est notre rôle en tant que représentant institutionnel, chercheur ou facilitateur face à ces dimensions de pouvoir ? Avons-nous le courage de parler ouvertement des relations de pouvoir ?

Pour combler ces lacunes, un groupe de chercheurs et chercheuses internationaux, dont plusieurs membres font partie de la Commission des Politiques environnementales, économiques et sociales de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ont travaillé ensemble pendant quelques années à travers le Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité, le Cesab de la FRB. En mai 2024, ils ont publié une importante étude dans One Earth, s’appuyant sur près de 650 articles scientifiques. Ils apportent ainsi une meilleure compréhension de ce qui fonctionne le mieux, pour les humains et pour la nature et appellent à un changement profond en faveur d’une justice sociale et d’une gouvernance équitable. En examinant 648 études, l’équipe a d’abord répertorié six manières dont les peuples autochtones et communautés locales sont impliqués dans la conservation et les a classés selon une échelle allant de leur exclusion à leur autonomie en passant par le partenariat. Elle s’est ensuite intéressée, aux 170 études mettant en avant les liens entre leurs rôles et la réussite ou non des projets (voir la figure ci-après). Les résultats sont sans équivoque :
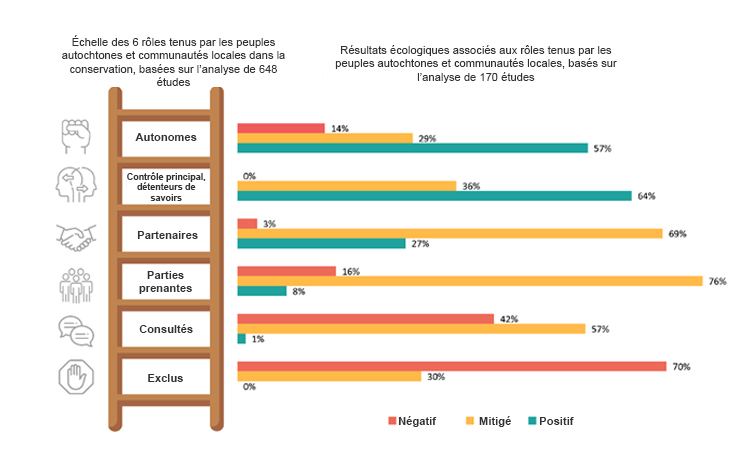
Figure : Rôle des peuples autochtones et communautés locales dans les projets de conservation et résultats écologiques associés.
Lorsque les peuples autochtones et les communautés locales sont exclus ou impliqués uniquement comme participants ou parties prenantes, ils peuvent se retrouver dans l’incapacité d’influencer des décisions d’une grande importance pour leur vie quotidienne, voir leurs droits violés ou encore se voir refuser l’accès à des terres d’importance culturelle. Dans ces cadres, la grande majorité des résultats écologiques ne sont pas optimums voire contre-productifs.
Au contraire, à mesure que l’on gravit les échelons et que des partenariats sont établis à égalité avec les instances de conservation, avec un contrôle et une reconnaissance culturelle accrus pour les communautés, la réussite écologique va de pair avec cette reconnaissance. Les communautés peuvent faire l’expérience du respect de leurs valeurs, de leurs droits, de leur identité et de leur culture, de l’autonomisation, de la coopération et de la confiance, autant d’éléments qui leur permettent d’établir un lien avec la nature et le territoire et d’en être les gardiens, tout en améliorant leur qualité de vie, tant sur le plan individuel que collectif.
Pour les auteurs, donner aux peuples autochtones et communautés locales les moyens d’agir en tant que partenaires et chefs de file est aujourd’hui indispensable pour une conservation juste et efficace dans l’optique d’atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité. Bien que la transformation des approches stratégiques, de la conception, des capacités, des processus et des interactions, du financement et de la mise en œuvre des processus de conservation prenne du temps, ils soulignent différentes initiatives existantes et intéressantes, telles que l’inclusion croissante des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire, aussi appelés territoires de vie.
<<
Un effort de collaboration basé sur les droits et la justice est nécessaire pour parvenir à un changement radical et cela s’applique à toutes les initiatives de conservation des espèces et des habitats, y compris la nouvelle vague d’initiatives visant à atteindre l’objectif de conservation de 30 % d’ici à 2030 et à restaurer les paysages dégradés de la planète.
>>

À travers douze nouvelles et une narration atypique qui permet une lecture à plusieurs niveaux, Biodiversité : No(s) futur(es) nous invite à retracer l’incroyable trajectoire du vivant et à enrichir nos imaginaires sur la Nature ainsi que sur notre manière d’habiter le monde.
Le lecteur suit Sécotine Fluet, une chercheuse en philosophie des sciences du vivants, de sa naissance à 2050. À travers des sauts dans le temps, à rebours et dans le futur explorez les relations entre l’humanité et la biodiversité.
Fondées sur des constats scientifiques authentiques, les auteurs et auteures y mêlent la fiction pour les ancrer dans le réel. Nous incitant ainsi à changer nos visions du monde. Ces douze nouvelles sont autant d’alertes pour une prise de conscience collective et massive et pour un changement transformateur de nos habitudes de vie afin de renouer des liens avec le reste des vivants et cesser de détruire notre maison commune.
<<
Azote réactif : le baiser du diable
Par Hélène Soubelet
La synthèse chimique des engrais azotés a permis une augmentation des rendements agricoles et le développement d’une agriculture intensive. Mais cette avancée, présentée longtemps comme un progrès, a été accompagnée d’effets secondaires insidieux et irréversibles, sur les écosystèmes, la biodiversité, les humains. En 2011, un très gros rapport scientifique a alerté la communauté internationale, ses constats étaient accablants. Mais l’inertie générale, les intérêts particuliers trop forts ont enrayé les mécanismes qui auraient permis de trouver des solutions durables pour éviter le pire et empêcher le déséquilibre du cycle biologique de l’azote. Y aura-t-il un sursaut en 2050 ?
>>

L’océan est un milieu tridimensionnel comportant une importante dimension verticale, la profondeur, qui structure des écosystèmes uniques et des usages humains spécifiques. Cependant, les outils de gestion et de conservation marine sont dominés par une représentation bidimensionnelle de l’océan, qui néglige cette stratification verticale. Si cette représentation réductionniste de l’océan était compatible avec des usages humains principalement côtiers, l’expansion de l’empreinte humaine vers la haute mer et l’océan profond nécessite une nouvelle approche prenant en compte cette complexité verticale. La prise en compte de la profondeur de l’océan est particulièrement importante étant donné les nouveaux objectifs des accords de Montréal-Kunming, notamment celui d’atteindre 30 % de couverture de protection marine d’ici 2030, ainsi que le récent traité international pour la gestion de la biodiversité en haute mer.
Dans ce contexte, des chercheurs du Criobe et de l’Université de Washington ont développé une nouvelle approche pour évaluer la distribution des impacts humains et des efforts de conservation à travers les trois dimensions de l’océan : latitude, longitude et profondeur. Pour ce faire, une typologie des principales unités écologiques à travers les profondeurs (Figure 1) est surimposée à une typologie bidimensionnelle des écorégions marines pour définir des écorégions tridimensionnelles.
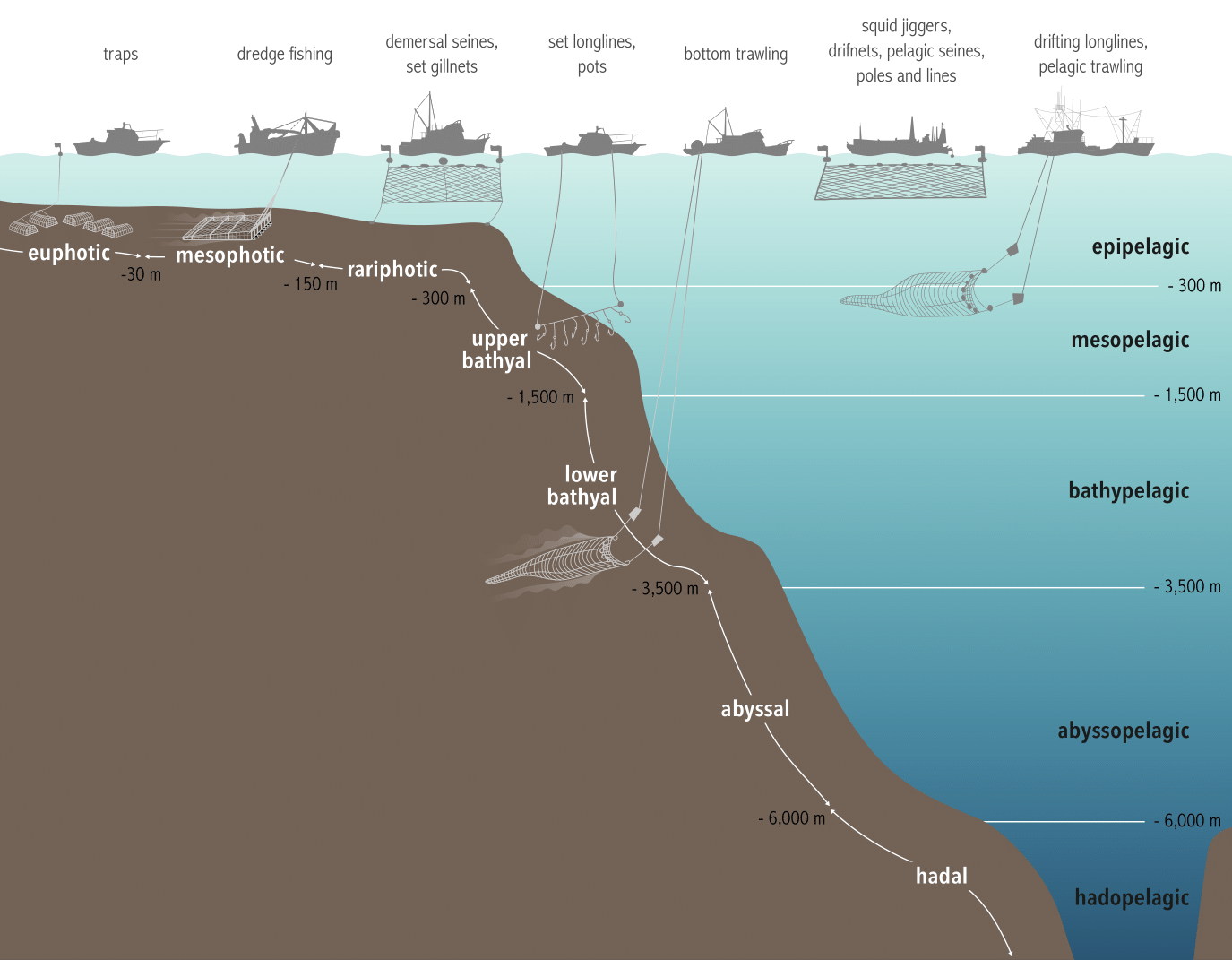
Figure 1 : Profondeur atteinte par les activités de pèche par type d’engins. La profondeur des pictogrammes représentant chaque engin indique la profondeur maximale où ces engins opèrent.
À l’aide de cette nouvelle typologie, l’équipe a évalué la distribution tridimensionnelle mondiale des efforts de conservation et des activités de pêche, qui constituent aujourd’hui la principale pression humaine directe sur les écosystèmes marins. Les analyses s’appuient sur des bases de données publiques, telles que le Global Fishing Watch pour les activités de pêche, le World Database on Protected Area pour les efforts de conservation et le GEBCO pour les données bathymétriques.
Les résultats ont révélé que les différentes profondeurs de l’océan, qui correspondent à des écosystèmes uniques, bénéficient d’efforts de conservation très disparates. Alors que les écosystèmes les moins profonds (0 à 30 m) sont les mieux protégés, les écosystèmes plus profonds, notamment le mésophotique (30 à 150 m), le rariphotique (150 à 300 m) et les abysses (3500 à 6000 m), n’ont toujours par atteint l’objectif de 10 % de couverture de protection fixé par la Convention sur la diversité biologique (CDB) et qui aurait dû être atteint depuis 2020. Par contraste, l’empreinte 3D des activités de pêche s’étend à travers toutes les profondeurs, avec notamment 37 % des activités mondiales de pêche opérant dans l’océan profond, en-dessous de 300 m.
D’autre part, les résultats démontrent que les efforts de conservation sont disproportionnellement dirigés vers les aires où le moins d’activité de pêche ont lieu, un phénomène d’évitement dénommée ” conservation résiduelle “. Autrement dit, les aires les plus impactées par les pressions humaines demeurent le plus souvent sans protection. De plus, les aires marines de protection forte, où les régulations d’extraction sont strictes, et qui fournissent les bénéfices écologiques les plus importants, sont sous-représentées dans toutes les écorégions et à toutes les profondeurs, avec seulement 1,4 % de couverture à l’échelle mondiale.
Les faiblesses du réseau mondial d’aires marines protégées soulignées par cette étude appellent à une représentation plus holistique de l’océan, prenant en compte sa structure verticale et les processus complexes de connectivité reliant le pélagique au benthique. Améliorer la représentation écologique à toutes les profondeurs, augmenter la couverture de protection forte, et prioriser les zones les plus impactées par les usages humains doivent constituer la priorité des stratégies de conservation à l’échelle nationale et mondiale.

Pourquoi as-tu choisi de nous présenter ce projet de la zone atelier en particulier ?
J’ai choisi de présenter ce projet car il est relativement atypique dans sa conception et dans sa forme. Ce projet débuté en 2021 rassemble des partenaires issus du monde associatif, et un consortium de chercheurs en écologie, en écotoxicologie mais aussi en épidémiologie médicale, animale et végétale. Il aborde la santé du territoire, en l’occurrence ici celle d’un territoire rural dans le contexte actuel des enjeux d’alimentation, d’agriculture et de santé. Un des enjeux est la sortie de l’usage intensif des pesticides sans impacter la production agricole et la viabilité des exploitations et en préservant l’environnement et la biodiversité.
Le plan Ecophyto et la loi Egalim ont été mis en place pour répondre à ces enjeux. Peux-tu nous en dire plus ?
Le plan Ecophyto est né du Grenelle de l’environnement en 2007. A l’époque, il s’appelait plan Ecophyto 2018 et avait pour objectif de réduire de 50 % l’usage des pesticides entre 2008 et 2018. En termes de coûts, cela a représenté plusieurs milliards d’euros, dont 400 millions d’euros par an de fonds publics. Rétrospectivement, on s’aperçoit que malgré ces efforts, les ventes de pesticides sont restées globalement constantes ces 13 dernières années, avec 20% de ces ventes qui correspondent à des substances cancérigènes/mutagènes et ayant des conséquences sur la fertilité. Surtout, il existe une hétérogénéité très importante sur le territoire des ventes de ces molécules : nous ne sommes pas tous exposés aux mêmes molécules et aux mêmes quantités.
La loi Egalim en 2017 avait également pour objectif de garantir une alimentation de qualité et un juste prix aux agriculteurs. La crise agricole actuelle met en évidence les limites de ces politiques publiques.

Pourquoi les pesticides sont-ils si pointés du doigt ?
Il y a, d’une part, les liens entre usages des pesticides et le déclin de la biodiversité (comme l’a établi, entre autres, l’étude phare sur les insectes Hallmann et al. 2017, qui documente une diminution de plus de 75 % de la biomasse des insectes des aires protégées d’Allemagne au cours des 27 dernières années). On retrouve également des pesticides ou des métabolites de ces molécules dans de nombreux compartiments de l’environnement y compris dans des sols de parcelles d’agriculture biologique qui n’ont pas été soumis à des pesticides depuis plusieurs années. D’autre part, les liens entre pesticides et santé humaine ont aussi été documentés. En 2021,l’expertise Inserm a révélé des liens entre des pathologies (lymphomes, cancers de prostate, maladie de Parkinson) et l’exposition aux pesticides des travailleurs agricoles.
Cela pose donc plusieurs enjeux : l’enjeu de réduction d’usage des pesticides, mais aussi celui de l’exposition aux pesticides et des impacts de ces expositions. L’exposition est complexe car il s’agit dans la plupart des cas d’une exposition chronique, à un cocktail de molécules, à des doses faibles et via de multiples sources d’exposition et sur de multiples organismes (humains, non-humains). Tout cela conduit à une nouvelle approche de la santé, ce qui a mené au projet Santé des Territoires de la ZA Plaine & Val de Sèvre que nous avons voulu inscrire dans le cadre EcoHealth.
Quelle est l’ambition de ce projet ?
Ce projet a pour double objectif de : (1) démontrer le rôle de la biodiversité pour la santé, et (2) de rendre le concept “une seule santé”* opérationnel plutôt qu’incantatoire. Il s’agit de comprendre comment la biodiversité, par des mécanismes qui lui sont propres (au niveau local via la bioaccumulation par exemple mais aussi à l’échelle du paysage) peut réduire notre exposition aux pesticides et l’impact que cela pourrait avoir sur notre santé.
(*) Le cadre “une seule santé”, un concept apparu avec la question des zoonoses (notamment avec la maladie de Creutzfeld Jakob et de la vache folle) créant un lien très fort entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Le choix de l’approche « Ecohealth » plutôt que « One health » met en avant le rôle de la biodiversité et celle des solidarités via les liens entre humains et nature.
Comment étudier ce concept d’une seule santé en « pratique » dans un territoire ?
La ZA Plaine & Val de Sèvre est un site agricole de 450 km² avec des paysages contrastés comprenant des zones de bocages, des zones de plaines céréalières intensives. Le territoire couvre 24 communes, 34 000 habitants, plus de 400 fermes et 24 établissements scolaires.
Ce territoire est particulièrement intéressant d’un point de vue scientifique car il fait l’objet de suivis de long terme, depuis près de 30 ans maintenant. Des suivis de biodiversité depuis 1994, des pratiques agricoles depuis 2006, de consommation alimentaire depuis 2019 et sur la perception de la nature et de la santé chez les habitants des territoires depuis 2021. Des suivis d’usage des sols ont également été réalisé permettant de connaître la répartition de l‘agriculture biologique et des haies. Cette connaissance est utilisée pour mettre en place un « design spatial semi expérimental ».

Qu’est que ce design permet ? Quelles sont les méthodes d’étude de ce territoire ?
Ce projet vise à comprendre comment les rôles de la biodiversité et des paysages sur l’exposition aux pesticides et son impact dans l’objectif de co-concevoir des solutions pour réduire exposition et impact. En absence d’une connaissance fine des usages de pesticides sur l’ensemble du territoire, nous utilisons l’agriculture biologique comme le pendant inverse de l’usage des pesticides – puisque cela n’est pas permis dans ce modèle agricole. Afin d’étudier les liens entre usage et exposition aux pesticides, nous sélectionnons des paysages et lieux de vie (communes) avec une proportion plus ou moins élevée d’agriculture biologique et un gradient de présence de haies car ces dernières représentent aussi une barrière à la dispersion de molécules ou des zones d’accumulation.
Quelles actions ont-elles été menées depuis le lancement du projet?
Je n’ai pas présenté de résultats car à ce stade nous ne sommes pas en mesure de le faire. Cette présentation avait pour objectif de partager avec vous une initiative de recherche à l’échelle d’un territoire, engageant des chercheurs, des non-académiques mais également les habitants d’un territoire dans un processus visant à comprendre comment améliorer la santé de ce territoire.

La définition vers laquelle nous avons convergé au sein du groupe UICN est qu’un conflit est souvent représenté par des frictions (« struggles ») qui apparaissent lorsque la présence ou le comportement de la faune sauvage constitue une menace réelle ou perçue, directe et récurrente, pour les intérêts ou les besoins de l’humain, entraînant des désaccords entre les groupes de personnes et des impacts négatifs sur les personnes et/ou la faune sauvage. Cette définition, d’apparence simple, a pris presque trois ans pour aboutir à sa version finale !
Dans l’imaginaire collectif, le terme “conflit” est synonyme de dispute et donc a nécessairement un résultat négatif. Dans les cas présentés dans le guide, et dans mon expérience, les conflits peuvent être positif dans le sens où ils peuvent être des opportunités amenant à un dialogue, à des actions permettant de transformer une situation en situation moins négative ou d’autant plus positive.
De même, les « objets » du conflit sont aussi souvent associés aux espèces charismatiques en premier lieu (lion, ours, loup, tigre…) alors qu’il s’agit très souvent d’autres espèces auxquelles on n’associe pas de « problèmes » mais qui peuvent aussi être à la base de conflits (corvidés, mustélidés, castors…).
Pour aller plus loin | Quelques caractéristiques des conflits identifiées dans la définition
1/ Les interactions directes et récurrentes : les conflits résultent d’une forme de dommage ou menace, perçue ou réelle, causée par la faune sauvage. Toutefois, la mesure dans laquelle cette menace dépend réellement de la présence ou le comportement des animaux va varier considérablement.
2/ Les conflits entre les humains et la faune sont presque toujours sous-tendus par des conflits sociaux entre les personnes au sujet de la gestion de la faune (exemple du loup en France). Les conflits sont utilisés comme un moyen d’exprimer autre chose n’ayant plus aucun rapport avec l’espèce en question, comme des notions de valeurs, de pouvoirs, de justice sociale, etc.
3/ Les conflits ont tendance à concerner des espèces menacées et qui peuvent avoir un impact négatif (exemple en Ecosse, où le pygargue a été réintroduit après avoir disparu du territoire). Quand on a des conflits avec des espèces menacées : les enjeux vont être beaucoup plus importants et les solutions beaucoup plus complexes car il n’y a pas la possibilité d’éliminer légalement ces espèces, ce qui exacerbe les conflits sociaux.
Ce document aborde en effet des grands principes auxquels on ne peut déroger dans la gestion de conflits entre humains et faune sauvage. En plus de ces principes, ce que j’affectionne particulièrement dans le guide, est la série de « guiding principles». Ces principes permettent à l’utilisateur de naviguer et de mettre en pratique ces principes. Je reviens sur chaque principe en insistant sur un point ou un exemple.
1/ Ne pas nuire
Une notion qui m’a particulièrement marquée est le concept de « positionalité », ou la manière dont l’identité d’un individu influence son interprétation du monde et la manière dont il est perçu par les autres. C’est essentiel d’en être conscient et d’être transparent avec cela !
2/ Comprendre les problèmes et le contexte
Dans la plupart des conflits, on adopte une vision myope de la partie émergée de l’iceberg qui se restreint aux disputes et on néglige donc toute la partie immergée et sous-jacente aux conflits comme : les connaissances traditionnelles, les questions de valeurs et croyances, de culture ou d’histoire et d’expériences. En effet, si on n’a qu’une vue biaisée d’un acteur, on ne verra jamais le conflit dans son entièreté et cela risque d’avoir des impacts sur la façon dont on décide de gérer un conflit.
3/ Travailler ensemble
Travailler avec les “parties prenantes”, c’est une base. C’est un challenge pratique et éthique à relever pour viser des résultats pour tous. C’est important pour comprendre la situation bien sûr, mais aussi pour que cette compréhension soit partagée, pour établir la confiance nécessaire, trouver des pistes innovantes de résolution – de surcroît pour et par les parties prenantes.

4/ Intégrer la science et la politique
L’intégration de différents types de connaissances peut contribuer à donner une meilleure image globale d’une situation de conflit et à mieux éclairer la prise de décision.
5/ Permettre des trajectoires durables
Dans les situations de conflit, les différents acteurs ont souvent des points de vue différents sur ce qui constitue un conflit géré. Sans comprendre ces différentes perceptions, sans en discuter et sans parvenir à un accord, il est peu probable que les acteurs parviennent à un avenir souhaitable.
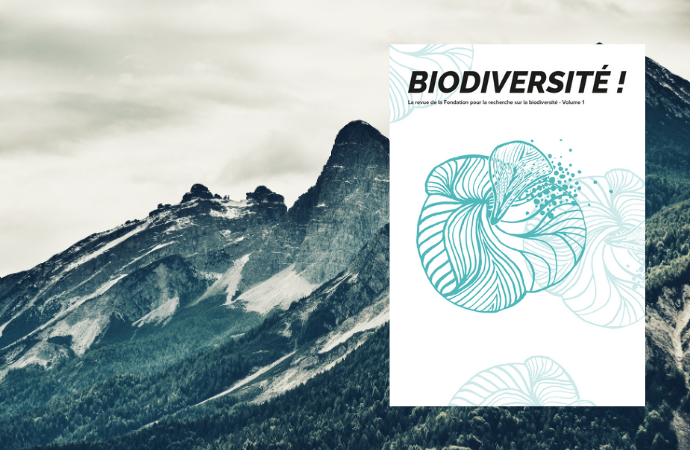
Biodiversité ! invite aussi à découvrir les solutions fondées sur la nature proposées par la recherche pour atténuer le déclin de la biodiversité et le réchauffement climatique. Privilégier des aires marines protégées de façon stratégique ou étudier de près le microbiome des arbres sont autant de pistes scientifiques à lire dans la revue.
Mais les sujets de recherche ne s’arrêtent pas là. Parce que les actions de préservation de la nature se heurtent souvent à une logique socioéconomique hostile, il devient de plus en plus important de questionner la logique des interactions de nos sociétés avec les écosystèmes, la biodiversité, l’environnement. Notre système économique doit-il être radicalement repensé ? La ville du futur est-elle l’avenir de la Biodiversité ? Faut-il choisir entre nourrir les hommes et conserver la Biodiversité ? Autant de questions auxquelles des scientifiques ont répondu et qui sont à lire dans Biodiversité !

· S O M M A I R E ·
·
Biodiversité ! sonne comme une exclamation émerveillée. Celle qui conduit depuis toujours les chercheurs à témoigner de la beauté et la complexité du vivant. Mais Biodiversité ! résonne aussi aujourd’hui comme une alerte, celle qui nous appelle plus que jamais à comprendre très rapidement pourquoi agir, qui doit agir et comment.
·

· L E S C H E C H E U R S & C H E R C H E U S E S ·
Anne Charmantier, directrice de recherche au CNRS, Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (Cefe) et membre du Conseil scientifique de la FRB (de 2017 à 2022) · Philippe Clergeau, chercheur en écologie au Muséum national d’Histoire naturelle · Denis Couvet, président de la FRB et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) · Claude Garcia, chercheur au Cirad et de l’ETH Zurich · Annamaria Lammel, maître de conférences en psychologie à l’université Paris 8 · Harold Levrel, professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech, chercheur en économie écologique au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired) et membre du Conseil scientifique de la FRB (de 2017 à 2022) · Serge Morand, écologue de la santé au CNRS et au Cirad · Francis Martin, microbiologiste à Inrae · François Sarrazin, professeur de Sorbonne université et chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (Cesco) – équipe “Conservation et Restauration des Populations” (Corpo) et président du Conseil scientifique de la FRB (de 2017 à 2022).
avec la participation d’ Allain Bougrain Dubourg Président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et président du Conseil d’orientation stratégique (Cos) de la FRB.
· L E S A R T I S T E S ·
Julie Borgese · Marine Debard

Fourmi électrique, huitre creuse ou frelon asiatique etc. Sur la planète, plus de 40 000 espèces exotiques sont recensées et 3 500 d’entre elles sont des espèces exotiques envahissantes nuisibles. Que ce soit sous forme végétale ou animale, ces espèces ont été introduites par les humains en dehors de leur aire de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement. Appelées aussi invasions biologiques, elles impactent les écosystèmes et les espèces, les contributions de la nature tout en pouvant dans certains cas avoir des effets positifs. Dans son prochain rapport à paraitre le 4 septembre, l’Ipbes présente les données les plus récentes sur le statut et les tendances des espèces exotiques envahissantes dans le monde.
Afin d’offrir une bonne compréhension du sujet la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et le Museum national d’Histoire naturelle vous proposent une série d’articles, destinés au grand public et donnant la parole aux meilleurs spécialistes français du sujet.
Plus de 40 000 espèces exotiques se propagent sur la planète, dont plus de 3 500 sont des espèces exotiques envahissantes mettant en danger la biodiversité. Selon l’Ipbes, elles sont considérées comme une des principales causes d’extinction des espèces et l’une des grandes causes globales de perte de biodiversité. Franck Courchamp, l’un des auteurs du rapport de l’Ipbes, insiste sur la gravité des impacts économiques et environnementaux de ces invasions biologiques et appelle à une prise de conscience urgente pour préserver les écosystèmes.
Consulter l’article :
Yohann Soubeyran est coordinateur “espèces exotiques envahissantes” au Comité français de l’UICN. Il pilote l’animation du Centre de ressources sur ces espèces et d’un réseau dédié à la thématique à l’échelles des outre-mer françaises. Ces dispositifs visent à améliorer l’efficacité des démarches de prévention et de gestion des invasions biologiques et à accompagner les politiques et stratégies nationales et locales sur le sujet. Aujourd’hui, le coût des invasions biologiques s’élève à près de 116 milliards d’euros dans l’Union européenne sur les 60 dernières années, dont 20 % pour les mesures de gestion. Yohann Soubeyran revient sur la meilleure option pour endiguer cette menace : la prévention.
Consulter l’article :
Les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes marins peuvent se révéler à l’origine de l’essor rapide d’invasions biologiques. Les températures plus chaudes ou le manque de précipitation dû au changement climatique permettent à certaines espèces de se répandre, menaçant l’équilibre écologique et la biodiversité marine. Dans les régions polaires, par exemple, le réchauffement climatique a ainsi ouvert de nouvelles voies maritimes accessibles aux hommes, drainant avec eux volontairement ou non tout un cortège d’espèces. Bien que des réglementations émergent pour contrôler ces introductions, la sensibilisation du public et des décideurs reste essentielle pour préserver nos écosystèmes marins.
Consulter l’article :
Antoine Carlier, biologiste écologue du Laboratoire d’écologie benthique côtière, est spécialiste de la crépidule, un mollusque gastéropode, originaire de la côte est des États-Unis, introduit en Europe dès la fin du XIXe siècle. Depuis 40 ans, cette espèce répertoriée comme espèce exotique envahissante, a colonisé plusieurs baies de la façade Manche-Atlantique. Des suivis récents ont pourtant montré que certaines populations de crépidule commencent à décliner, notamment en rade de Brest. Si la cause n’a pas été clairement identifiée, le suivi de cette espèce invasive aura montré qu’elle aura pu avoir quelques effets bénéfiques pour l’écosystème. Un phénomène aujourd’hui étudié de près par les scientifiques.
Consulter l’article :
DU CÔTÉ DU MNHN
Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) propose des ressources complémentaires, en lien avec les différents sujets traités dans les articles présentés ci-dessus :
Retrouver l’ensemble des ressources du Muséum sur la page :
Espèces exotiques envahissantes : un défi pour la planète
Contact presse MNHN :
Isabelle Coilly, responsable relations presse
isabelle.coilly@mnhn.fr – +33 (0) 1 40 79 54 40

Comment est arrivée la crépidule sur les côtes françaises ?
La crépidule est arrivée par différents biais, mais majoritairement avec le commerce de l’huitre creuse. En important ces huitres, on a importé avec elles tout un cortège d’espèces exotiques qui étaient à l’état larvaire ou juvénile, cachées dans leurs coquilles. L’établissement de la crépidule date des années 70. Mais elle devient vraiment envahissante dans les années 80 et 90. On la retrouve sur tout le littoral français, notamment dans la rade de Brest.
Quand la crépidule s’est multipliée quels impacts notables a-t-elle eu sur l’écosystème ?
La crépidule est un gastéropode qui a besoin d’un substrat dur et lisse pour se fixer, un rocher plat ou un débris de verre par exemple. Au début de son introduction, elle en a eu besoin mais comme elle s’est mise à proliférer, elle s’est étendue sur des fonds qui étaient meubles et s’est auto-entretenue du fait que les jeunes individus se fixent préférentiellement sur les chaines d’adultes, empilés les uns sur les autres. Elle a ensuite servi de support à des espèces qui aiment les substrats durs comme les ascidies, les éponges et certains bivalves comme le pétoncle noir, lequel est par ailleurs une espèce actuellement en déclin.
Outre le fait de servir d’habitat à d’autres espèces, la crépidule a-t-elle eu d’autres effets positifs ?
Les crépidules sont des organismes filtreurs qui se nourrissent en filtrant l’eau pour capturer des particules de nourriture, notamment des micro-algues. En filtrant activement l’eau, elles peuvent contribuer à réduire la turbidité, limitant ainsi les efflorescences de certaines espèces du phytoplancton, en particulier des dinoflagellés.
Inversement, en quoi la crépidule a déstabilisé les écosystèmes ?
Pour arriver à déstabiliser un écosystème entier, il faut dépasser un certain seuil en termes de densité ou de biomasse. C’est ce qu’il s’est passé dans certaines zones où sur un mètre carré, il a pu y avoir plusieurs milliers d’individus. Or, la crépidule est un animal filtreur qui, pour se nourrir et s’oxygéner, filtre une grande quantité d’eau de mer et produit beaucoup de fèces : dans ces conditions, elle a déstabilisé l’écosystème avec un envasement des fonds, y compris les fonds sableux qui sont devenus des fonds vaseux. Plusieurs espèces de fonds sableux comme la coquille Saint Jacques ou les juvéniles de soles ont donc reculé.
Il semblerait qu’après avoir prospéré sur nos côtes ses populations diminuent.
Depuis le milieu des années 2000, on constate effectivement un recul de la crépidule. En rade de Brest des investigations menées entre 2013 et 2018, des prélèvements sur le terrain et des vidéos sous-marines ont permis de démontrer clairement que le stock avait très significativement diminué en particulier dans tout le bassin sud de la rade. Elle semble néanmoins s’être maintenue dans le secteur nord de la rade. Si on ne sait pas exactement pourquoi elle recule, on a suspecté néanmoins des polluants arrivés du bassin versant du sud de la rade pour expliquer son déclin. Mais souvent, un déclin est multifactoriel et prend du temps.
Le fait que la crépidule décline en fait-elle une exception parmi les espèces exotiques envahissantes ?
Il semblerait que d’autres espèces comme la caulerpe (Caulerpa taxifolia) en méditerranée, considérée elle aussi comme envahissante, décline naturellement. Il y a plusieurs pistes d’investigation pour chercher à comprendre pourquoi. Il y a comme un cycle qui s’observe, où au bout de 20-30 ans, on voit des espèces proliférantes décliner. Sans doute parce que petit à petit d’autres interactions avec d’autres espèces s’opèrent. Elles sont alors contrôlées soit par des parasites soit par des prédateurs qui permettent à ces espèces exotiques envahissantes de trouver une place régulée dans l’écosystème.
Est-ce une loi ?
Non, car en milieu marin ou terrestre, il y a plusieurs exemples d’espèces proliférantes qui ont fait basculer irréversiblement l’écosystème dans un état différent. Par exemple des oursins, qui sont des herbivores, peuvent dévorer intégralement d’immenses champs d’algues qui laissent place à des fonds complètement nus. C’est vrai aussi dans des milieux tropicaux où des étoiles de mer ont décimé des récifs de coraux. Donc parfois, passé ce « point de bascule », on assiste à l’établissement d’un tout autre écosystème.
Quel est l’état aujourd’hui de la rade de Brest ?
La rade n’a pas retrouvé son état écologique d’avant l’arrivée de la crépidule. Il reste toujours des traces à commencer par les amas de coquilles de crépidules mortes dans la partie sud. Certes, elles servent encore de support à certaines espèces, mais la biodiversité y est beaucoup moins luxuriante que lorsque l’on avait des bancs de crépidules vivantes. La rade est par ailleurs impactée par diverses pollutions et par des activités humaines, comme la pêche aux engins trainants qui dégradent les habitats et remettent en suspension des particules. L’écosystème évolue sans cesse, s’adapte parfois, et il reste heureusement des zones dans cette rade où les écosystèmes fonctionnent toujours bien.

Fourmi électrique, écrevisse américaine ou frelon asiatique, sur la planète, plus de 3 700 espèces exotiques sont recensées. Que ce soit sous forme végétale ou animale, ces espèces ont été introduites par l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement. Leur propagation menace la biodiversité et peuvent avoir des impacts négatifs sur l’économie ou la santé humaine. Elles sont considérées par l’Ipbes comme une des principales d’extinction des espèces et l’une des cinq grandes causes globales de perte de biodiversité.

Il aura fallu quelques années seulement à l’huitre creuse pour se répandre le long des côtes françaises. Originaire du Pacifique Nord-Ouest, cette huître introduite dans les années 70 en France ne se reproduisait qu’en Sud Loire. Mais à la faveur du changement climatique, sa population a explosé jusqu’à développer des populations dans les fjords norvégiens. Les températures de l’eau, plus chaudes, lui ont permis de se développer et de se reproduire bien plus efficacement, au point d’entrainer une concurrence pour les ressources alimentaires avec les huîtres indigènes et de perturber l’équilibre écologique. Pour Philippe Goulletquer, directeur de recherche à l‘Ifremer « à l’échelle marine, le changement climatique influe, sur la propagation d’espèces exotiques envahissantes en créant les conditions favorables à leur développement ».

En quoi consiste la prévention ?
Elle vise à mettre en place des mesures de contrôle des importations aux frontières et de biosécurité pour limiter l’arrivée de nouvelle espèces exotiques et leur déplacement. Cela nécessite un cadre réglementaire et une surveillance biologique organisée du territoire. La surveillance doit se concentrer sur les points chauds d’introduction tels que les ports et les aéroports, les voies de communication, comme les routes ou les voies ferrées, qui constituent des corridors de dispersion. Une vigilance particulière doit aussi être portée aux espaces prioritaires, tels que les espaces naturels et les aires protégées abritant des espèces patrimoniales, endémiques ou en danger qui pourraient être menacées par ces espèces exotiques envahissantes.
Combien d’espèces arrivent sur le territoire ?
D’après l’indicateur de l’observatoire national de la biodiversité, depuis 1983, un département de métropole compte en moyenne 11 espèces exotiques envahissantes de plus tous les dix ans. Le cas du frelon asiatique est emblématique. Détecté pour la première fois en 2004 en France, il a depuis colonisé presque toute l’Europe. Le coût de la lutte contre cette invasion en France se chiffre à plusieurs millions d’euros par an, et s’accroit avec le temps. L’éradication aurait été possible au début de l’installation de l’espèce. Aujourd’hui ce n’est plus envisageable, on est obligé de vivre avec.
Y a-t-il régulièrement des alertes ?
La pression aux frontières est permanente. Il y a déjà eu plusieurs alertes nationales d’invasions biologiques potentielles. Entre 2019 et 2021, quatre nouvelles espèces exotiques d’écrevisses problématiques pour nos cours d’eau ont été découvertes en France. Originaires d’Amérique du Nord, elles ont sans doute été introduites accidentellement, mais on ne peut pas exclure des relâcher intentionnels. En 2022, la petite fourmi de feu ou fourmi électrique a été découverte à Toulon. Cette espèce originaire d’Amérique du Sud est l’une des cinq espèces de fourmis les plus envahissantes au monde. On peut supposer qu’elle est arrivée par des bateaux militaires ou par le commerce des plantes. Bien que nous parvenions à les identifier et les détecter, il y a encore peu de réponses efficaces face à ce problème.
Lorsque l’espèce exotique envahissante est déjà installée sur le territoire comment limite-t-on son déplacement ?
Il existe des listes réglementaires et scientifiques. La liste règlementaire permet par exemple d’interdire l’importation ou la commercialisation des espèces identifiées. Pour la France métropolitaine, 94 espèces sont aujourd’hui réglementées et interdites de commerce, transport ou encore colportage. Mais on est bien loin du nombre des espèces pouvant s’installer sur le territoire. A côté de cela, il existe des listes scientifiques qui se fondent sur des inventaires, des évaluations et la caractérisation du risque. Bien que parfois soumises à discussion et débat sur la méthodologie, ces listes permettent d’orienter des actions de surveillance et de gestion sur le territoire.
Qui est en charge de construire ces listes scientifiques ?
Pour la flore, se sont notamment les conservatoires botaniques nationaux qui sont en charge de produire ces listes. Aujourd’hui, on arrive à inventorier entre 600 et 900 plantes naturalisées dans chaque région. Une centaine sont considérées comme espèce exotique envahissante. Mais ce statut peut varier avec l’espace et le temps. Une espèce peut être considérée comme envahissante dans le sud par exemple, mais pas dans le nord. Elle peut l’être ou le devenir puis disparaitre. C’est par exemple le cas de la Caulerpe (Caulerpa taxifolia) qui a envahi les côtes de plusieurs pays méditerranéens dans les années 1990-2010, mais dont les populations sont aujourd’hui en forte régression. Des espèces exotiques problématiques sur le moment peuvent , après de nombreuses années, trouver leur place dans l’écosystème et fournir par exemple des services écosystémiques qui avaient disparus. Les acteurs confrontés aux invasions biologiques s’interrogent de plus en plus sur les évolutions possibles vers des « néo-écosystèmes », définis comme des assemblages hybrides et fonctionnels d’espèce indigènes et d’espèces exotiques. C’est un sujet émergent pour la recherche.
Les politiques publiques nationales sont-elles cohérentes pour répondre à cet enjeu ?
Pas toujours… Par exemple, dans un contexte de changement climatique, un enjeu majeur pour la forêt française est d’accroître ses capacités de résilience pour garantir la qualité et la quantité de l’ensemble des services fournis. Parmi les solutions proposées, le recours à des essences exotiques au sein « d’îlots d’avenir », plus tolérants à la chaleur et à la sécheresse, est encouragé par les pouvoirs publics. Or une part importante des espèces préconisées sont des espèces exotiques comme le robinier, le chêne rouge ou le noyer noir dont le caractère envahissant pour certaines est bien documenté en France et ailleurs dans le monde. A l’heure où les scientifiques n’ont de cesse d’alerter sur les impacts négatifs des invasions biologiques, la question de la cohérence entre nos politiques publiques nationales se pose d’autant plus.
Avons-nous en France les moyens de prévenir les invasions biologiques ?
Depuis quelques années, des réseaux et des groupes de travail se sont constitués et des stratégies régionales en métropole et en outre-mer ont été élaborées pour définir un cadre d’action collectif. Les résultats sont là en termes d’amélioration des connaissances, de stratégie collective, de réglementation. On sait ce qu’il faut faire. Reste la question des moyens humains, financiers et d’une volonté politique pour mettre en œuvre la prévention. Il nous faut aujourd’hui accentuer la sensibilisation des citoyens, des élus et professionnels, renforcer notre biosécurité avec plus de personnels formés aux frontières et sur le terrain et une surveillance biologique coordonnée du territoire. Enfin, il nous faut soutenir davantage la recherche pour développer des outils d’aide à la décision afin de mieux anticiper les prochaines invasions.
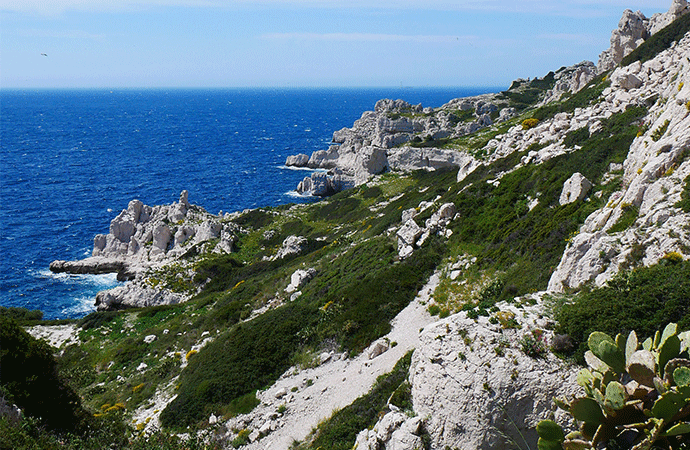
L’activité anthropique a considérablement modifié la structure et le fonctionnement de tous les écosystèmes de la planète notamment en mer et sur littoral. Néanmoins, des solutions existent pour faire face à ces impacts. S’appuyant sur les résultats de la recherche, l’Ipbes a identifié cinq pressions directes sur la biodiversité ayant les incidences les plus lourdes à l’échelle mondiale. Il s’agit de la modification de l’utilisation des terres et des mers, de la surexploitation des ressources sur terre comme en mer, des changements climatiques, qui affectent tous les compartiments de l’environnement, des pollutions et des espèces exotiques envahissantes, qui perturbent les équilibres, notamment aux échelles locales.
Cette étude se focalise sur la réduction des principales pressions directes exercées sur la biodiversité pour renforcer l’efficacité des mesures proposées dans le cadre des documents stratégiques de façade qui définissent les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral. Pour ce faire, la FRB a effectué une extraction des solutions à partir d’articles de recherche récents afin de fournir une perspective récente sur des priorités pour trois principales pressions directes s’exerçant sur la biodiversité.
Les trois pressions directes présentées dans ce dossier sont la modification de l’utilisation des mers, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Les résultats de cette analyse ont été regroupés par pression et sont disponibles à travers trois fiches thématiques.

On assiste à une augmentation des activités offshore telles que la production d’énergie, l’aquaculture, le tourisme, le développement des biotechnologies et l’exploitation minière (Stuiver et al., 2016) ou encore l’installation de plateformes multi-usages (MUPs). Ces activités font des mers européennes le théâtre d’une croissance massive des infrastructures maritimes et d’une compétition spatiale (Stuiver et al., 2016).
Parmi les activités offshores, la pisciculture en cages flottantes pose la question, à l’échelle européenne, des évasions (Arechavala-Lopez et al., 2018) qui recouvrent l’échappée de poissons isolés, de groupes de poissons (de quelques-uns au million), d’œufs viables et fécondés (Arechavala-Lopez et al., 2018). Elles se produisent en raison de défaillances techniques et opérationnelles (Arechavala-Lopez et al., 2018) :
Le développement des énergies marines renouvelables (EMR) est également notable. Celles-ci peuvent fournir jusqu’à 7 % de la demande mondiale en électricité : la plupart via l’éolien offshore, l’énergie marémotrice pourrait répondre, quant à elle, à environ 0,75 % de cette demande (Fox et al., 2018). Si extraire l’énergie des courants de marées, prévisibles, est une idée séduisante, peu de sites conviennent pour les installations. Cependant, un grand nombre de dispositifs marémoteurs sont actuellement en cours de développement (Fox et al., 2018). En France, un déploiement expérimental a eu lieu au niveau du raz Blanchard, lieu de passage d’un intense courant de marée. Les principales préoccupations environnementales liées à ces dispositifs ciblent les perturbations physiques, les risques de collision, les modifications hydrographiques et la génération de bruits et de champs électromagnétiques (Fox et al., 2018). En termes de risques de pollution, on dispose de peu d’informations sur les revêtements anti-biofouling, c’est à dire contre l’encrassement biologique, qui devront être utilisés pour protéger les turbines, transformateurs et autres appareils (Fox et al., 2018).
L’augmentation du trafic maritime en général menace particulièrement les populations de cétacées, dites “espèces parapluie”, qui sont également confrontées à la perte d’habitat et aux pêcheries commerciales (Pennino et al., 2017). Le trafic maritime engendre des perturbations physiques et acoustiques qui peuvent provoquer, à court terme, des changements physiologiques et de comportement et, à long terme, des changements dans la distribution des cétacés. En outre, les collisions avec les navires sont régulièrement signalées. Des preuves de collisions ont été décrites pour 11 espèces de grandes baleines, pour lesquelles le rorqual commun (Balaenoptera physalus), était le plus fréquemment impliqué (Pennino et al., 2017). En particulier, la navigation de plaisance, en développement à travers le monde, est d’autant plus impactante, qu’elle est un des piliers de « l’économie bleue » ou la Blue Economy de l’Union européenne et a donc vocation à se développer : aujourd’hui, 36 millions de citoyens européens participeraient régulièrement à des activités de plaisance, le secteur du tourisme nautique de l’Union européenne créerait jusqu’à 234 000 emplois et génèrerait 28 milliards d’euros de recettes annuelles (Carreño et Lloret, 2021).
Enfin, du fait de l’augmentation de la population urbaine et du tourisme de masse, les zones côtières sont particulièrement touchées par une urbanisation rapide. À titre d’exemple, en région Provence-Alpes Côte d’Azur (Paca), un quart des zones qui ont été urbanisées au cours de la période 1990-2012 se trouvent dans les 15 premiers kilomètres de la côte (Doxa et at., 2017). Cette urbanisation entraine la perte d’habitats naturels. De plus, les habitats côtiers se distinguent souvent par une diversité végétale unique et une spécialisation élevée au sein de forts gradients écologiques à de petites échelles spatiales telle que l’adaptation à des niveaux stressants de salinité, de sécheresse et de température par exemple (Doxa et at., 2017). De nombreuses plantes sont donc très vulnérables à la diminution de leurs habitats : cela rend la priorisation des actions de conservation au sein des zones côtières particulièrement urgente (Doxa et at., 2017).
Les réponses des espèces à ces perturbations sont variables : un changement de comportement comme la modification des directions de nage, une augmentation de la durée de nage, une augmentation de la cohésion de groupe, des changements physiologiques telle que la respiration chez les dauphins, voire un évitement saisonnier de certaines zones (Carreño et Lloret, 2021).

Le transport des macro-déchets est aérien, fluvial ou par déversement direct. Il existe une grande variété de sources de déchets tant terrestres que marines. Les sources identifiées comme étant d’origine terrestre comprennent les décharges municipales et sauvages, les détritus des plages et zones côtières, le tourisme, les rivières et autres émissions industrielles et agricoles, les rejets provenant des égouts pluviaux et municipaux non traités. On estime que les sources terrestres contribuent actuellement à 80 % des déchets marins (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021). Les sources importantes d’origine maritime incluent le fret, la navigation de plaisance et militaire (notamment les croiseurs), la pêche industrielle et les installations aquacoles, mais aussi l’industrie de l’énergie.
Dans l’Atlantique Nord-Est, les principales sources de déchets sont liées aux activités maritimes telles que la navigation, la pêche, l’aquaculture et les installations offshore, ainsi que le tourisme côtier (e.g. bateaux de plaisances, pêche amateur) (Ospar, 2009). Aussi, la perte, l’abandon volontaire ou l’élimination des engins de pêche est la cause principale de la production de déchets par la pêche professionnelle / industrielle (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021).

Le trafic maritime et l’aquaculture jouent un rôle clé important et prépondérant dans l’introduction des espèces envahissantes à l’échelle mondiale et régionale. Les différentes infrastructures existantes liées à ces activités tels que les marinas et les ports maritimes forment des réseaux denses le long des côtes et sont capables d’abriter de nombreux taxons d’espèces envahissantes. Ces infrastructures sont susceptibles d’être une source importante de propagules permettant par ailleurs la colonisation des milieux naturels voisins. Les fermes aquacoles sont également une autre source importante d’espèces envahissantes. L’algue comestible Undaria pinnatifida, originaire d’Asie et introduite en Europe dans les années 1970, est un exemple phare d’une EEE qui se développe dans les habitats avoisinants des sites aquacoles (Rotter et al. 2020). Les évènements d’introduction, dits “spillovers”, peuvent se produire à partir des sites d’aquaculture, comme illustré aussi par l’huître creuse Crassostrea gigas, une espèce originaire du nord-ouest de l’océan Pacifique. La propagation de ces espèces dans les sites naturels entraînent des modifications importantes de l’habitat, mais aussi du fonctionnement des écosystèmes. Elles peuvent également participer au développement de nouvelles maladies et de nouveaux parasites entraînant alors des modifications génétiques suite à des phénomènes d’hybridation avec les taxons indigènes (Rotter et al. 2020).
En mer Méditerranée, la création et l’ouverture de canaux artificiels, tel que le canal de Suez, est parmi les voies d’introduction les plus significatives, permettant la colonisation progressive des espèces, notamment d’origine indo-pacifique. Une espèce de décapode, Charybdis longicollis, a été introduite passivement, en mer Méditerranée via le canal de Suez par les courants marins, et a depuis largement établi des populations dans le bassin Levantin, la subdivision du bassin oriental de la mer Méditerranée. Une analyse prospective (cf. Tsiamis et al. 2019) a classé la gestion des populations de cette espèce comme “impossible”. Ces espèces introduites ont principalement affecté les parties orientales du bassin.
Le trafic maritime est une des sources importantes d’introduction. Sa particularité est qu’il touche des zones généralement plus étendues, en raison du déplacement des navires, que les introductions dues à l’aquaculture, les canaux artificiels ou les courants marins (Katsanevakis et al. 2016). Cette introduction, principalement “accidentelle”, se fait généralement par le biais des navires (navires de charge, navires rouliers, caboteurs, etc.) via les réservoirs d’eau de ballast, ou l’encrassement biologique dit “biofouling” de la coque des bateaux (Rotter et al. 2020). Dans l‘étude de Tsiamis et al. 2019, 26 espèces sont classées comme étant prioritaires et principalement introduites par les navires (biofouling des coques et eaux de ballast) empruntant le canal de Suez comme accès à la Méditerranée. L’étude de Katsanevakis et al. 2016 recense, de son côté, les espèces introduites par la navigation maritime présentant les scores d’impact les plus élevés. En Méditerranée, les espèces introduites par les voies de navigation maritime sont celles ayant le plus d’impacts dans de nombreux sites du centre et du nord-ouest du bassin méditerranéen, y compris le littoral oriental français, comme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Corse (Katsanevaki et al. 2016).
S’il participe très largement à l’introduction et l’établissement pérenne des espèces non-indigènes en mer méditerranéenne (Guzinski et al. 2018), le trafic maritime est également une des sources majeures de propagation des EEE dans d’autres régions océaniques à travers le monde.
Aujourd’hui, les habitats les plus à risques sont les fonds durs sublittoraux peu profonds, les fonds mous sublittoraux peu profonds et l‘espace intertidal rocheux (Katsanevaki et al. 2016).

Les communautés côtières sont en première ligne de deux facteurs importants et croissants du changement global : le changement climatique, le développement économique, qui peuvent interagir avec la possible expansion de la conservation par zone, conduisant à ce que certains auteurs appellent la « triple exposition ». Si les stratégies visant à maximiser les avantages sociaux des politiques d’adaptation à ces trois facteurs diffèrent, des processus externes peuvent parfois converger pour amplifier les vulnérabilités et les inégalités. Les injustices sociales préexistantes peuvent augmenter la sensibilité des populations aux changements sociaux, environnementaux et politiques, et peuvent limiter leur capacité à s’adapter ou à bénéficier des impacts interactifs de ce qui est parfois appelé “la triple exposition”.
Dans un article publié dans la revue One Earth le 17 février 2023, le groupe de recherche en socio-écologie Blue Justice, financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité (Cesab), soutient, au-delà de la reconnaissance d’une telle “triple exposition”, que les agences de mise en œuvre externes ne peuvent pas atteindre efficacement et équitablement les objectifs d’adaptation climatique, économiques et de conservation sans donner la priorité à la justice sociale et au renforcement de la résilience en générale.
Pour faire avancer cette orientation vers la justice et la résilience, Joachim Claudet – chercheur CNRS, David Gill, chercheur à Duke University (États-Unis), Jessica Blythe – chercheuse à Brock University (Canada), porteurs du projet Blue Justice, recommandent que les acteurs du climat, du développement et de la conservation ambitionnent :
Dans un monde en mutation rapide, ces stratégies, appliquées ensemble et adaptées au contexte local, offrent une opportunité de développer des initiatives côtières qui soutiennent le bien-être, la justice et la résilience des populations côtières.
Des mesures qui prennent tout leur sens lors de catastrophes naturelles
Pour illustrer leurs recommandations, les auteurs mettent en avant plusieurs exemples, notamment en lien avec les catastrophes naturelles. Ainsi, en 2020, alors que les efforts internationaux étaient mobilisés par la pandémie, une marée noire est survenue à l’île Maurice. C’est un groupe d’ONG locales qui s’est mis en place pour activer son réseau de bénévoles et fournir les ressources nécessaires aux premières actions de nettoyage. Le vide institutionnel initialement ressenti a contribué à la large mobilisation des communautés locales pour la fabrication et le déploiement d’un filtre “anti-marée” dans la mer. Loin d’entraver cet engagement, les institutions gouvernementales ont ensuite fourni du soutien aux groupes bénévoles jusqu’à ce que des services spécialisés de nettoyage soient formellement mobilisés et que les efforts officiels commencent. Ceci illustre donc bien l’importance des partenariats inclusifs dans la lutte face aux pressions environnementales.
Le projet Blue Justice réunit un panel international (Amérique du Nord, Angleterre, France, Australie, Fidji, Italie, etc.) de spécialistes en biologie marine, biologie de la conservation, socio-écologie et lois environnementales.

Les territoires ultramarins sont à la fois riches en biodiversité mais également exposés et fragiles face à l’incidence des changements globaux du fait de l’insularité de la plupart de ces territoires et des caractéristiques de leurs systèmes socio-économiques. Afin de mieux comprendre ces pressions, un Club FRB Recherche-action « Changements globaux et gestion durable de la biodiversité dans les territoires ultramarins » a vu le jour et permis cette étude.
Ce travail s’est concentré sur six territoires distribués sur trois bassins océaniques (Atlantique, Pacifique et Indien) : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Il a permis d’explorer l’intensité de deux des cinq pressions directes identifiées par l’Ipbes, la pollution des cours d’eau et les espèces végétales exotiques envahissantes (EEE), à l’échelle de ces sites sous forme de cartographie et de dresser des liens de causalité entre chacune des pressions et différents facteurs naturels ou anthropiques.

Définir des stratégies de conservation appropriées est un objectif difficile à atteindre, notamment en raison de la complexité des menaces et des réponses des espèces, ainsi que des limitations budgétaires. Pour surmonter ce défi, l’équipe de scientifiques, dont des chercheurs du CNRS, de l’Ifremer, de l’IRD et d’organisations internationales, a simulé la réponse des communautés d’espèces à un large éventail de perturbations, pour fournir une estimation robuste de leur vulnérabilité dans un monde où les menaces futures sont diverses et difficiles à prévoir.
Quantifier la vulnérabilité de la biodiversité est crucial pour sauvegarder les écosystèmes les plus menacés. Publié dans Nature Communications le 1er septembre 2022, ce nouvel outil se distingue des travaux précédents car il estime le degré de changement de la diversité fonctionnelle, c’est-à-dire la biodiversité et les fonctions associées des écosystèmes, lorsqu’elle est exposée à des pressions multiples. Il a été développé dans le cadre de deux projets financés par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité (Cesab) et avec le soutien d’Électricité de France (EDF) et de France Filière Pêche (FFP).
Pour calculer la vulnérabilité des écosystèmes, l’équipe de 20 scientifiques a utilisé des simulations répétées par ordinateur de perturbations sur des communautés d’espèces. Qu’il s’agisse du changement climatique, de changement d’usage des terres, de pollution ou de surexploitation des ressources, ces perturbations simulent les impacts d’un large éventail de menaces potentielles sur les communautés d’espèces. « En simulant tous les scénarios possibles, même les pires, explique Arnaud Auber, chercheur à l’Ifremer et premier auteur de la publication, nous sommes en mesure d’identifier les écosystèmes les plus vulnérables d’un point de vue fonctionnel. De plus, nous pouvons désormais estimer leur vulnérabilité en tenant compte des pressions inconnues, imprévisibles ou mal documentées, ce qui constitue une avancée majeure par rapport aux travaux précédents. » Cette approche, plus sûre, offre aux décideurs la possibilité de classer plusieurs sites en fonction de la vulnérabilité fonctionnelle qui leur est associée, et ainsi de permettre une gestion adaptative de la biodiversité.
Dans cette étude, la diversité fonctionnelle des communautés a été placée au centre du calcul de la vulnérabilité. Historiquement, la conservation de la biodiversité s’est principalement concentrée sur la diversité taxonomique (par exemple, le nombre d’espèces dans un écosystème). Cependant, des études récentes, dont des travaux du projet Free, ont montré que l’étude de la diversité fonctionnelle peut fournir une évaluation plus précise du fonctionnement d’un écosystème. En effet, une espèce peut avoir la même fonction qu’une autre (par exemple, les mêmes proies ou le même cycle de reproduction) et donc si une espèce disparaît, une autre peut toujours remplir son rôle dans l’écosystème. Mais si toutes les espèces partageant une même fonction essentielle disparaissent, l’écosystème deviendra moins diversifié sur le plan fonctionnel, moins résilient aux menaces et donc plus vulnérable. En d’autres termes, la diversité taxonomique dans un écosystème est importante mais pas suffisante pour évaluer correctement la vulnérabilité de l’écosystème. Les poissons-perroquets, par exemple, sont l’une des seules espèces de poissons qui peuvent se nourrir directement de coraux. S’ils disparaissent, une composante essentielle du cycle du carbone dans les récifs coralliens sera perdue. La diversité fonctionnelle et la diversité taxonomique sont donc complémentaires et doivent être utilisées ensemble pour mieux guider les décideurs dans l’identification des zones prioritaires pour la protection de la biodiversité.
Cette nouvelle approche peut être appliquée à tous les écosystèmes, qu’ils soient marins, terrestres ou d’eau douce. « À titre d’exemple, explique Arnaud Auber, nous avons utilisé notre outil de vulnérabilité fonctionnelle pour étudier la dynamique temporelle passée de la communauté de poissons de la mer du Nord. En utilisant les données sur l’abondance des poissons et les traits des espèces liés au fonctionnement de l’écosystème, tels que la fécondité, la taille de la progéniture et le mode d’alimentation, notre outil a révélé une vulnérabilité fonctionnelle élevée des communautés de poissons de la mer du Nord. Cependant, nous avons constaté une diminution significative de la vulnérabilité fonctionnelle au cours des quatre dernières décennies, passant de 92 à 86 %. Au cours de la même période, la pression de pêche en mer du Nord a diminué, suite à la politique commune de la pêche (en anglais Common Fisheries Policy), avec une diminution progressive des quotas de capture et une amélioration de la sélectivité des équipements. »
De plus, cet outil est en libre-accès et peut être utilisé pour prédire la vulnérabilité des écosystèmes en utilisant par exemple les scénarios de changement climatique ou pour comparer différents écosystèmes. Cette étude souligne le besoin de synthèse alors que nous cherchons à démêler la complexité de la nature. Ce n’est qu’une fois réunies que les données et les connaissances permettront de quantifier l’impact des multiples menaces qui pèsent sur les écosystèmes et d’aider les décideurs dans leurs actions de gestion et de conservation de la biodiversité dans un avenir incertain.
Référence de l’article
Arnaud Auber1, Conor Waldock2,3, Anthony Maire4, Eric Goberville5, Camille Albouy6,7, Adam C. Algar8, Matthew McLean9, Anik Brind’Amour10, Alison L. Green11, Mark Tupper12,13, Laurent Vigliola14, Kristin Kaschner15, Kathleen Kesner-Reyes16, Maria Beger17,18, Jerry Tjiputra19, Aurèle Toussaint20, Cyrille Violle21, Nicolas Mouquet22,23, Wilfried Thuiller24, David Mouillot23,25. “A functional vulnerability framework for biodiversity conservation”. 2022. Nature Communications. doi: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32331-y/



Depuis quand une certaine tendance à la privatisation des espaces naturels s’est-elle développée ?
La privatisation est une idée très présente dans les politiques de conservation depuis les années 1980. Cette idée est liée au tournant néo-libéral dans les campagnes de conservation de l’environnement. Dans les pays du sud, elle était associée à des injonctions faites par les bailleurs de fonds à développer des droits de façon systématique, à la fois sur le foncier et sur les ressources. Dans l’imaginaire associé aux politiques de conservation, l’idée selon laquelle on ne peut conserver ou gérer que ce que l’on possède était très présente. Pour cela, il devait alors exister des droits de propriété sur les ressources sauvages pour qu’elles soient gérées de façon adéquate. De plus, dans ces années-là, s’opposer au marché ne semblait pas efficace. Il était plus judicieux d’envisager une exploitation durable des ressources. L’idée qu’on peut sauver la nature en l’exploitant relevait d’une question de pragmatisme. Quand on constate qu’on ne parvient pas à s’opposer aux pratiques illégales comme le braconnage, il relève du bon sens de se tourner vers des efforts de traçabilité des ressources sauvages exploitées plutôt que de tenter de prohiber ces marchés.
Quelles ont été les premières applications de ce modèle de gestion ?
Les premiers projets, très débattus, concernaient les espèces menacées de la faune et de la flore. Ces débats étaient liés à la Convention de Washington de 1973 (la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction – Cites) ou à des aspirations à déclasser certaines populations, notamment celles d’éléphants d’Afrique australe. Certains pays considéraient qu’après les efforts engagés pour le développement d’aires protégées, des populations d’éléphants étaient trop importantes au regard de la superficie des aires. Ainsi, accorder la gestion des droits de chasse à des communautés en périphérie des parcs nationaux pouvait être une solution. Or, si les populations d’éléphants ont pu augmenter, c’est avant tout grâce aux parcs nationaux.
La mise en place de ce modèle de gestion est-il efficace ?
Du point de vue de l’efficacité, la privatisation est difficilement justifiable. Il est difficile d’isoler ces effets de celles des politiques passées. Et on ne dispose pas d’évaluations de l’efficacité intrinsèque de l’outil consistant à développer des droits de propriété, cependant, il a été mis en avant pour d’autres critères. Par exemple, pour des questions d’équité et pour répondre à des mouvements sociaux. De nombreuses ONG s’élèvent contre des politiques de conservation publiques excluant les populations locales, les privant d’accès à un certain nombre de ressources. Le modèle privé propose d’accéder à des ressources économiques en échange de ressources biologiques. Malgré tout, il existe dans l’imaginaire économique dominant d’inspiration libérale l’idée selon laquelle la propriété est associée à la responsabilité et à la bonne gestion. Mais il n’existe pas de démonstration théorique de la supériorité de la propriété privée sur d’autres formes d’appropriation : cette idée est purement idéologique.
Le modèle privé peut-il remplacer une gestion publique de l’environnement ?
Bien souvent, la privatisation est envisagée en complément d’efforts mis en place à travers des politiques publiques. Le but est de les prolonger sur de nouveaux espaces, car les réserves foncières allouées à la conservation sont limitées et s’appuyer sur des intérêts privés est un moyen de conserver plus de territoires. C’est ce qui est mis en avant pour justifier les projets de banques de conservation.
Cela peut-il favoriser le développement local et les valeurs locales associées à la nature ?
Exclure les populations locales des politiques et des espaces dédiés à la conservation est injustifiable d’un point de vue éthique et politique. Il existe de plus en plus de lectures décoloniales des politiques de conservation qui accusent les parcs nationaux de fonctionner sur des représentations de la conservation occidentales. Ces nouvelles lectures rejettent le principe qu’au nom de la préservation de la biodiversité, qui est un patrimoine commun de l’humanité, on impose des restrictions d’usages à des populations locales dans des États souverains. C’est une forme d’impérialisme vert.
Il y a eu un engouement certain il y a une dizaine d’années pour ce modèle de gestion. Pourquoi cet élan s’est-il essoufflé aujourd’hui ?
Comme tout ce qui touche à l’exploitation des ressources dans la perspective de les sauver ou de les conserver, il existe des limites qui sont celles des marchés. Si on décide de s’appuyer sur l’exploitation économique d’un écosystème pour en tirer des revenus suffisants utiles à une conservation à grande échelle, il faut qu’il y ait de la demande. Lorsque ces modèles ont été mis en place, les marchés n’étaient pas forcément au rendez-vous, aucune étude de marché n’ayant réellement été réalisée en amont. Pour que l’économie puisse être un argument, il faut de vrais revenus.
Que pensez-vous des prises de positions fortes quant à la direction à prendre pour la gestion de l’environnement ?
Le danger de telles propositions, c’est de les préconiser d’un point de vue globale et d’en faire des solutions. Si on associe la conservation de la forêt tropicale à l’exploitation des produits non ligneux ou des molécules naturelles qu’elle contient et qui pourraient être utilisées pour la cosmétique ou l’industrie pharmaceutique, cela signifie que des marchés doivent se développer. Il faut que la demande en ressources issues des milieux naturels soit suffisant pour devenir un levier afin de conserver l’environnement. Or, il existe des écosystèmes ayant un grand intérêt biologique en termes de diversité mais qui ne recèlent pas pour autant de produits d’intérêt pour les marchés. Il n’existe pas de corrélation entre les deux.
Existe-t-il des exemples d’évolution de programmes basés sur un tel modèle de gestion ?
Je pense au programme de gestion Gelose (Gestion localisée et sécurisée), mis en place à Madagascar et qui visait à donner aux communautés locales des droits sur la forêt et sur les ressources naturelles. Les difficultés de mettre sur pied des institutions de gestion locale se sont multipliées. Il y a eu des problèmes de gouvernance et de capture par des élites avantagées. C’est aussi ce qu’il s’est passé avec le programme Campfire qui visait à associer à la gestion de droits de chasse des populations vivant en périphérie de parcs nationaux au Zimbabwe. Le programme a fait beaucoup parler de lui, mais les résultats n’ont pas été probants. Généralement, lorsque les financements cessent, les projets disparaissent. On pourrait dire que c’est un prolongement de ce rapport colonial qu’un certain nombre d’ONG contestaient dans la gestion publique. Donner des droits d’un genre nouveau sur des usages nouveaux encadrés de manière très spécifique par des populations qui n’ont pas forcément les formes d’organisation et les instances pour se saisir efficacement de tout ça, c’est souvent difficile.
Vers quel modèle devrions-nous nous tourner à l’avenir ?
C’est difficile de renoncer à un modèle unique. L’important, c’est de ne pas tout miser sur l’économie, qui a été très présente. Il faut arrêter de penser que les arguments et incitations monétaires sont les seuls arguments perceptibles par les acteurs, qu’il s’agisse du grand public ou des politiques. Les choix d’aménagement du territoire et de conservation de l’environnement sont des questions complexes. Il faut remettre l’économie à sa place en prenant conscience que les représentations qu’on s’en fait dans le monde de la conservation sont plus idéologiques que théoriques et ne correspondent pas toujours à la réalité des pratiques économiques.

Quel a été le point de départ à l’origine de la création de La Salamandre ?
Tout a commencé par une enfance à la campagne, remplie de balades dans la nature, qui m’ont permis de satisfaire la curiosité que j’avais pour le monde du vivant. Quand j’étais enfant, j’ai très vite eu conscience que la nature déclinait, ce qui a suscité beaucoup de colère et de tristesse. Alors je me suis demandé ce que je pouvais faire, à ma modeste échelle. Et comme j’avais beaucoup de plaisir à partager cette passion pour la nature, je me suis dit que j’allais créer un petit journal avec le peu de moyens que j’avais. J’ai commencé à taper sur une vieille machine à écrire héritée de mon grand-père. J’ai d’abord écrit sur les crapauds, les pissenlits, les hirondelles, etc. Et La Salamandre est née. Depuis les choses ont bien changé ! Aujourd’hui, les jeunes feraient un podcast, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, mais à l’époque tout ça n’existait pas encore.
Quels sont les principaux objectifs que vous aviez en créant la revue ?
Pour nous, l’objectif n’est pas que les gens connaissent la biodiversité dans ses moindres détails. On ne veut pas former de parfaits naturalistes. Notre but est de reconnecter les gens au monde du vivant en passant par les émotions. On essaie de raconter des histoires pour créer de l’empathie. En étant touché par ces histoires, le vivant reprend de la valeur.
Comment faites-vous pour continuer à toucher le public ?
Pour toucher le plus de monde, nous essayons de multiplier les formats. En plus des différentes revues que l’on propose, nous éditons entre dix et quinze livres chaque année. Nous produisons aussi des documentaires animaliers et nous organisons un grand festival annuel en Suisse. Aujourd’hui, nous essayons de mettre davantage l’accent sur le numérique pour toucher les jeunes. Une des spécificités de La Salamandre est de véhiculer un message très positif, même s’il est de plus en plus difficile. On a tous besoin de ça, de continuer à montrer le beau et le positif pour que les humains continuent à prendre soin d’eux en prenant soin de la nature.
Pensez-vous que réapprendre au public à observer la vie sauvage peut permettre de retisser durablement les liens entre l’humain et la nature ? Le prochain rapport de l’Ipbes consacré à l’utilisation durable des espèces sauvages traitera de l’observation de la nature comme d’une activité « non extractive ». Elle n’est donc pas sans impact…
Comment peut-on se sentir concerné par quelque chose avec lequel on a complètement perdu contact ? Si je vis en ville et que je passe la moitié de mon temps les yeux collés à un écran, comment puis-je me sentir concerné par la protection de la forêt, des oiseaux et des insectes ? Il est indispensable de retisser le lien entre l’humain et la nature. Aujourd’hui, les écosystèmes naturels subissent des pressions sans précédent, la population humaine ne cesse de croitre et le simple fait d’aller dans la nature et de l’observer peut avoir un effet délétère. Pendant la pandémie de la Covid-19, les gens ont moins voyagé pendant environ 2 ans, ce qui a été une bonne chose pour la biosphère. Mais d’un autre côté, la pression sur les écosystèmes provoquée par les loisirs de plein air s’est intensifiée. Ce paradoxe-là n’est pas facile à gérer. Notre rôle est de recréer du lien en invitant les gens à sortir, certes, mais aussi à observer, à s’émerveiller et à remettre en question certains de leurs comportements et de leurs pratiques.
Considérez-vous que l’éducation à l’environnement puisse être un réel changement transformateur ?
Malheureusement, je crois que jusqu’ici, force est de constater qu’elle ne l’a pas été. Ça fait quarante ans que c’est mon métier et qu’avec mon équipe nous sensibilisons des centaines de milliers de gens, à côté de nombreuses autres organisations qui le font à plus grande échelle encore. Pourtant, le monde continue de courir à la catastrophe. Je pense qu’il faudrait changer d’échelle pour que cela devienne un changement transformateur. Dans nos sociétés occidentales, aujourd’hui, il y a un vrai problème culturel, notamment en France. La nature n’est pas considérée comme un sujet important ou même sérieux. Au premier plan, il y a la culture, toutes ces œuvres magnifiques que créent les humains. Aujourd’hui, on parle de sujets comme la protection de la ruralité ou de questions comme celles liées aux pratiques de chasses. Mais au fond, la biodiversité n’a pas l’air d’être culturellement quelque chose d’important. Ça évolue dans le bon sens, bien sûr, mais encore trop lentement. Je pense qu’il y a encore cet héritage des philosophes du siècle des Lumières qui est bien ancré dans les mentalités. Il faut comprendre qu’en détruisant la nature, on détruit l’être humain.
Comment remédier à ce constat d’échec ?
J’ai récemment rencontré le philosophe Baptiste Morizot dont je trouve la pensée très nourrissante et dont je partage le diagnostic. Le mot de « nature » accumule un peu les casseroles. Déjà la nature, c’est futile par rapport à cette magnifique culture créée par les humains. Et c’est aussi un peu infantilisant. A la rédaction, on s’en rend bien compte. Quand on présente notre travail à des personnes qui ne nous connaissent pas, ils nous répondent souvent : « Ah, c’est super ! Je vais montrer ça à mes enfants ». Or, la nature est un sujet sérieux qui concerne tout le monde. Le mot de nature est presque devenu infantilisant. Je pense que la première chose à faire est de changer le discours et de parler par exemple de « monde vivant », qui est bien plus puissant car il nous inclut directement. Ensuite, il faut être plus attentif à nos systèmes éducatifs. Il y a une véritable révolution à faire dans ce domaine.
Participez-vous à cette révolution de l’éducation ?
Complètement. Nous avons édité un livre qui s’appelle « L’école à ciel ouvert », un manuel pour les enseignants qui respecte les programmes des écoles suisses et françaises. Le propos de ce livre est de montrer aux enseignants que tout peut être appris dans la nature. On peut faire des mathématiques, de l’anglais, de la physique et de la géographie dans la forêt. Le but n’est pas juste de faire des sorties dans la nature une fois par mois pour apprendre le nom des arbres, mais de faire toute l’école en lien avec le monde vivant. Les vertus pédagogiques sont nombreuses ! Les enfants peuvent établir un vrai lien à la nature, tout en bénéficiant d’un cadre sain et propice à l’expérience. C’est encourageant, car ce livre rencontre un grand succès, encore aujourd’hui. Ce genre d’initiative est importante, parce que là, on est sûr de toucher tout le monde. En visant les écoles, on touche aussi les adultes. On entend souvent le discours qui consiste à dire que « c’est important de sensibiliser les jeunes, car ce sont eux qui dans 20 ou 30 ans vont devoir corriger nos erreurs ». Mais on ne peut plus dire cela aujourd’hui. Les changements doivent venir maintenant. En sensibilisant les enfants, ils deviennent des alliés pour amener à des changements de comportements des adultes, peut-être de manière plus rapide qu’en sensibilisant directement les adultes. Les enfants sont un peu comme des catalyseurs de changements sociétaux. En les sensibilisant, notre cible est aussi les adultes qui sont les décideurs d’aujourd’hui.




Le verbe gérer, selon le dictionnaire, signifie organiser les choses en s’adaptant à la situation, et donc faire face à une réalité forcément évolutive. Dans ce cadre, l’expression « gestion adaptative » semble s’apparenter à un pléonasme. Un gestionnaire qui ne s’adapterait pas à l’évolution de son environnement n’aurait, en effet, que peu d’avenir, sauf celui de se faire qualifier de « mauvais gestionnaire », de perdre la confiance de ses mandants et, in fine, de se voir retirer la responsabilité qui lui avait été confiée.


Qu’est-ce que la gestion adaptative de la chasse ?
Cette mesure vise à ajuster les prélèvements en fonction de l’état de conservation des espèces chassées, en s’appuyant à la fois sur la concertation des parties prenantes et sur les données scientifiques. Elle a été introduite en France dans la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité (OFB). Réglementairement, il y a, aujourd’hui quatre espèces soumises à la gestion adaptative : la tourterelle des bois, le grand tétras, la barge à queue noire et le courlis cendré. Mais l’idée est de l’étendre à toutes les espèces exploitées, non seulement chassables mais aussi peut-être un jour pêchables.
En quoi cette gestion diffère de ce qui était précédemment mis en place ?
Jusqu’à présent aucune réglementation, sauf quelques rares exceptions concernant surtout les espèces sédentaires, ne s’appliquait au nombre à prélever. La régulation des prélèvements, pour la chasse des oiseaux, se faisait essentiellement par la durée de la saison de chasse. Or avant l’arrivée de cette modalité de gestion, les chasseurs pouvaient avoir tendance à considérer certains gibiers, et notamment les oiseaux migrateurs, comme une manne infinie qu’ils pouvaient prélever à satiété. La chasse, entre le milieu du 19e et le début du 20e siècle, a pu ainsi prendre des allures industrielles pour les besoins de certaines industries comme la chapellerie : les plumes étant très prisées pour décorer les chapeaux, ou l’agroalimentaires avec les usines de conserves de canards sauvages dans le nord de l’Europe. Des millions d’oiseaux ont été prélevés à cet effet. Mais ces prélèvements illimités n’ont pas pu durer très longtemps, car les populations ont fortement diminué, atteignant a priori leurs niveaux les plus bas à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Des réglementations ont alors vu le jour. Les saisons de la chasse se sont raccourcies, certaines espèces en danger critique ont été placées sous statut de protection. La chasse d’autres espèces, comme les petits oiseaux, tel le rouge gorge, pour des raisons éthiques a été interdite. Si toutes ces régulations combinées ont permis d’atténuer le déclin de certaines espèces, il n’était pas encore question du volume des prélèvements. Un chasseur pouvait, sur une période donnée, prélever autant d’individus d’une espèce qu’il le souhaitait, pourvu que la chasse soit ouverte, et que certaines limites ne soient pas imposées localement par les sociétés de chasse.
Comment la gestion adaptative a-t-elle vu le jour ?
Elle a été introduite en Amérique du nord dans les années 1990 pour la chasse des oiseaux d’eau, les anatidés. À cette époque, des épisodes de sécheresse ont provoqué le déclin de certaines populations de canards et les questions qui se posaient alors étaient les suivantes : la chasse avait-elle un effet additionnel ou, comme le suggérait une étude, la chasse n’avait qu’un rôle compensatoire à la mortalité naturelle, autrement dit les oiseaux seraient morts à cette période d’une façon ou d’une autre ? Ce défaut de connaissances conduisait à l’impossibilité de proposer des quotas sur lesquels tout le monde pouvait s’accorder. Si la chasse prélève des oiseaux qui mourront par ailleurs, pourquoi alors en limiter les prélèvements ?
Comment les parties prenantes se sont accordées ?
Un groupe de scientifiques a proposé de mettre en place une gestion adaptative des prélèvements d’oiseaux d’eau, dans le but d’encadrer la pratique de la chasse, mais aussi d’améliorer simultanément les connaissances et l’état de conservation des espèces. Ils ont réuni différentes parties prenantes comme les instances fédérales, les chasseurs et les naturalistes pour s’accorder à la fois sur des tailles de population cibles et sur une réglementation avant le début de la saison de chasse. Les populations d’anatidés ont alors été suivies durant l’année pour être ensuite confrontées aux prédictions de différents modèles, de manière à faire évoluer la connaissance du fonctionnement du système. Si les connaissances collectées depuis 1995 ont conclu que la chasse jouait bien un rôle additif à la mortalité naturelle des anatidés, les mesures mises en place, ont permis à ces populations d’oiseaux d’aller nettement mieux. Les objectifs de taille de populations initialement visés ont été pour la plupart des espèces très largement dépassés depuis.
À partir de quand la France a-t-elle choisi d’adopter ce modèle ?
Au début des années 2000, en France, une grande tension agitait les défenseurs de la nature et les chasseurs. Les débats portaient sur les volumes de prélèvements ou les périodes de chasse, pour l’oie cendrée ou la tourterelle des bois par exemple. Les bons résultats de la gestion adaptative conduite en Amérique du Nord sont parvenus jusqu’en France. Ce modèle est apparu aux yeux de tous comme un modèle de gestion durable, car fondé sur les connaissances et permettant aux parties prenantes de se mettre autour d’une table et de s’accorder. La gestion adaptative a été graduellement introduite en Europe pour les différentes espèces d’oies, puis en France pour certaines espèces d’oiseaux sédentaires ou migrateurs.
Comment cette gestion a-t-elle été accueillie par les parties prenantes ?
Les dissensions résident dans la manière dont cette gestion adaptative doit être appliquée : faut-il utiliser tel ou tel modèle de dynamique de population ? Lorsqu’une incertitude apparaît, faut-il faire valoir le principe de précaution ? etc. De façon générale les chasseurs acceptent le principe des quotas et le suivi scientifique pour déterminer les causes premières du déclin des espèces chassées, mais ils estiment qu’ils n’en sont pas forcément directement responsables et qu’ils paient le prix pour les autres. Selon eux, il est plus facile de réglementer la chasse qui est un loisir que de modifier les pratiques agricoles qui dans bien des cas sont les causes directes du déclin des oiseaux. C’est le cas par exemple de la tourterelle des bois qui a vu ses populations chuter à cause de la perte d’habitat liées à l’agriculture. Sa taille de population est devenue si faible qu’elles ne peuvent aujourd’hui plus soutenir le prélèvement et sa chasse est actuellement suspendue.
Quels impacts concrets la gestion adaptative va avoir sur les pratiques de chasse ?
Elle va impliquer certaines contraintes, en particulier l’existence de quotas de prélèvements et l’obligation pour les chasseurs de renvoyer chaque année leur tableau de chasse rapidement après la fin de la saison. Mais cette gestion adaptative leur promet aussi un gibier globalement abondant grâce à la réglementation sur les prélèvements ou la période de chasse qui fluctuera en fonction de l’état et des connaissances des populations cibles.
Quand sera-t-elle appliquée aux autres espèces ?
Cette gestion est encouragée par l’Europe. Il est probable que dans les cinq prochaines années, elle soit mise en place pour une grande partie des 90 autres espèces qui aujourd’hui sont chassables en France.


Quel a été pour vous le point de bascule qui vous a poussé à vouloir faire évoluer le commerce des produits de la pêche ?
Au début de ma carrière d’ingénieur agro-halieute, je me suis retrouvé pendant un an sur les bateaux et j’ai pris conscience de tout ce que j’avais théorisé pendant mes études. C’est-à-dire que les pêcheurs ne savent jamais ce qu’ils vont attraper, ni quand ils vont pouvoir sortir en mer, ni même combien ils vont pouvoir vendre leurs prises : bref, ils sont soumis à une grande instabilité. Le plus souvent, j’ai rencontré des équipages déçus d’avoir trimé dans la tempête pendant plusieurs heures pour finalement très mal vendre leur produit. Certains me disaient : “Moi, je vends en direct. De cette manière, je valorise mieux mon poisson et je peux me permettre de ne pas aller en mer quand le temps est mauvais”.
Qu’avez-vous mis en place pour répondre à cette prise de conscience ?
Au début, pas grand-chose… Je me suis retrouvé à travailler à la direction des pêches du ministère de l’agriculture où je subventionnais des projets de recherche et développement ou d’investissements à bord de navires. Mais petit à petit, je me suis intégré dans les systèmes d’Amap et j’ai découvert ces offres de paniers avec de super produits, bons, provenant directement du producteur, bien payés et issus de pratiques vertueuses. Là, je me suis dit qu’il fallait faire la même chose avec la pêche.
Quelles sont les valeurs que cherchent les consommateurs en se tournant vers vous ?
Récemment, nous avons fait un sondage auprès de nos abonnés. On distingue deux cas. Les plus anciens clients nous disent que c’est la qualité du produit et le goût qui fait la différence. Je pense que l’on n’est pas tombé dans l’écueil de certains produits issus du commerce équitable ou du vin bio qui proposent de bonnes valeurs mais qui n’offrent pas de bons produits. Pour les abonnés plus récents, la différence se fait sur l’engagement de durabilité qui est associé à une certaine valeur de confiance. Aujourd’hui, les gens se méfient des labels. Nous mettons en avant des produits frais, durables et éthiques, avec derrière une véritable transparence et de vrais critères.
Qu’est-ce qui fait que votre activité est durable ?
D’abord, nous travaillons avec certains types de navires de manière exclusive. C’est-à-dire que nous ne mettons dans nos paniers que des produits issus de la petite pêche côtière. Concrètement, cela signifie que nous ne travaillons qu’avec des bateaux de 12 mètres au plus qui sortent à la journée uniquement et qui embarquent trois marins au maximum pour la pêche au filet. Mais nous avons aussi des critères techniques. Nous ne travaillons qu’avec des pêcheurs qui utilisent des techniques douces ou passives. Concrètement, il s’agit d’engins que l’on pose dans l’eau et que l’on revient chercher plus tard comme des hameçons, des lignes, des casiers ou des filets. Nous valorisons aussi la pêche à la main, en plongée ou à pied. Évidemment, nous refusons de travailler avec des pêcheurs qui utilisent des chaluts ou des dragues qui, selon les scientifiques, abîment les fonds marins. Nous faisons aussi attention à la sélectivité : nous achetons ce qui est pêché, même s’il s’agit de poissons peu connus par le consommateur.
Comment rémunérez-vous vos pêcheurs ?
Aujourd’hui, c’est assez hétérogène. Il y a les poissons les plus demandés payés quasiment au prix du marché, comme les bars, les soles ou les turbots. Et pour les espèces moins connues, nous payons beaucoup plus. Globalement, nous nous engageons à payer 20 % de plus que le marché.
Qui sont les pêcheurs qui travaillent avec vous ?
On rencontre des pêcheurs qui sentent que leur filière n’est pas assez valorisée. Il n’y a pas de “bio” pour la pêche, donc pas de possibilité pour les pêcheurs d’afficher clairement leurs pratiques vertueuses. Pour moi, un défaut des certifications “pêche durable”, c’est qu’elles veulent absolument raisonner à l’échelle de la pêcherie et non à celle du pêcheur. Je pense que tout pêcheur ayant des pratiques objectivement vertueuses devrait pouvoir être labellisé. Ce sont ces pêcheurs-là que l’on va chercher, ceux qui n’arrivent pas à travailler à petite échelle parce que la filière ne les met pas en valeur et ne les rémunère pas assez. On travaille aussi avec de nombreux pêcheurs qui s’installent, qui font peu de volume et pour lesquels il est plus facile de vendre aussi les espèces habituellement dénigrées par le marché.
Pour les pêcheurs, ça change quoi concrètement ?
Ce que nous voyons aujourd’hui avec les sondages que l’on fait auprès de nos pêcheurs, c’est que 30 % d’entre eux nous vendent des espèces qu’ils jetaient à la poubelle auparavant. En réduisant ce gaspillage, on réduit considérablement la pression sur les autres espèces habituellement plus exploitées. D’autres nous déclarent pouvoir se permettre de mettre moins d’engins en mer, de passer moins de temps à pêcher, de mettre moins de longueurs de filets, ce qui, encore une fois, réduit la pression de pêche.
Est-ce que ce système peut s’étendre à une plus grande échelle et devenir un vrai changement transformateur ?
C’est le rêve que l’on avait au départ. Nos objectifs premiers sont d’assurer des bons prix toute l’année et de voir, grâce à ce système de paniers qui assure l’écoulement de nos produits, que les stocks de poissons s’améliorent. D’ailleurs, nous avons des scientifiques qui évaluent actuellement notre impact en mesurant l’activité des bateaux, les quantités attrapées et les nombres de jours passés en mer. Vendre du poisson, c’est juste un moyen d’arriver à cette fin, de créer un levier en payant mieux les pêcheurs, au lieu d’attendre que les stocks de poissons soient dégradés à un tel point qu’il faille soumettre les pêcheurs à des mesures coercitives comme l’instauration de quotas parfois inadaptés et en décalage avec la réalité économique.
Quels sont vos prochains challenges ?
La prochaine étape, c’est d’inciter de nouveaux professionnels à se conformer à nos critères de durabilité, pour valoriser le mouvement des nouveaux pêcheurs qui s’installent et qui pratiquent la pêche à la ligne ou au casier. Il faut les aider à transformer plus en profondeur la filière. Aujourd’hui, il y a un vrai risque de rachat des petits bateaux. L’idéal serait de faire l’inverse : sanctuariser de petits bateaux, voire acheter des gros bateaux pour les transformer en petits. Le jour où l’on arrivera à obtenir un volume suffisamment important et où l’on pourra dire à un pêcheur qui fait 50 tonnes de poissons dans l’année qu’on est là pour lui, on deviendra un vrai levier.


En 2019, une évaluation mondiale de la biodiversité et des services dont dépend l’humanité – comme la pollinisation des cultures, l’épuration de l’air et de l’eau, la fertilité des sols, la récréation, la lutte contre le changement climatique – a mis en évidence la responsabilité de nos activités et de nos modes de vie.
Pour limiter les pression directes et indirectes qui s’exercent sur la biodiversité, les chercheurs démontrent qu’il est indispensable de protéger le vivant, de restaurer les milieux dégradés, d’utiliser durablement les ressources naturelles et de tendre vers un partage juste et équitable des avantages tirés de la nature. Dans une tribune publiée sur son site internet, la FRB et ses partenaires ont appelé à mettre en œuvre le changement transformateur préconisé par la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) et nécessaire pour vivre en harmonie avec le reste du vivant.
C’est à présent au tour des candidats de se saisir de cet enjeu majeur. Or, dans les programmes, il est question du climat, de chasse, de justice sociale, d’économie, de santé… Tous ces enjeux sont importants, mais alors qu’ils sont intimement liés à la biodiversité, ils ne la mentionnent que marginalement.
Dans le contexte de discussions nationales autour de la troisième stratégie pour la biodiversité et international autour du cadre post-2020 pour vivre en harmonie avec la nature, il est temps de s’intéresser au vivant, car les chercheurs démontrent aussi que sans une biodiversité intègre et fonctionnelle, l’humanité ne pourra pas survivre plus de quelques centaines d’années. Considérant qu’en moyenne une espèce vivante vit plus de 4 millions d’années, notre espèce, Homo sapiens ayant quelques 300 000 ans, il nous reste du chemin à parcourir…
À quelques jours des élections présidentielles 2022, découvrez comment les programmes ont transcrit les alertes des scientifiques et quelles mesures en lien avec la biodiversité sont mises en avant (cf par thématique en bas de page).
L’Assemblée des Parties prenantes de la FRB a participé à l’identification de différentes thématiques considérées comme prioritaires pour la réalisation du changement transformateur nécessaire afin de vivre en harmonie avec le reste du vivant. Les différentes mesures extraites des programmes sont présentées dans ce dossier (cf bas de page ou encart sur la droite) et les candidats sont invités à s’exprimer sur ces enjeux environnementaux.
“Mesdames et Messieurs les candidats à l’élection présidentielle, êtes-vous prêts à changer le cours de notre histoire commune avec la biodiversité ?” Consultez la tribune.

Économie et fiscalité, des enjeux biodiversité
Les pressions exercées sur la biodiversité augmentent fortement depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Elles sont causées par des déterminants qui dépendent beaucoup de la façon dont s’est développé notre modèle économique et les activités qui en découlent.
Ces modes de développement, qui ont entrainé une croissance ininterrompue de la consommation des ressources naturelles au niveau global, voire de surconsommation, mettent ainsi en péril la capacité des écosystèmes à fournir les services dont ils dépendent. En outre, la fiscalité telle qu’elle est imaginée aujourd’hui sur le territoire français est défavorable à la préservation de la biodiversité. Comme le souligne Guillaume Sainteny : “Il n’existe pas véritablement de fiscalité de la biodiversité, mais plutôt une fiscalité qui s’est historiquement construite sans tenir compte de ses effets sur la biodiversité”.
Sont ici compilées toutes les mesures proposées par les candidat·es qui soient de nature à peser sur les activités économiques en ayant un impact sur la biodiversité, ou mesures fiscales incitatives ou punitives liées à la biodiversité.
Les mesures des candidat·e·s :

Changement climatique et transition énergétique, un enjeu biodiversité
Convaincue que la biodiversité et le climat sont deux enjeux environnementaux complémentaires qui, s’ils s’ignoraient entraineraient des difficultés supplémentaires, la Fondation alerte sur les liens complexes entre changement climatique et déclin de la biodiversité. L’atténuation du changement climatique repose pour une large part sur la transition énergétique, c’est-à-dire l’abandon des sources d’énergie fondées sur le carbone fossile au profit des énergies renouvelables. Cet objectif national et européen majeur suscite des développements technologiques et d’importants investissements. Or les infrastructures développées peuvent avoir des impacts multiples, et surtout non anticipés, sur la biodiversité et en particulier sur le fonctionnement des écosystèmes. Il est donc aujourd’hui indispensable de concilier défi énergétique et préservation de la biodiversité.
Pour ces élections, les débats énergétiques sont particulièrement centrés sur les questions nucléaires, l’acceptabilité des énergies renouvelables et notamment la question des éoliennes ou encore la rénovation thermique des bâtiments. Les impacts de ces différents développements sont peu ou pas mentionnés, ce qui peut à court terme être préjudiciable à la biodiversité et par contre coup préjudiciable à la lutte contre le changement climatique.
Les mesures des candidat·e·s :

La santé, un enjeu biodiversité
L’érosion massive de la biodiversité et de ses services écosystémiques menacent la santé humaine de multiples façons. En premier lieu par le biais de notre alimentation : sa diversité, sa qualité nutritionnelle dépendent de la diversité biologique et d’écosystèmes fonctionnels. Ensuite, la perte de biodiversité aggrave les évènements climatiques extrêmes, perturbe la capacité des écosystèmes à stocker du carbone, à épurer l’eau, l’air et les sols, à réguler les pathogènes, entrainant des décès et des pertes de qualité de vie. L’effondrement du vivant, enfin, impacte le bien-être humain par la perte des possibilités d’apprentissages, d’inspiration, la perte de l’identité liés aux paysages et des expériences physiques et psychologiques en lien avec le nature.
La pandémie récente a mis en lumière les liens entre notre santé et la déforestation, le braconnage et le commerce d’animaux et de végétaux sauvages, le changement climatique, la faible diversité génétique et spécifique dans les champs et les élevages, ou encore la croyance que c’est en décimant des populations, en perturbant des écosystèmes, que l’on va réduire les maladies.
Les maladies émergentes, comme Zika, Chikungunya, les résurgences croissantes de maladies anciennes, comme la grippe aviaire, la brucellose et autres zoonoses, sur le territoire national, menaçant la viabilité de certaines filières agricoles montre l’importance de la question. Ces pandémies proviennent de divers pathogènes transportés par des réservoirs animaux mais leur émergence est en très grande partie due à un manque de compréhension des milieux sauvages, une mauvaise gestion de ces derniers, une trop faible diversité chez les espèces cultivées, élevages.
Les mesures des candidat·e·s :

Droit et gouvernance, des enjeux biodiversité
La prise en compte de la biodiversité et l’établissement de mesures visant à améliorer sa conservation suppose divers cadres légaux, administratifs et de gouvernance.
Les compétences associées à cette mission peuvent être imaginées à différentes échelles de territoire : locale, régionale, nationale, ou même transférée aux niveaux européen et international. En outre, la coopération entre États, les partenariats à renforcer ou à tisser, ou encore le dosage d’interventionnisme peuvent faire l’objet d’une redéfinition stratégique.
Sont listées ci-dessous les mesures envisagées par les candidat·es ayant trait à ce maillage politique, juridique et administratif, de nature à redessiner ou réaffirmer les contours de cette gouvernance de la biodiversité.
Les mesures des candidat·e·s :

Agriculture et pêche, des enjeux biodiversité
Mal gérée, trop intensive, l’agriculture peut entrainer pollution, érosion des sols et de la biodiversité sauvage, transformation des habitats et déforestation, réduisant d’autant plus, à terme, le potentiel productif. Et ce, alors que les besoins alimentaires vont croissant. L’évolution de la demande des consommateurs et les incertitudes face au changement climatique nécessitent de remettre les fonctionnements écologiques au cœur de l’agrosystème, afin de rendre notre agriculture plus durable, tout en préservant et valorisant l’ensemble de ses diversités.
Par ailleurs, on observe une chute drastique des populations de poissons, notamment due à une surexploitation de certaines espèces, déclins des points chauds de diversité marine tels que les récifs coralliaires en raison du changement climatique, des pollutions, voire du tourisme, d’où la nécessité de proposer des mesures de protection à l’égard de la biodiversité marine et aquatique.
Nous avons ici regroupé l’ensemble des mesures qui ont pour objectifs d’enrayer de manière directe l’érosion de la biodiversité en lien avec l’agriculture et la pêche. Les mesures favorisant une transition écologique s’intégrant à la thématique identifiée et ayant un impact indirect sur l’érosion de la biodiversité ont également été recensées ci-dessous.
Les mesures des candidat·e·s :

Des enjeux liés à la recherche sur la biodiversité
Comprendre le comportement des différentes espèces, les interactions entre elles et avec les êtres humains, l’évolution des écosystèmes, des espèces, des individus, des gênes, l’histoire du vivant sur notre planète, établir des modèles et scénarios pour mieux anticiper l’impact de notre empreinte sur le vivant pour les années à venir sont autant de pré-requis pour une cohabitation soutenable et une préservation efficace de la biodiversité.
Pour protéger la biodiversité, il est primordial de la connaitre. Dans cette optique, le développement et le financement de la recherche ainsi que son accessibilité au plus grand nombre sont des éléments primordiaux pour protéger la biodiversité. Ceci entre en résonance directe avec les missions principales de la Fondation, à savoir soutenir la recherche, agir avec et diffuser les connaissances.
Les mesures compilées ici et proposées par les candidat·es sont relatives à la recherche, au développement et à l’innovation autour des questions environnementales et de biodiversité. Il est ainsi question de l’organisation de la recherche, des moyens qui y seront alloués, des priorités de recherche (tant en termes de milieux que de finalités).
Les mesures des candidat·e·s :

Utilisation des espèces sauvages, un enjeu biodiversité
Les espèces sauvages sont soumises à l’utilisation par l’humain à différentes fins : de subsistance, commerciales, récréatives ou culturelles. Les activités de prélèvement telles que la pêche, la chasse, la cueillette et l’exploitation des forêts naturelles par opposition aux plantations sont les principales formes d’utilisation des espèces sauvages.
Au niveau mondial, l’Ipbes estime qu’il s’agit d’une des cinq causes majeures perte de biodiversité. Il est donc nécessaire de garantir une exploitation durable des organismes afin d’enrayer l’érosion du vivant.
Les mesures listées ci-après sont celles qui nous ont paru concerner directement les espèces sauvages (terrestres ou maritimes, animales ou végétales), en adressant les conditions de leur utilisation.
Les mesures des candidat·e·s :

En 2017, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et son Conseil d’orientation stratégique composé de près de deux cents parties prenantes ont interrogé les candidats à l’élection présidentielle sur leur action en faveur de la biodiversité. En dépit des engagements forts de chacune et chacun, peu d’avancées ont été observées. Les rapports des scientifiques restent toujours aussi accablants.
En 2019 encore, l’Ipbes, le Giec de la biodiversité, alertait sur le déclin des espèces communes à savoir, les oiseaux, les insectes, les pollinisateurs, les amphibiens, qui sont au cœur du fonctionnement de nos écosystèmes. La plateforme internationale pointait du doigt l’accélération des extinctions d’espèces, la dégradation des écosystèmes et l’altération de leurs fonctions vitales associées, comme la régulation du climat, l’épuration des eaux et de l’air, la pollinisation, le contrôle des ravageurs et des épidémies, etc.
Ce déclin de la biodiversité qui se poursuit inlassablement menace d’”éroder les fondements mêmes de nos économies, de nos moyens de subsistance, de notre sécurité alimentaire, de la santé et de la qualité de vie” comme le rappelait alors le président de l’Ipbes, Robert Watson. La mise en garde de la recherche contre cette érosion n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’alerte sur l’actuelle pandémie qui avait pourtant été annoncée par les scientifiques depuis longtemps, mais qui avait été reçue dans une réelle indifférence sociale et politique, car non “pensable” en tant que réalité.
Les origines de la perte de biodiversité sont aujourd’hui bien connues. L’Ipbes en a rappelé les cinq causes directes : les transformations des écosystèmes, l’exploitation des ressources naturelles, le changement climatique, les pollutions et les invasions biologiques. Mais peut-être plus important encore, l’Ipbes a aussi rappelé les causes indirectes liées aux facteurs économiques, sociaux, technologiques et de gouvernance des sociétés.
Pour lutter contre le déclin de la biodiversité, l’expertise scientifique internationale a souligné la pertinence de “changements transformateurs”, c’est-à-dire des changements qui repenseraient non seulement notre organisation économique, sociale et technique, mais aussi des paradigmes et des valeurs, telle que la croissance soutenue.
De si profonds changements sont-ils réellement possibles ? Notre société occidentale en a déjà vécu un : la révolution industrielle qui a bouleversé de fond en comble nos modes de production, de consommation et de vie. Celle-ci a été matériellement rendue possible grâce aux énergies fossiles, à l’accompagnement de la recherche et au développement de technologies qui ont facilité sa mise en œuvre.
Sans renier toutes les avancées exceptionnelles de cette révolution, et face aux limites environnementales et planétaires, il s’agit maintenant de faire en sorte que cet épisode de croissance économique soutenue, qui a été aussi accompagnée par une forte croissance démographique, se transforme. Cette transformation concerne les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie… mais aussi de la consommation, de la vie en société en général. Des initiatives sont déjà en œuvre, telles que l’agroécologie, l’économie circulaire, la préservation des écosystèmes. De façon générale, il s’agit de donner plus de poids à la biodiversité dans toutes les décisions socio-économiques afin de promouvoir des socio-écosystèmes résilients assurant à la fois le bien-être des populations humaines et un bon état à la biodiversité.
De manière pragmatique, nous, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, composée d’acteurs publics, du monde économique et de la société civile, de chercheurs et chercheuses, de représentantes et représentants d’institutions académiques, vous invitons à vous saisir de cette notion de changements transformateurs et à venir en discuter avec nos experts académiques et non académiques.
En cette veille d’élection présidentielle, il nous parait plus que jamais nécessaire que nos concitoyennes et concitoyens connaissent vos ambitions dans le domaine de la biodiversité. Nous avons compilé vos mesures et vous invitons à nous contacter afin de préciser vos engagements en faveur du vivant et de la recherche sur la biodiversité.

Du 9 au 11 février s’est tenu à Brest le premier One Ocean Summit, un sommet international qui a permis de concrétiser des engagements en faveur de la protection des mers et des océans. Les écosystèmes marins sont en effet menacés à la fois par des facteurs globaux (tels que le réchauffement de l’eau et l’acidification des océans), mais aussi par des facteurs locaux (tels que la pêche, la pollution lumineuse ou encore la navigation). Les facteurs de pression étant directement associés aux activités humaines, les écosystèmes les plus éloignés des humains devraient intuitivement subir moins d’impacts et constituer des refuges plus sûrs pour la biodiversité. Cette idée est d’ailleurs confortée par plusieurs études scientifiques qui démontrent l’existence d’une corrélation claire entre l’état des écosystèmes et leur distance par rapport aux grandes villes (Figure 1). Pour cette même raison, les zones les plus éloignées sont aussi considérées comme des réservoirs potentiels de biodiversité qui peuvent préserver les écosystèmes en cas d’extinction importante.
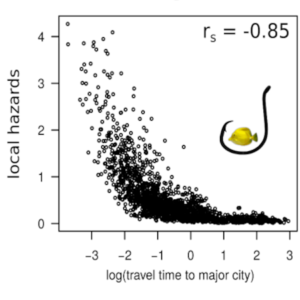
Figure 1. L’impact des activités anthropiques, ou leurs conséquences (tels que la pêche, la pollution) sur les communautés des poissons des récifs coralliens diminue avec l’éloignement aux activités humaines. Chaque point correspond à une zone de récifs coralliens à une résolution spatiale de 1 × 1 degré de latitute/longitude. Modifié de Strona et al. 2021b (CC BY 4.0).
Cependant, des études menées au sein du projet de recherche Score-Reef, co-financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) à travers son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Ministère de la transition écologique (MTE), montrent que la réalité est tout autre lorsque l’on prend en compte la dépendance des poissons vis-à-vis des récifs coralliens.

Couverte à 95 % de forêts, la Guyane française représente un enjeu essentiel en termes de régulation du climat et des flux de carbone. C’est aussi potentiellement un réservoir considérable de bois d’œuvre. Le bois exploité est en grande partie destiné à la construction ou à la rénovation résidentielle pour des marchés locaux ou exporté dans les Antilles françaises. La production s’y élève chaque année à 80 000 m3, ce qui en fait, en plus de l’enjeu socio-économique associé à la régulation du climat, un des principaux secteurs économiques de la région. L’Office national des forêts (ONF), qui en est le gestionnaire, est chargé du choix des massifs à exploiter, de la construction des dessertes forestières et de l’application des principes de gestion durable. En particulier, il désigne les arbres à abattre puis les vend à des concessionnaires qui en font eux-mêmes l’exploitation. Car dans ces forêts naturelles, c’est-à-dire à l’état sauvage, la production se fait par exploitation sélective. Seuls quelques grands arbres d’intérêt commercial sont exploités comme l’angélique, le gonfolo et le grignon franc. Ces espèces représentent à elles seules trois quarts de la production, alors qu’au moins 90 essences sont technologiquement utilisables, mais avec encore peu de débouchés dans la filière bois. Le reste de la forêt est laissé à une régénération naturelle, avec un cycle de coupe fixé à 65 ans. Malheureusement, les populations d’individus de taille exploitable de ces espèces cibles ne se renouvellent pas au rythme auquel elles sont exploitées. En effet, on constate qu’elles pourraient être épuisées après un ou deux cycles d’exploitation. Pour maintenir les fonctions écologiques essentielles comme la régulation du climat ainsi que la production de bois de ces forêts tout en préservant les massifs forestiers inexploités sur le long terme, une solution serait de diversifier la liste d’espèces exploitées1. Pour ce faire, il est nécessaire de changer les habitudes dans les marchés publics, en parvenant à ce que les architectes maîtrisent aussi l’usage des essences moins connues et en développant des solutions techniques adaptées à leur utilisation.

Comment définissez-vous les systèmes alimentaires des peuples autochtones ?
D’abord, il est important de définir ce qu’est un peuple autochtone. Il s’agit d’un statut revendiqué par certaines communautés, juridiquement reconnu par les Nations Unies, sur la base d’un certain nombre de traits. Un de ces traits est un lien fort et ancien avec un territoire qui se traduit par une connaissance approfondie de ses ressources, de leur diversité et de leurs usages (alimentaires, médicaux, etc.). Un autre de ces traits est que ces peuples autochtones se définissent comme porteurs d’une relation et d’une sensibilité particulières au monde dans lequel ils vivent, relation qui s’inscrit dans un ensemble de valeurs respectueuses du vivant.
Combien de personnes constituent l’ensemble de ces communautés ?
On estime qu’ils sont un peu moins de 500 millions. Contrairement à une idée un peu ancienne et caricaturale, il n’existe que très peu de chasseurs-cueilleurs dans ces communautés. Cependant, ces communautés revendiquent des systèmes alimentaires reposant sur des ressources locales et sur une dimension collective très forte : à la fois dans l’accès aux ressources souvent gérées de façon collective, mais aussi dans le travail de production, de préparation et dans le partage des aliments. Ces communautés entretiennent des dispositifs de solidarité alimentaire. Mais ces systèmes alimentaires créent non seulement du lien social, mais aussi un lien au vivant. Ils sont la plupart du temps biocentriques et, à l’inverse de systèmes anthropocentriques, ne sont pas focalisés sur l’humain.
Où sont généralement situées ces communautés ?
Elles se situent souvent dans des zones protégées. Un tiers de la surface mondiale couverte par les zones protégées est occupé par ces communautés. Dans ces zones, ces communautés revendiquent une souveraineté alimentaire, c’est à dire le droit d’accéder aux ressources locales pour préserver leurs pratiques alimentaires et toutes les valeurs bio culturelles qui y sont rattachées.
Quel est le lien des communautés autochtones aux espèces sauvages ?
Pour vous répondre, je citerais le Livre Blanc/Whipala sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones qui dit : “Depuis des millénaires, les peuples autochtones protègent leur environnement et sa biodiversité”. Ces savoirs et ces pratiques sont revendiqués comme durables. Les systèmes alimentaires autochtones contribuent à la construction de la biodiversité à travers l’agriculture et au maintien des ressources non domestiques par des pratiques d’exploitations durables. Mais attention, le sauvage, dans ces systèmes, ce n’est pas que du gros gibier. On se focalise parfois sur les grandes espèces emblématiques, mais les ressources alimentaires sauvages ce sont aussi des plantes, des insectes, des poissons, etc. La revendication des peuples autochtones d’être à la fois protecteurs et utilisateurs de la biodiversité est parfois mal comprise et l’équilibre est souvent fragile et difficile à maintenir.
Pourriez-vous donner un exemple ?
Prenons l’exemple des BaTonga, une population située au Zimbabwe, de part et d’autre du Zambèze. Des études montrent toute l’importance des ressources sauvages dans leur alimentation. Celle-ci se remarque à plusieurs niveaux. D’une part par la contribution à la diversité alimentaire et notamment par le nombre d’espèces consommées. En effet, les BaTonga exploitent 60 espèces animales dont 18 sauvages. Pour les plantes, c’est plus de la moitié des espèces consommées qui sont sauvages, 37 sur un total de 58. À titre de comparaison, on sait que l’alimentation mondiale basée sur le secteur agroalimentaire ne repose essentiellement que sur une dizaine d’espèces végétales et une dizaine d’espèces animales. D’autre part, les ressources sauvages sont importantes car l’alimentation des BaTonga est culturellement riche de ces espèces. Plus de la moitié des préparations culinaires répertoriées par l’étude inclut des ingrédients sauvages. Enfin, ces ressources permettent de réduire la vulnérabilité des BaTonga face aux crises. Pendant la pandémie mondiale de Covid-19, ils ont eu un recours accru aux ressources alimentaires sauvages, ils ont cueilli des fruits, chassé des oiseaux, etc. Ceci a permis de limiter l’impact des pénuries et des baisses de revenus liées à la pandémie.
En quoi l’étude de ces systèmes peut-elle favoriser la durabilité du système alimentaire global ?
Les peuples autochtones revendiquent des systèmes alimentaires durables. Ces systèmes sont sans doute porteurs de solutions à considérer pour répondre à la crise actuelle des systèmes alimentaires. Mais c’est peut-être moins leur rapport aux aliments, bases de leur alimentation, que leur rapport culturel qui doit nous inspirer. La principale cause de la crise que l’on traverse actuellement est la perte de sens de notre alimentation. Comme le signale le sociologue Claude Fischler, nous consommons des “objets comestibles non identifiés”. La distanciation entre les mangeurs et les aliments a des conséquences néfastes sur nos interactions avec le vivant, sur ce que l’on se croit “autorisé” à faire. Je suis particulièrement attachée à un certain nombre de concepts qui permettent de repenser nos systèmes alimentaires comme celui d’écologie de l’alimentation qui est un domaine très intéressant. Repenser notre alimentation comme un moyen de se relier les uns aux autres, de redonner une valeur aux relations sociales qui peuvent se tisser à travers l’alimentation, c’est revendiquer une qualité du lien avec les non humains et enfin redonner un sens au vivant. Je crois que, face à la domination de la rationalité technico-économique, ces préoccupations sont associées à de la sensiblerie et donc évacuées de nos réflexions. Mais il faut redonner sa place à l’intime et à l’affectif dans notre lien à la biodiversité. Ce que nous apportent les systèmes alimentaires des peuples autochtones, c’est la possibilité de renforcer ce lien à travers l’alimentation. Pour qu’ils soient durables, le “sensible” doit être intégré pleinement à nos systèmes alimentaires.
Un parallèle existe-t-il entre ces systèmes autochtones et les pratiques d’exploitation ou de consommation en France ?
Je pense qu’il y a énormément de mouvements sociaux en France qui visent à redonner un sens à l’alimentation. L’industrie a séparé les mangeurs des aliments, mais les consommateurs se mobilisent désormais pour essayer de recréer du lien. Il existe de nombreux exemples : les Amap qui visent à recréer le lien entre producteur et consommateur, le commerce équitable, les références au “local”, etc. De nombreux consommateurs du monde occidental se réapproprient de cette manière leur ancrage dans leur espace social et biophysique. Le parallèle entre les revendications des peuples autochtones et celles des nouveaux consommateurs du monde occidental est évident et va dans le même sens.
Développer des systèmes plus proches du sauvage, comme les systèmes autochtones, est-il une stratégie levier pour la durabilité des régimes alimentaires ?
Avec les maladies émergentes, le sauvage est perçu de façon accrue comme une menace. L’image du consommateur qui mange un animal sauvage et génère une pandémie mondiale est très présente dans les esprits. Au-delà de ce cliché, je pense que la consommation d’animaux sauvages dans les métropoles asiatiques par exemple, peut aussi être interprétée comme une forme de résistance à une réduction de la biodiversité. Garder une place au sauvage dans notre alimentation est une façon de garder un lien fort et direct avec le vivant. Bien sûr, ce n’est pas facile, surtout face aux enjeux de conservation. Je vis en France dans une zone envahie par les sangliers. Il y a eu des tentatives de créer des filières de viande sauvage, ce qui n’a pas été facile à cause des normes sanitaires strictes et des effets possibles d’une chasse commerciale. De plus, la chasse est de plus en plus difficile à accepter moralement, notamment parce qu’elle a perdu sa fonction alimentaire. Favoriser la diversité des aliments, les produits de la chasse et de la cueillette dans les systèmes alimentaires, présente certains intérêts. Même de façon très ponctuelle, cela peut être un moyen d’entretenir un lien sensible avec le vivant, qui peut aider à la conservation de la biodiversité.


Bien que la cueillette de plantes sauvages remonte aux origines de l’humanité, il aura fallu attendre les années 2010 pour que le monde académique et de la conservation se penchent sur la question. En cause, une explosion de la demande en produits naturels, des désirs de retour à la nature et un marché du sauvage en pleine expansion. Cette pratique s’est fortement développée aussi bien dans les sociétés occidentales, pourtant davantage tournées vers les médicaments de synthèse, que dans certains pays du Sud où l’offre et l’usage de produits naturels sont importants. Le regard porté sur les plantes s’est transformé avec l’émergence des discours autour de la valeur économique de la biodiversité et plus généralement des valeurs attribuées à la nature. Cette dynamique est-elle compatible, au moins en France, avec le réservoir de plantes sauvages présent dans l’espace rural et le maintien de la biodiversité ?

Pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour par le langage. Il n’y a pas de terme pour dire « nature » dans les langues kanak. La dichotomie entre nature et culture n’existe pas. Il s’agit plutôt de liens qui unissent les éléments, humains et non humains. Il s’agit donc pour les hommes et les femmes d’entretenir tous ces liens, entre le requin et le lézard, l’homme et l’igname, la femme et le cocotier, et tout ce qui nous lie à la « terre-mer ». Quand on est kanak, la « terre » ou la « nature », s’étend de la montagne jusqu’au récif, voire au-delà. Cela inclut les vivants et les morts, le monde visible et invisible.
Le lien qui unit les populations de Nouvelle-Calédonie avec la nature est très fort, car tout est lien. Aussi, ce lien est entre autres entretenu par la connaissance commune des toponymes, c’est-à-dire des noms de lieux. Chaque toponyme renferme la mémoire du lien d’un clan à la terre et toute son histoire. Grâce à ces toponymes, le lien au territoire persiste à travers les générations.
Sur l’archipel calédonien aujourd’hui très multiculturel et métissé, on ne peut pas dire qu’il n’y a qu’une seule perception de la nature. Ce que je peux observer, c’est que les premiers habitants d’ici, les Kanak qui constituent aujourd’hui un peu plus de 40 % de la population ont réussi à partager leur vision du monde, leurs liens forts à des éléments non-humains notamment. Même si cela n’est pas toujours évident pour tous, il y a une certaine reconnaissance de la diversité des savoirs et des représentations de la nature. Chaque communauté a apporté ces manières de voir et nombreuses sont les personnes qui se sont construites en intégrant un peu de cette diversité.
Au début, dans de nombreux pays du monde, gérer l’environnement consistait à “mettre la nature sous cloche”. Aujourd’hui, on intègre de plus en plus à la fois les habitants, leurs valeurs et leurs pratiques. En Nouvelle-Calédonie, les trois provinces possèdent chacune leur propre code de l’environnement. Celui de la province des îles Loyauté, habitées par une grande majorité de Kanak, a été rédigé il y a seulement trois ans. En amont, des travaux de recherche en sciences de la nature et en sciences sociales ont été menés afin de prendre en compte les enjeux écologiques ainsi que les spécificités des populations et du territoire. Pour vous donner un exemple, avec des collègues écologues, ethnologues et géographes, j’ai mené un travail sur les roussettes, de grandes chauves-souris, qui sont considérées comme des ancêtres dans certains clans et sont globalement très importantes d’un point de vue culturel. Notre travail a été fait pour que puissent être rédigées des réglementations qui s’appuient sur la vision des habitants, sur les pratiques préexistantes et sur les enjeux écologiques. Les règles sont pensées non pas pour protéger une biodiversité seule mais bien la biodiversité et la société. Par ailleurs, dans les codes de la province Sud et de la province Nord rédigés depuis plus longtemps, il est prévu que des dérogations soient possibles pour le prélèvement d’espèces comme la tortue verte à des fins coutumières (pour des mariages, des deuils, des intronisations de chefferies, etc.).
Il y a un certain effort d’intégration des décideurs et des acteurs locaux. Pour donner un exemple, six sites de Nouvelle-Calédonie sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les comités de gestion de chaque site sont généralement composés de représentants locaux (associations locales, coutumiers, femmes et hommes de l‘endroit). On considère volontiers que les acteurs locaux ont un rôle à jouer, mais selon les lieux, ils sont plus ou moins impliqués et écoutés. Il reste du travail à mener pour réellement prendre en compte leur parole et leurs visions.
Je vais utiliser un exemple pour vous répondre. Depuis quelques années, nous menons un projet appelé Espam sur le milieu marin, financé par la Fondation de France et la province des Iles Loyauté. L’objectif a été de travailler sur la diversité des valeurs que les habitants accordent aux territoires marins, en particulier aux animaux marins. L’idée est que si on connaît mieux les valeurs que les gens accordent aux espèces, et donc au territoire, et que l’on parvient à les faire reconnaître par le plus grand nombre, il sera possible de créer des politiques environnementales qui intègrent tant les enjeux écologiques que les enjeux culturels et sociaux. Elles seront ainsi plus ajustées et mieux comprises par tous.
Dans le cadre de ce programme, en plus de mener des entretiens longs avec les Calédoniens (de plus de 4 heures parfois), nous avons déployé un questionnaire très court contenant deux questions : “Quels sont les animaux marins emblématiques pour vous ?” et “Pourquoi ?”. Plus de 130 espèces différentes ont été citées, ce qui illustre nombre conséquent d’espèces importantes pour les populations locales. Nous avons créé une base de données nourrie de ces réponses sur les espèces et les valeurs que leurs accordent les habitants. 201 raisons différentes ont été données que nous avons classées en 22 grands thèmes. En Nouvelle-Calédonie, la fonction nourricière accordée aux animaux marins a été très largement citée, puis leur importance coutumière et leur statut d’espèce menacée ou à protéger. Ces résultats ont montré que les valeurs socio-culturelles sont prégnantes. Nous devons donc en tirer des leçons, cesser de tout vouloir traduire en valeur monétaire et créer des indicateurs multiples agrégeant des indicateurs sociaux, économiques et culturels. Trouver les outils à ces fins reste encore un défi mais nous pensons que ce projet apporte sa petite pierre à la réflexion.
Il s’agit d’une proposition de l’Ipbes qui résulte d’une analyse des causes de déclin de la biodiversité et des échecs politiques de sa préservation ces dernières décennies. Un changement transformateur est défini comme une réorganisation fondamentale et systémique des facteurs économiques, sociaux, technologiques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs.
>> En 2021, la FRB a consacré sa Journée annuelle à débattre de cette notion. + d’infos
L’idée sous-jacente est qu’il est possible de faire évoluer les valeurs qu’on porte aux choses et notamment à la nature. Il ne s’agit pas de faire converger les différentes valeurs, mais bien de faire valoir leur diversité. Celles-ci ont toujours évolué et on se rend plus compte aujourd’hui de l’existence de différentes manières de penser les choses. Notre mobilité entre les continents, entre les îles, s‘est accélérée et étendue, ce qui conduit aujourd’hui à avoir des territoires habités par une grande diversité de populations ; et chacune établit un lien spécifique avec la terre qu’elle habite. Le système des valeurs caractérisant un territoire devient plus complexe et plus riche. Selon moi, on peut profiter de cette richesse et de cette complexité afin d’analyser la diversité des valeurs, et ce qui conduit chacun à faire évoluer son système de valeurs, notamment pour renforcer ces liens avec les éléments de la nature. J’aime penser que notre objectif n’est pas de protéger l’environnement ou la société, mais bien l’ensemble : les liens humains-natures, les liens entre les humains et les non-humains. Si on arrive à identifier ces changements transformateurs et les manières institutionnelles, collectives et individuelles de les favoriser, on pourra alors renouveler un lien sain entre la biodiversité et la société. Pour préserver cet ensemble, il faut les penser ensemble. La vision kanak du monde, marqués par les liens, peut nous aider. L’attention portée à maintenir ces liens dans le présent doit guider nos actions.

« Nature » est un terme difficile à définir, parce qu’il est très large, très inclusif. Ce terme a pu être manipulé pour servir des fins diverses. La « naturalisation », par exemple, est un très bon moyen de faire passer n’importe quelle idée politique puisque si je dis « c’est naturel » et que vous affirmez le contraire, je peux vous taxer d’être contre-nature. La nature s’est donc parfois teintée de cette dimension normative et morale qui l’a rendue d’autant plus politique et « fourre-tout ». Il est donc nécessaire d’une part d’avoir une idée précise de ce que l’on met derrière ce mot pour mieux la préserver et d’autre part de le faire évoluer pour en faire sortir les nouveaux enjeux pertinents.
Assimiler la nature au sauvage est caractéristique des pays de culture coloniale, comme l’Australie ou les États-Unis. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont appelé « sauvage » et « vierge » des territoires qui ne l’étaient en fait pas tant que cela, mais qu’ils ont perçu comme tels. Leur vision teintée de créationnisme leur faisait dire « nous sommes l’Homme, nous sommes la culture, nous sommes la civilisation et nous nous opposons au sauvage, nous mettons le chaos en ordre ». Ainsi, le sauvage revêt deux visions caricaturales : soit il est pensé comme hostile, chaotique, devant être contrôlé, soit il est pensé comme positif, voire naïf, comme une virginité intacte, non souillée et dont il s’agirait de préserver l’innocence. Ce sont des représentations que les États-Unis ont beaucoup mondialisées du fait de son influence depuis 1945. Mais ça n’est pas du tout la vision qu’on en a en France, colonisée beaucoup plus tôt par Homo sapiens. Après la dernière glaciation, ils faisaient partie des premières espèces pionnières qui ont conquis les terres : les écosystèmes en France se sont donc élaborés précocement à leur contact. Il en est de même pour l’Afrique par exemple. L’assimilation de la nature au sauvage est une vision très récente, très romantique et très américaine et il faut toujours situer une vision dans son contexte. Et au lieu d’opposer de manière si binaire le sauvage et le domestique, on peut dessiner un continuum bien plus subtil en distinguant du plus artificiel au plus naturel, l’urbain, le rural, l’agricole, le forestier, le sauvage et enfin le « vierge » – les deux extrêmes étant l’exception, et cette catégorisation n’ayant rien de normatif.
La nature ne se définit pas forcément directement en termes de valeurs. En revanche, l’humanité va y trouver ou y projeter de la valeur, qui n’est sans doute pas présente de manière immanente. Il existe deux approches de ces valeurs. La première a eu beaucoup de succès à la fin du XXe siècle : elle s’articule autour de la notion de « valeur intrinsèque », c’est-à-dire qu’on attribue une valeur homogène à la nature dans son entièreté. Donc faire du mal à la nature ou à ses constituants est moralement répréhensible. Le problème, c’est qu’une fois qu’on a dit ça, on n’a rien dit. Parce que si toute la nature a de la valeur de manière égale, ça n’aide pas à faire des choix et à privilégier des modes d’action. La seconde approche propose de hiérarchiser ces valeurs, c’est-à-dire d’admettre que des choses ont plus de valeur que d’autres et de distinguer plusieurs types de valeurs.
L’IPBES DISTINGUE TROIS PRINCIPAUX TYPES DE VALEURS1
> Les valeurs instrumentales, qui indiquent si quelque chose a une valeur utilitaire avec un but précis.
Ex : le bois en tant que combustible ou matériau.
> Les valeurs relationnelles, qui découlent de l’importance du lien entre les individus ou les sociétés et les autres animaux ou aspects du monde vivant, ainsi qu’entre les individus eux-mêmes, reflétées par les institutions formelles et informelles.
Ex : la valeur symbolique de l’aigle à tête blanche, emblème des Etats-Unis.
> Les valeurs intrinsèques, qqui représentent les valeurs indépendantes de toute expérience ou évaluation humaine. Ces valeurs sont vues comme une propriété inhérente de l’entité (par exemple, un organisme) et ne sont pas attribuées ou générées par des évaluateurs extérieurs (tels que les humains). Chaque être vivant est porteur et garant de sa propre valeur.
Je pense que la valeur intrinsèque ne fait pas bon ménage avec les autres types de valeurs, instrumentales et relationnelles, qui sont variables et mesurables, alors que la valeur intrinsèque ne l’est pas, elle ne dialogue pas avec les autres. Dans le système que je voudrais proposer, je parle plutôt de valeur d’existence : c’est-à-dire de partir du principe que l’existence est préférable à la non-existence, la vie à la mort. Quand on n’a aucun intérêt économique ou utilitaire à éliminer un élément de la nature, que ce soit un individu, une espèce ou n’importe quoi d’autre, il est préférable moralement de ne pas le faire. Mais on finit toujours par devoir faire des compromis parce qu’il faut bien manger, se nourrir, se vêtir, se protéger, etc. Donc qu’est-ce qui justifie qu’on doive prendre la décision d’éliminer des éléments de la nature, en outrepassant cette valeur d’existence ? Qu’est-ce qui justifie de manger du rhinocéros plutôt que de la salade ?
D’un autre côté, la dichotomie entre valeurs instrumentales et non instrumentales s’applique mal à la nature. Elle est très moralisatrice. Car c’est moins le côté instrumental qui compte que l’effet de notre interaction. Quand je m’émerveille devant un récif coralien, c’est très instrumental – c’est d’ailleurs une industrie. L’important, c’est que je ne lui fasse pas de mal. Inversement, il y a des pratiques non instrumentales qui, par désintérêt, peuvent détruire la nature. Certains peuvent détruire la nature par simple négligence et déconsidération. Je pense donc que le couple destructeur / non destructeur (conséquentialiste) est plus pertinent dans notre rapport à la nature qu’une opposition morale du type instrumental/non (déontique), dont la nature se fiche bien.
Est-il souhaitable qu’on tombe tous d’accord ? La pluralité est importante. C’est ce qui fait évoluer une pensée ou ce qui amène à la préciser. On est face à un problème complexe, qui transcende les disciplines universitaires, il est normal que des gens avec des schémas de pensée différents se mettent autour de la table et débattent. Aujourd’hui, les enjeux et les outils de réflexion évoluent, donc il est nécessaire de réfléchir ensemble pour que la conservation de la nature s’améliore dans le temps. Il faut être capable de répondre aux questions « Qu’est-ce qu’on conserve ? », « Au nom de quoi ? » et « Dans quel objectif ? ». Si je dispose de 100 000 euros pour la conservation de la nature, est-ce que je les donne à une association pour la protection du rhinocéros blanc ? Est-ce que je dois l’investir dans la recherche en écologie fonctionnelle ? Est-ce que je dois plutôt acheter une forêt et planter des arbres ? Financer un parti politique ? Tous ces choix reposent sur différentes valeurs. Dans ce sens, il est très important de dégager des méthodes d’identification et d’évaluation des valeurs de la nature, comme tente de le faire l’Ipbes.
Les deux. Redéfinir le concept de nature implique aussi de l’ouvrir et l’analyser pour voir ce qu’il y a dedans. D’un point de vue sémantique, on peut isoler au moins quatre composants de la nature. C’est d’abord une productrice de ressources qu’il faut veiller à renouveler durablement. C’est aussi un écosystème : un ensemble d’espèces qui partagent un milieu et entretiennent des interactions complexes. Mais c’est aussi un patrimoine : on a le jardin des Plantes, le bocage normand, les bords de Loire, etc., qu’il s’agit de conserver et de transmettre. Et enfin il y a la nature comme biosphère, c’est-à-dire comme planète prise dans son ensemble avec son climat et ses nombreux autres paramètres, dont d’infimes variations peuvent nous éradiquer rapidement. Tous ces composants doivent entrer en compte dans la conservation de la nature. Mais parfois, on voit apparaître des controverses de « spécialistes ». Pour caricaturer, penser la conservation en tant que physicien, c’est peut-être irriguer le Sahara et planter des eucalyptus transgéniques sur des millions de kilomètres pour stocker du carbone, et hop ! On a conservé la nature. Mais des biologistes verraient peut-être cela comme une hérésie. C’est notamment pour cela qu’a été créé l’Ipbes, qui se veut être un Giec de la biodiversité, mais animé par des biologistes. Pour inclure cette dimension de biologie et de biodiversité dans la conservation de la nature même à grande échelle.
Que la science globale prenne en compte toute la multiplicité des savoirs locaux est une nécessité. Mais je me méfie de la mise dos à dos de la science moderne et des connaissances et savoirs locaux. La science moderne s’est nourrie, historiquement, d’une multitude d’éléments issus du monde entier : elle n’est pas, comme on l’entend parfois chez certains relativistes, une vulgaire ethnoscience européenne. La science a toujours cherché à intégrer un maximum de savoirs et à sélectionner les plus satisfaisants sur des bases rationnelles. La science moderne doit sans doute plus à la Chine ou au monde arabe qu’au Portugal ou à la Slovaquie : elle s’est concentrée en Europe à certaines périodes, mais ce n’est plus du tout le cas. Le but est donc d’assurer la participation de tous les savoirs du monde à cette science : pour la pharmacie, par exemple, l’ethnobotanique est d’une importance capitale. D’autre part, les cultures locales, elles, se doivent d’être prises en compte dans les formes et buts que se fixe la conservation de la nature dans ses réalisations locales.
Ce qui compte avant tout aujourd’hui ce sont des outils intellectuels pour l’action. L’Ipbes a le mérite de s’inscrire dans cette démarche. Ça fait 3 000 ans qu’on réfléchit de manière spéculative à la philosophie de la nature, mais aujourd’hui, elle doit s’inscrire dans une action avec des objectifs qu’il va falloir définir, questionner et justifier.
______
1 Preliminary guide regarding diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services, 2015, IPBES/4/INF/13
![[Podcast] “En espèces, s’il vous plaît !” – Et si on se questionnait sur les différents regards portés sur la nature ? (Épisode 1)](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/01/FRB_Visuel_Theme_1.png)
Dans le cadre de sa campagne sur les thèmes des prochains rapports Ipbes, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité propose son nouveau podcast “En espèces, s’il vous plaît !”. De la chasse à l’économie en passant par l’éducation, ce nouveau format donne la parole à des acteurs de la société et met en relief leurs discours et considérations par l’expertise d’un chercheur.
En espèces, s’il vous plaît !, un dialogue science-société où chacun partage ses enjeux et problématiques.
Ce premier épisode de « En espèces s’il vous plaît ! » propose de questionner les différents regards portés sur la nature. Trois acteurs de la société, membres de l’Assemblée des parties prenantes de la Fondation, et une philosophe du CNRS ont été invité à répondre à une série de questions.
![[Ipbes9] Valeurs et utilisation durable des espèces sauvages : de quoi parle-t-on ?](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2022/01/Valeurs_Nature.jpg)
Pour mieux comprendre les enjeux des sujets traités par ces rapports, la FRB vous donne rendez-vous de janvier à juin pour une série d’articles et de podcasts sur ces thématiques intrinsèquement liées.
Ainsi, tout au long des mois à venir, la FRB donne la parole à des chercheurs et chercheuses ainsi qu’à des acteurs de la société pour parler de valeurs et d’utilisation durable sous différents angles, de la chasse à l’économie en passant par l’éducation, etc.
Le premier volet de cette campagne est consacré à la notion de « valeurs » associées à la nature. En quoi évaluer et partager ces valeurs est un enjeu majeur pour la conservation de la nature et de la biodiversité ? En quoi la durabilité de l’utilisation d’espèces sauvages dépend du contexte culturel, politique et social ?
Des questions que viennent interroger et éclairer Virginie Maris (philosophe – CNRS), Florence Pinton (sociologue – AgroParisTech), Catherine Sabinot (ethnoécologue – MNHN), Frédéric Ducarme (philosophe – MNHN) mais aussi Sita Narayanan (Grand port maritime de Guadeloupe), Marika Dumeunier (Noé) et Hélène Leriche (Orée).
Consulter les articles :
Le deuxième volet de cette campagne est consacré à l’exploitation des ressources naturelles par les humains. Comment rendre durable la gestion des forêts tropicales ou celle de la pêche ? Que nous apprennent les systèmes alimentaires des peuples autochtones sur nos modes de consommation et notre lien au sauvage et à la nature ?
Des questions que viennent interroger et éclairer Muriel Figuié (directrice de recherche au Cirad), Didier Gascuel (professeur à l’Institut Agro de Rennes), Camille Piponiot (chercheure au Cirad), Plinio Sist (directeur d’unité au Cirad), Géraldine Derroire (chercheuse au Cirad) et Bruno Hérault (chercheur au Cirad).
Consulter les articles :
Le troisième volet de cette campagne est consacré aux chasses et aux pêches artisanales. Que nous apprend l’évolution des pratiques de chasse sur notre lien à la nature ? Comment certaines techniques de pêche peuvent devenir un changement transformateur de notre société ? Quel lien existe entre l’évolution des pratiques de chasse et de pêche et les réglementations ?
Des questions que viennent interroger et éclairer Ludovic Ginelli (sociologue à l’Inrae), Matthieu Guillemain (chef de service « Conservation et gestion durable des espèces exploitées » à l’Office français de la biodiversité), Jérôme Noël Petit (responsable France du projet Pew Bertarelli Ocean Legacy) et Charles Guirriec (fondateur de Poiscaille).
Consulter l’article :
Le quatrième volet de cette campagne est consacré à l’éducation et au tourisme. Comment nos rapports au sauvage et à la nature peuvent-être revus pour favoriser la protection de la biodiversité ? En quoi le tourisme et l’éducation peuvent être considérés comme des formes d’exploitation du monde vivant et comment les rendre durables et bénéfiques ? Comment l’éducation peut-elle nous permettre de renouer avec le vivant ?
Des questions que viennent interroger et éclairer Morgane Ratel, chargée du projet « Conservation » et Laurène Trudelle, chargée de mission scientifique pour le Programme Whale-Watching chez Miraceti, Eve Afonso, maître de conférences en écologie à l’Université de Franche-Comté, Li Li, professeur d’écologie du paysage à l’Université des Finances et d’Economie du Yunnan (Chine) et Patrick Giraudoux, Professeur d’écologie à l’Université de Franche-Comté, Edith Planche, ethnologue à l’Université de Lyon et directrice-fondatrice de l’association Science et Art et Julien Perrot, fondateur de La Salamandre.
Consulter les articles :
Le cinquième et dernier volet permettra d’avoir une vision globale de l’impact de l’économie globale sur nos conceptions de la nature et ses conséquences sur la préservation de la biodiversité. Nous verrons que les outils juridiques et économiques peuvent représenter des leviers importants à l’avenir, que ce soit pour le commerce d’espèces sauvages ou l’évolution de notre rapport à la nature.
Des questions que viennent interroger et éclairer Meganne Natali (Docteur en droit), Catherine Aubertin (économiste de l’environnement à l’IRD) et Valérie Boisvert (professeur à l’Institut de géographie et durabilité et à la Faculté de Géosciences et d’Environnement de l’Université de Lausannee).
.
Consulter les articles :

L’érosion de la biodiversité est dans certains territoires un enjeu majeur en raison de la disparition d’espèces de faune sauvage remplissant des fonctions écologiques clés. Diverses solutions peuvent être envisagées pour enrayer cette érosion et restaurer les fonctions écologiques des écosystèmes. Parmi ces solutions, les réintroductions et les renforcements de populations d’espèces de faune sauvage peuvent s’avérer particulièrement pertinentes. Longtemps perçues comme des actions ayant pour unique objectif l’amélioration de l’état de conservation de certaines espèces, elles peuvent avoir bien d’autres avantages pour les territoires.
En France, les premières actions de réintroductions et de renforcements de populations d’espèces de faune sauvage ont été mises en place durant le 20e siècle afin de reconstituer des populations d’espèces disparues ou pour renforcer celles en mauvais état de conservation. Les premières réintroductions de bouquetins dans les Alpes datent par exemple de 1910. Depuis, castors, tortues cistude, ours bruns ou encore différentes espèces de vautours ont été concernés par ces programmes. Les vautours fauves, par exemple, ont subi une période d’intenses pressions qui a conduit à leur disparition du sol français à la fin du 19e siècle. Dans les années 1970, dans le Massif Central, puis dès 1996 dans les Alpes, les premiers succès écologiques de réintroduction de ces oiseaux sont intervenus dans des paysages écologiques marqués par l’exode rural, la déprise agricole1, le retour de la forêt, la multiplication des grands herbivores et le retour des grands prédateurs.
Dans le cadre de l’Évaluation française des écosystèmes et services écosystémiques (Efese), qui vise à développer les outils d’évaluation nécessaires pour accompagner la transition écologique de la société française, l’amélioration des relations entre les populations et la faune sauvage au sein des territoires représente en enjeu crucial pour la transition écologique. Ainsi, en avril 2021, une étude2 de l’Efese s’est intéressée aux fonctions écologiques et services écosystémiques liés à la réintroduction des vautours fauves3 dans les parcs naturels régionaux (PNR) du Vercors et des Baronnies provençales. Cette étude propose en particulier une méthode d’évaluation destinée à aider les gestionnaires d’espaces naturels à identifier des pistes et des leviers d’action pour préserver la biodiversité en passant par la mise en valeur écologique, économique, sociale et culturelle des espèces. Pour ce faire, la méthode d’évaluation utilisée dans l’étude s’appuie sur un retour d’expérience de près de 25 ans du projet de réintroduction du vautour fauve dans ces deux parcs naturels régionaux.
Cet article présente les principaux résultats de l’étude Efese. Les différentes analyses ont été réalisées à partir de données récoltées dans la zone d’étude “Baronnies-Vercors”, soit une centaine de communes principalement de la Drôme, des Hautes-Alpes et de l’Isère. Cet ensemble forme un territoire de moyenne montagne (entre 234 m et 2 341 m d’altitude) d’environ 2 500 km2, dont la population de vautours fauves est estimée à 1 000 individus en vol en 2018.
1/ Bref aperçu de l’écologie du vautour fauve
En métropole, quatre espèces de vautours cohabitent : le vautour fauve (Gyps fulvus), le vautour moine (Aegypius monachus), le vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et le gypaète barbu (Gypaetus barbatus). Les quatre espèces de vautour sont spécialisées dans la consommation de cadavres d’animaux qu’ils soient sauvages ou issus de bétail d’élevage. Ils constituent à eux quatre une guilde de rapaces nécrophages et se nourrissent uniquement d’animaux morts. Chaque espèce est spécialisée dans la consommation d’une partie bien particulière du cadavre.
Le vautour fauve se nourrit des muscles et viscères, le moine consomme les tendons, cartilages et peaux, le gypaète quasi-exclusivement les os et enfin, le percnoptère grappille les restes. Lors d’une “curée” (terme désignant le moment où les vautours se nourrissent d’un cadavre), des dizaines de vautours fauves éliminent en quelques minutes un cadavre de brebis et en quelques heures celui d’une vache. Un vautour fauve adulte consomme en moyenne 200 kg de cadavres par an.
Source : Rapport Efese sur la réintroduction des vautours dans les parcs naturels régionaux du Vercors et des Baronnies provençales, p.38.


Les mesures prises pour l’atténuation du changement climatique doivent être évaluées en fonction de leurs avantages et de leurs risques globaux et non pas seulement selon leur bilan carbone. Les solutions examinées ci-dessous peuvent toutes entrer en concurrence avec le maintien des espaces naturels (par la rupture des continuités écologique ou la perte des habitats) et pour certaines, avec la production alimentaire (par exemple par l’intensification non durable de l’agriculture sur les espaces agricoles restants) et la santé humaine (par la pollution qu’elles génèrent).
Les évaluations d’impact environnemental de ces projets d’aménagement ou de construction d’infrastructure doivent donc mieux intégrer la biodiversité et notamment les impacts sur les espèces migratrices et leur participation à la fragmentation des habitats. Elles doivent aussi intégrer des évaluations de leur impacts sociaux comme les conflits d’usage des terres. Les mesures qui reposent sur le vent, l’eau, les plantes, mais qui présentent des impacts importants sur la biodiversité ne peuvent être qualifiée de solutions fondées sur la nature, car ces dernières doivent minimiser leurs impacts négatifs sur la biodiversité.
Les mesures destinées à faciliter l’adaptation au changement climatique peuvent, dans la pratique, être inadaptées et entraîner des conséquences préjudiciables et imprévues pour la biodiversité. Par exemple, l’augmentation de la capacité d’irrigation est une stratégie courante pour renforcer la capacité d’adaptation de l’agriculture au climat, mais elle présente des risques considérables pour la biodiversité des eaux douces et les populations, notamment la salinisation des sols à long terme, la baisse des niveaux d’eau et des conflits d’utilisation de l’eau1.
Les cultures génétiquement modifiées, qui sont plus tolérantes à la chaleur et au stress hydrique, ainsi que les cultures qui utilisent l’eau plus efficacement sont des solutions technologiques couramment proposées pour l’adaptation au changement climatique. Cependant ce type de culture présentent un large éventail de risques environnementaux. Elles ne sont déployées que pour quelques espèces, caractères, et donc leur déploiement à large échelle est porteur d’uniformisation. Par ailleurs, les gènes des cultures OGM résistantes à la sécheresse pourraient se propager aux espèces sauvages apparentées, altérant leur capacité compétitive et ayant ainsi un impact sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes2.
ZOOM SUR :
BIODIVERSITE ET TRANSISTION ENERGETIQUE, DES LIAISONS DANGEREUSES
L’énergie nucléaire constitue un important contributeur mondial à une électricité à faible teneur en carbone, en particulier dans son utilisation comme substitut direct du charbon. Seule l’hydroélectricité apparaît plus efficiente que l’énergie nucléaire, mais elle dépend géographiquement de la présence de cours d’eau3. La plus importante préoccupation environnementale, néanmoins, concernant l’énergie nucléaire est d’une part le risque d’accidents à fortes conséquences, longues, même si leur fréquence estimée est très faible -mais non nulle-, et d‘autre part la production de déchets à longue durée de vie dont l’élimination est aujourd’hui impossible. Ces deux dangers doivent être traités pour que la filière nucléaire soit une alternative crédible aux autres sources d’énergies.
>> Pour aller plus loin :
Journée FRB 2017 – Biodiversité et transition énergétique – Enquêtes sur des liaisons dangereuses
#ScienceDurable – Liens entre énergies renouvelables et biodiversité
#ScienceDurable – Énergie renouvelable et biodiversité : les implications pour parvenir à une économie verte

>> Pour aller plus loin :
Note du CS – Avis du Conseil scientifique de la FRB sur les « solutions fondées sur la nature »

Les Solutions fondées sur la nature représentent un concept englobant
diverses approches fondées sur les écosystèmes2.
Les solutions fondées sur la nature peuvent être distinguées selon la typologie suivante :

Figure : Représentation schématique des différentes approches
dans les solutions fondées sur la nature3.
Trois grands types de solutions sont définis, selon le niveau d’ingénierie ou de gestion appliqués à la biodiversité et aux écosystèmes (axe horizontal), et le nombre de services fournis, de groupes d’acteurs ciblés et le niveau probable de maximisation des services ciblés fournis (axes verticaux). Des exemples de solutions fondées sur la nature sont fournis pour les différents types. Les étiquettes des axes sont interchangeables : il ne faut pas voir le type 3 comme “meilleur” que le type 1. Les trois types sont complémentaires.
Biodiversa+, le réseau européen de financement de la recherche sur la biodiversité et les solutions fondées sur la nature, est impliqué dans le développement de NetworkNature, une plateforme européenne et mondiale qui permet à toutes les parties intéressées d’accéder et de contribuer à des connaissances et à des compétences de pointe et innovantes sur les solutions fondées sur la nature. Biodiversa+ finance également des projets de recherche sur ces thématiques. 4 exemples sont proposés ci-dessous.
D’après les exemples présentés ci-dessous, nous constatons que de nombreux exemples d’actions destinées à arrêter, ralentir ou inverser la perte de biodiversité peuvent simultanément ralentir de manière significative le changement climatique anthropique. Toutefois, il existe des exceptions importantes à une relation positive entre la préservation de la biodiversité et l’atténuation du climat. Par exemple, il a été démontré que la réduction de la fréquence des incendies de forêt, peut réduire considérablement la biodiversité en raison de la dépendance de nombreuses espèces sauvages à ce type de perturbations cycliques. La réintroduction d’espèces animales clés dans le cadre des efforts de ré-ensauvagement peut également réduire les stocks de carbone par une augmentation de la prédation ou du pâturage.

Les lacs jouent un rôle central dans nos sociétés et offrent de nombreux services à l’Homme, appelés « services écosystémiques », comme l’approvisionnement en eau douce et en nourriture, le maintien d’habitats pour la biodiversité, les transports ou encore les loisirs. Cependant, bien que nous dépendions fortement de ces services, nous ne savons pas aujourd’hui à quel point les lacs peuvent être affectés par le changement climatique et l’intensification des phénomènes météorologiques qui en découle. Alors que l’on sait que les tempêtes affectent l’écologie des lacs et leur biodiversité, l’enjeu est d’en découvrir les mécanismes.
Co-financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) et par le centre d’analyse et de synthèse John Wesley Powell de l’U.S. Geological Survey, le projet de recherche Geisha a permis de réunir une équipe de 39 scientifiques de 20 pays différents pour mettre en commun leurs données et ainsi étudier les effets des tempêtes sur le phytoplancton des lacs et les caractéristiques de son habitat tels que la température, les nutriments et la lumière. Après avoir alerté dès mars 2020 sur les conséquences du manque de connaissance des impacts des tempêtes sur les lacs (voir le communiqué de presse « Ce que nous ne savons pas (sur les lacs) pourrait nous nuire »), les chercheurs travaillent désormais sur l’étude de différents paramètres.
Publiée quelques semaines avant la 26e Cop Climat, leur dernière étude révèle que les fortes tempêtes ne provoquent pas de changements drastiques des températures comme on pouvait l’imaginer. En effet, l’équipe a examiné l’impact des tempêtes sur la température de 18 lacs dans 11 pays en utilisant des données météorologiques, des données hautes fréquences (plusieurs sur une même journée), mesurée à différentes profondeurs de la colonne d’eau et a montré que les tempêtes ne provoquent pas de refroidissements des lacs. Les changements de température de l’eau sont même parfois plus extrêmes au sein d’une même journée entre le jour et la nuit que lors d’une tempête.

Une tempête sur le lac Supérieur (Amérique du nord). Crédit photo : Jessica Wesolek, Centre de recherche et d’éducation sur l’eau douce de l’Université d’État du lac Supérieur.
“Dans les lacs, les changements de température induits par les tempêtes étant globalement minimes, les tempêtes impacteraient les animaux et plantes au travers de la modification d’autres paramètres sensibles aux tempêtes, comme par exemple la lumière ou les concentrations en nutriments. », a déclaré Jonathan Doubek, professeur adjoint à la Lake Superior State University, et ancien post-doctorant du groupe de recherche Geisha. L’impact des tempêtes sur la biodiversité des lacs pourrait donc probablement être dû à la modification d’autres paramètres déterminants pour la croissance et la reproduction des organismes y vivant ou y séjournant. Ces résultats représentent un progrès concret dans la compréhension de la façon dont les lacs sont impactés par les tempêtes.
“L’étude du professeur Doubek souligne l’utilité de partager et combiner des données : nous avons pu découvrir que l’effet des tempêtes sur les températures des lacs n’est peut-être pas aussi fort que nous le pensions auparavant”, a déclaré Jason Stockwell, professeur et directeur du Rubenstein Ecosystem Science Laboratory de l’université du Vermont et un des porteurs du projet Geisha. “Le pouvoir du travail d’équipe collaboratif mondial pour mettre en commun les données et les idées nous permet de mieux comprendre comment notre planète fonctionne et pourrait fonctionner à l’avenir, poursuit-il. Nous avons besoin de ces informations pour protéger les écosystèmes et la santé humaine”.
En effet, avec la crise majeure que traverse la biodiversité, le besoin de synthèse des données scientifiques en écologie n’a jamais été aussi fort. Mises en commun, ces données existantes peuvent alimenter des problématiques inédites, faire avancer significativement les fronts de connaissances et fournir des recommandations pour les décideurs. Depuis sa création en 2010, le Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) permet la collecte et la mise en commun de jeux de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité et l’élaboration de méthodes statistiques complexes pour proposer un état des lieux de la biodiversité et en modéliser le devenir. Situé à Montpellier, le Cesab propose un environnement de travail idéal en offrant des conditions propices à la production scientifique et est au cœur d’une des communautés scientifiques les plus dynamiques au monde en écologie (l’université de Montpellier a été classée première université mondiale dans le classement de Shanghai en écologie en 2018 et en 2019).

Les facteurs à l’origine du succès de projets de conservation sont encore difficiles à identifier. Ces dernières années plusieurs études ont ainsi cherché à comprendre le fonctionnement de la conservation. Mais, c’est la première fois qu’une équipe de recherche internationale a étudié la manière dont la gouvernance – la gestion et la prise de décision en matière de conservation – affecte à la fois la nature et le bien-être des peuples autochtones et les communautés locales.
Ces travaux sont en partie issus du projet de recherche JustConservation financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) et ont été initiés par la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales de l’Union internationale pour la conservation de la nature (CPEES de l’UICN). Ils sont le fruit de la collaboration entre 17 scientifiques, dont des chercheurs de l’École européenne de sciences politiques et sociales (ESPOL) de l’Université Catholique de Lille et de l’Université de East Anglia (UK). Ils font l’objet d’une publication, parue le 02/09/2021 dans la revue Ecology and Society.
Après avoir passé en revue plus de 3 000 publications, les chercheurs en ont identifié 169 traitant de l’influence de différentes formes de gouvernance sur les résultats de la conservation. Ils révèlent un contraste frappant entre les résultats issus de la conservation sous le contrôle « local » des peuples autochtones et communautés locales, et les résultats de la conservation menée sous le contrôle « extérieur » des États, des ONGs et des entreprises privées. 56 % des études sur la conservation sous contrôle « local » montrent des résultats positifs, tant pour le bien-être humain que pour la conservation. Pour la conservation sous contrôle « extérieur », seul 16 % des études rapportent des résultats positifs et plus d’un tiers ont abouti à une conservation inefficace et des résultats sociaux négatifs. La principale explication de cette différence réside dans le fait que la conservation contrôlée localement peut produire une gestion active et collective de l’environnement. Lorsque les valeurs et les pratiques locales sont respectées et que les communautés locales jouent un rôle central dans la conservation, une vision commune du paysage peut être établie. Cela génère alors une mobilisation pour préserver, restaurer et défendre l’environnement.
Les résultats de cette étude véhiculent donc un message optimiste : une conservation équitable, qui renforce et soutient l’intendance environnementale des peuples autochtones et des communautés locales, est la principale voie vers une conservation efficace à long terme de la biodiversité, en particulier lorsqu’elle est soutenue par des lois et des politiques plus larges.
La reconnaissance et le soutien des institutions locales nécessitent une réorientation des activités des organisations et des gouvernements qui dominent actuellement les efforts de conservation au niveau mondial. Dr Neil Dawson, premier auteur de l’étude, conclut ainsi : “qu’il s’agisse de réserves de tigres en Inde, de communautés côtières au Brésil ou de prairies de fleurs sauvages au Royaume-Uni, les preuves sont bien là : il est essentiel que les négociations politiques actuelles, en particulier celles de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), reconnaissent le rôle central des peuples autochtones et des communautés locales dans la lutte contre le changement climatique et pour la conservation de la biodiversité”
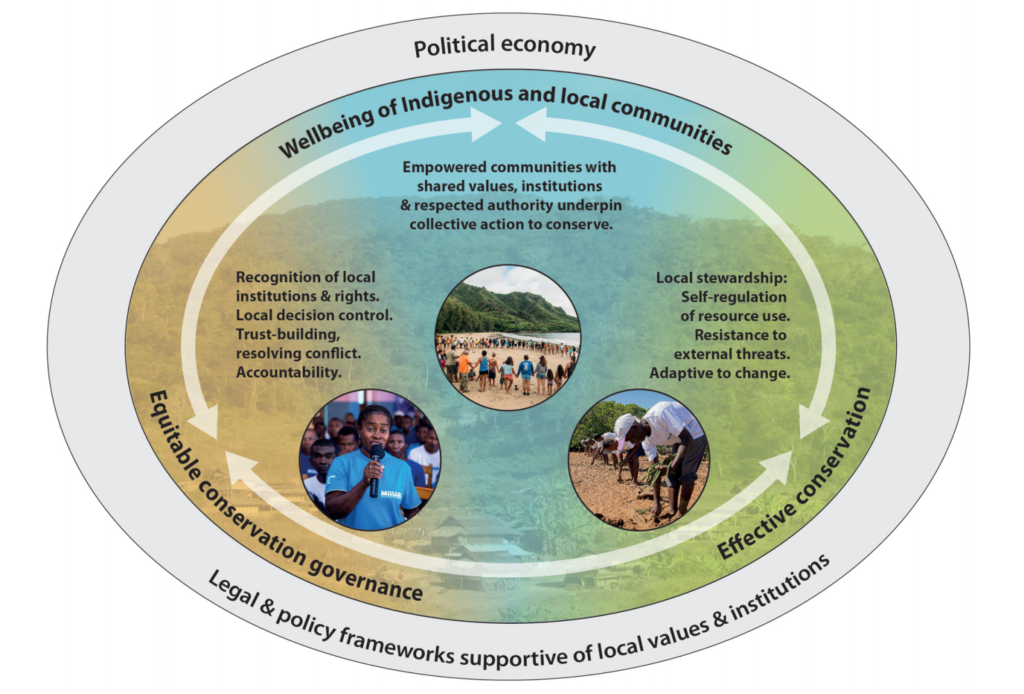
Figure : Le rôle central et indissociable des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation équitable et efficace de la biodiversité. Dans le sens des aiguilles d’une montre : Bien-être des peuples autochtones et des communautés locales – des communautés autonomes avec des valeurs partagées, des institutions et une autorité respectée soutiennent l’action collective de conservation ; Conservation efficace – intendance locale : autorégulation de l’utilisation des ressources, résistance aux menaces extérieures, adaptation au changement ; Gouvernance équitable de la conservation – reconnaissance des institutions et des droits locaux, contrôle des décisions locales, établissement de la confiance et résolution des conflits, responsabilité. L’illustration a été créée par Andy Wright www.madebyawdesign.com. Les images proviennent du réseau MIHARI http://mihari-network.org (discours d’une pêcheuse et reboisement de la mangrove à Belo-sur-Mer, dans le sud-ouest de Madagascar), et Holladay Photo (communauté Kahana, Koolauloa, Oahu, pratiquant une pêche traditionnelle hawaïenne appelée Hukilau).


En novembre 2020, un édito publié dans Nature Ecology and Evolution, « Online meetings for the win », suggère un changement des mentalités dans l’organisation des interactions dans le monde de la recherche vers encore plus de virtuel. En effet, en raison de la pandémie de Covid-19, les instituts, laboratoires et programmes de recherches ont dû s’adapter rapidement. Particulièrement concernés, les centres de synthèse – dont le Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) de la FRB – ont dû proposer aux groupes, constitués de chercheurs de toutes nationalités, des réunions entièrement virtuelles. Malgré des bénéfices à ces réunions en distanciel, notamment en matière de bilan carbone, les directeurs de plusieurs centres de synthèses internationaux alertent : bien que ces réunions virtuelles aient permis à l’activité scientifique de continuer pendant la pandémie, elles ne peuvent toutefois pas remplacer les réunions en présentiel.
Avec la crise majeure que traverse la biodiversité, le besoin de synthèse des données scientifiques en écologie n’a jamais été aussi fort. Le travail sans précédent, entamé par les experts internationaux au sein de l’Ipbes, visant à évaluer l’état actuel de la biodiversité et de sa contribution aux sociétés humaines, se base sur des études déjà publiées dans des journaux scientifiques et des bases de données déjà constituées. Les centres de synthèses sont parmi les acteurs principaux de cette dynamique puisqu’ils permettent à des groupes de chercheurs internationaux de se réunir pour synthétiser les connaissances et données sur la biodiversité. Ces réunions de travail permettent non seulement de produire des synthèses de résultats existants, mais ils sont aussi des lieux de créations de nouvelles idées et/ou méthodes.
Dans ces centres, la dynamique typique d’un groupe de travail implique des interactions productives et variées pendant douze heures par jour et jusqu’à cinq jours consécutifs, alors que les sessions virtuelles perdent de leur efficacité après quelques heures, les participants se fatiguant de devoir fixer un écran. Si les réunions virtuelles peuvent fonctionner pour des tâches courtes et bien délimitées, elles sont moins adaptées aux discussions non structurées et libres – et ont donc du mal à créer la cohésion sociale nécessaire aux percées créatives. Finalement, ce que la crise Covid-19 a révélé le plus, notent les directeurs de centre, c’est que la créativité en recherche est liée autant (si ce n’est plus) aux interactions sociales entre chercheurs qu’à leur qualités scientifiques intrinsèques.
La transition entre les réunions en présentiel et celles entièrement virtuelles a été brutale. En revanche, les centres de synthèses envisagent maintenant une transition inverse progressive vers un retour à la collaboration en personne, à mesure que les mesures de santé publique vont s’assouplir et que les voyages redeviendront possibles. Des modèles hybrides de collaboration peuvent combler le fossé qui sépare les réunions en présentiel et, en fin de compte, favoriser une plus grande productivité dans un avenir post-pandémique. Bien que certains de ces modèles soient déjà encouragés par les centres de synthèse, une généralisation permettra d’aider au développement de nouveaux projets, et de renforcer la collaboration entre les centres de recherche, l’évaluation collective et l’émergence de nouveaux types d’appels à projets transnationaux, etc.
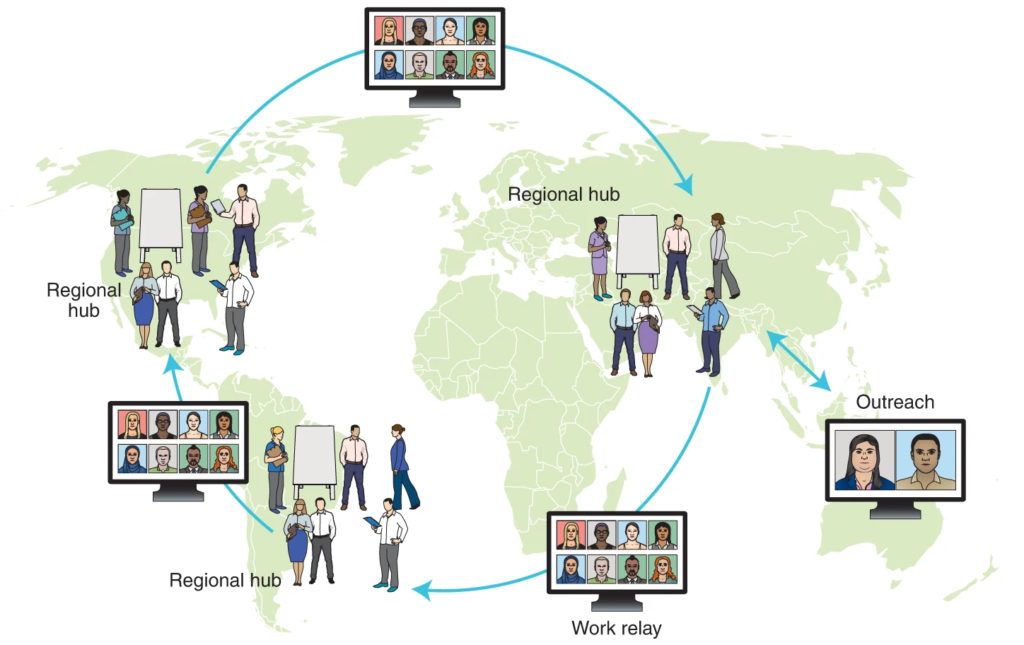
Figure : Un example de modèle hybride de collaboration : les équipes de recherche de chaque région se réunissent simultanément en présentiel et ces “centres régionaux” se coordonnent également virtuellement entre eux. © 2021, Springer Nature Limited
Cette approche, combinant le meilleur du virtuel et du présentiel, pourrait à terme évoluer vers un modèle permettant de surmonter les limites de financement, d’accroître l’intégration mondiale de la recherche tout en contribuant à réduire les émissions de carbone liées aux déplacements des chercheurs ; et ceci en maintenant le potentiel de promotion de l’intelligence collective que sont les centres de synthèse. Ainsi, en tirant parti du meilleur des deux mondes (présentiel et virtuel), les directeurs des centres de synthèse font le pari de pouvoir sortir renforcés de cette crise.

Sa mauvaise réputation le précède. On l’accuse de sentir mauvais, de « crier fort », et plus récemment de sexisme au travers du personnage de Pepe le Putois. Et pourtant du putois, puisqu’il s’agit de lui, on ne connait rien ou presque. C’est le constat fait par le chercheur Sébastien Devillard et son équipe qui ont reçu la bourse Barbault et Weber « Ecologie Impliquée » 2021 pour combler ce manque de connaissance : « Le putois est une espèce difficile à observer et à étudier car c’est un animal cryptique1 et nocturne qui vit en faible densité sur des territoires où mâles et femelles ne se croisent qu’à l’occasion de la reproduction », précise le chercheur.
La fiche d’identité du putois est donc assez sommaire. À l’âge adulte, ce petit mustélidé pèse entre 600 grammes et 1,5 kg, a le régime alimentaire d’un omnivore majoritairement carné et vit dans des milieux ouverts et boisés, souvent à proximité de zones humides. « Or ce que l’on constate, poursuit Sébastien Devillard, c’est que depuis 30 ou 40 ans, les zones humides et les ripisylves2, qui sont leur habitat de prédilection, se dégradent de façon continue. Il y a fort à parier que cela a impacté et impacte encore les populations de cette espèce. »
Si son statut de conservation n’est pas considéré comme à risque par l’UICN, c’est encore une fois par manque de connaissances estime le chercheur : « Lorsque l’UICN ne dispose pas du nombre exact d’individus vivant sur un territoire pour en suivre l’évolution temporelle, elle regarde si l’aire de distribution de cette espèce a diminué indépendamment des densités de populations ». Or le putois est toujours présent en Europe sur une aire de distribution qui semble stable, raison pour laquelle, l’UICN ne l’a pas classé pas comme espèce menacée. « Pourtant, poursuit le chercheur, les études locales réalisées par des naturalistes à l’aide de pièges photographiques, ou par des organisations nationales chargées de la collecte des indices de présence, telles que les observations visuelles ou les cadavres de bord des routes suggèrent que le nombre de ces indices de présence est en baisse continue depuis une vingtaine d’années, particulièrement dans les zones humides. » Pour changer son statut de conservation et justifier de la mise en place de programmes de conservation in situ, les scientifiques vont devoir adopter une démarche de biologie de conservation qui étudiera l’utilisation de l’espace du putois et la taille de ses populations.
L’équipe de recherche s’est donc engagée à comprendre comment ce petit mustélidé utilise et sélectionne son habitat, en particulier sa dépendance aux zones humides et aux zones protégées. Sur le domaine de la Fondation Pierre Vérots dans l’Ain, l’équipe de recherche a prévu d’équiper trois putois de collier GPS pour suivre leurs déplacements et identifier les déterminismes de son utilisation de l’espace. « C’est une première mondiale, souligne le chercheur. Pendant longtemps nous avons été limités par la taille des colliers GPS qui nécessitaient de grosses batteries pour fonctionner et assurer un suivi suffisamment long pour avoir des informations utiles. » En écologie, la règle veut que les animaux ne puissent pas être équipés de collier dépassant 3 à 5 % de leur poids. Jusqu’alors, seuls les mammifères plus gros, à partir de quelques kilogrammes et jusqu’aux girafes ou aux éléphants bénéficiaient de ce type de suivi pour respecter la dimension éthique et de bien-être animal. La miniaturisation des batteries a changé la donne : « Une fois les putois équipés, nous pourrons nous rendre chaque semaine sur le terrain pour télécharger les données qui nous donneront des informations extrêmement fines et jamais égalées sur l’utilisation de l’espace par cette espèce. »
Car la technique est révolutionnaire à plus d’un titre. Auparavant, les données récoltées provenaient de colliers émetteurs VHF utilisant les ondes radio. Pour localiser les individus étudiés, les scientifiques devaient se rendre plusieurs fois par semaine dans le milieu et réaliser une triangulation en se plaçant à trois endroits différents pour capter le signal des colliers émetteurs. « Cette technique de radiopistage classique ne permettait pas d’avoir plus de 2 à 3 localisations par semaine ». Grâce aux colliers GPS, les scientifiques vont pouvoir désormais avoir des données sur l’occupation de l’espace du putois et sur son rythme d’activité tout au long de la journée.
Ce projet n’est que la première étape d’une ambition plus grande : « Si on parvient à montrer que ce dispositif fonctionne, on pourra élargir notre zone d’étude et équiper plus d’animaux. » L’objectif ? Obtenir plus de données et réaliser des analyses de survie, qui permettront alors de faire des modèles démographiques pour estimer la taille de population localement et le taux d’accroissement de la population. Parallèlement les chercheurs souhaitent déployer un protocole de piégeage photographique pour estimer la densité locale des putois. Les scientifiques pourront ainsi proposer de nouveaux arguments pour l’étude de son statut de conservation et peut-être aussi changer le regard que porte notre société sur ce petit mustélidé au fond si discret.
Tribune – Biodiversité : « Il faut inscrire le putois sur la liste des animaux protégés »
Face au déclin préoccupant des effectifs en France et parce que la protection de la biodiversité passe par des mesures concrètes, un collectif de scientifiques et de personnalités engagées demande dans une tribune au « Monde » la signature immédiate d’un arrêté ministériel protégeant cette espèce. Consulter la tribune
____________

Qu’est-ce qui détermine le fonctionnement d’un écosystème ? Si l’on a longtemps considéré cette question en tenant compte de la diversité des espèces qui le compose, on sait aujourd’hui que c’est surtout la diversité des traits portés par ces espèces qui détermine le fonctionnement des écosystèmes. Les traits ? « Ce sont leurs caractéristiques morphologiques, physiologiques ou comportementales. La distribution globale de ces traits, qui est influencée par l’environnement et par l’évolution, reste mal connue à travers les océans », explique David Mouillot, chercheur au laboratoire Marbec*. Une connaissance d’autant plus importante que les traits des espèces sont désormais reconnus comme étant les principaux acteurs du fonctionnement des écosystèmes et de la réponse aux changements globaux. Publiée le 16 mars dans la revue PNAS, l’étude impliquant également Fabien Leprieur (UM), Sébastien Villéger (CNRS) et Arnaud Auber (Ifremer), démontre l’influence prédominante de l’environnement sur la composition en traits des écosystèmes récifaux.

Cette nouvelle étude, la plus complète à ce jour, est publiée aujourd’hui et propose une solution pour relever les défis les plus urgents de l’humanité. Elle démontre qu’une protection bien ciblée des océans pourrait à la fois contribuer à un meilleur approvisionnement en ressources alimentaires marines, fournir une solution naturelle et peu onéreuse pour lutter contre le changement climatique, et enfin davantage protéger la biodiversité menacée.
L’équipe scientifique a identifié des zones qui, si elles étaient protégées, permettraient de sauvegarder plus de 80 % des habitats d’espèces marines menacées et d’augmenter les captures annuelles de plus de huit millions de tonnes par rapport aux débarquements mondiaux actuels. L’étude est également la première à quantifier les émissions de dioxyde de carbone dans l’océan par le chalutage, une pratique de pêche très répandue – et elle révèle que le chalutage rejette des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère chaque année, un volume similaire à celui émis par le trafic aérien mondial.
“La vie océanique est en déclin dans le monde entier en raison de la surpêche, de la destruction des habitats et du changement climatique. Pourtant, seulement 7 % de l’océan mondial est actuellement protégé”, déclare le Dr Enric Sala, explorateur au sein de la National Geographic Society et auteur principal de la publication. “Dans cette étude, nous avons mis au point une nouvelle méthode pour identifier les zones qui, si elles sont fortement protégées, engendreraient une meilleure production alimentaire tout en préservant la vie marine et en réduisant les émissions de CO2“, ajoute-t-il. “Il est clair que l’humanité et l’économie bénéficieront d’un océan plus sain. Nous pouvons concrétiser ces avantages rapidement si les pays travaillent ensemble pour protéger au moins 30 % de l’océan mondial d’ici 2030.”
Pour identifier ces zones prioritaires, les scientifiques se sont notamment focalisés sur les aires marines non protégées et y ont évalué le degré d’impact des activités humaines. Puis, ils ont estimé le niveau d’impact positif qui pourrait découler de la protection de ces zones. Ils ont ensuite mis au point un algorithme permettant d’identifier les zones où des mesures de protection seraient les plus avantageuses pour générer des bénéfices multiples : protéger la biodiversité, augmenter la production de ressources alimentaires marines et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces zones sont identifiables sur des cartes globales (cf. figure) qui pourront concrètement servir de guide aux gouvernements afin que ces derniers puissent mettre en pratique leurs engagements de protection de la nature. L’étude offre ainsi un cadre inédit permettant aux pays de décider des zones à protéger en fonction de leurs priorités nationales.
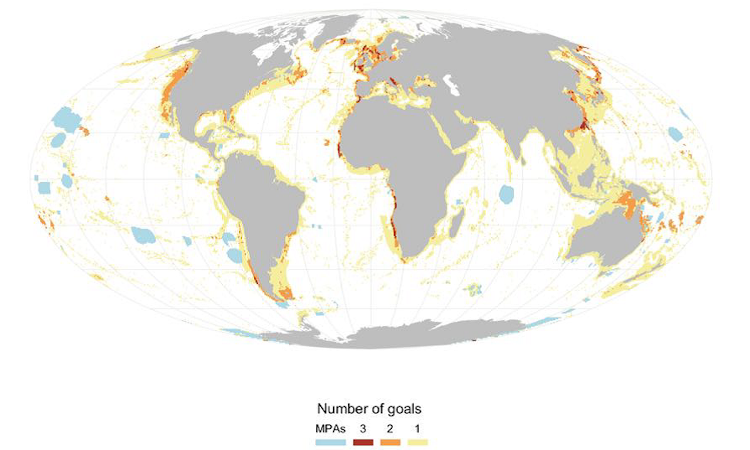
Figure : Répartition des zones pouvant générer des bénéfices multiples (goals) si des mesures de protection strictes y étaient mises en place (bénéfices : protéger la biodiversité, augmenter la production de ressources alimentaires marines et diminuer les émissions de gaz à effet de serre). (Source : Sala et al, 2021)
Seul impératif, il faut qu’au moins 30 % des océans soient protégés pour qu’ils puissent offrir de multiples avantages à l’humanité. Cette étude scientifique pourrait servir de référence pour la 15e conférence des Nations Unies sur la convention sur la diversité biologique, qui aura lieu à Kunming (Chine) en fin d’année 2021 et dont une des cibles clé, serait de protéger 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030 (objectif “30×30”). “Les solutions présentant de multiples avantages sont attrayantes tant pour les citoyens que pour les dirigeants. Notre approche pionnière leur permet d’identifier les zones à protéger afin de faire face aux enjeux majeurs de l’humanité : la sécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de biodiversité”, a déclaré le Dr. Sala.
[1] Biodiversité marine, exploitation et conservation (MARBEC, CNRS/Ifremer/IRD/Université de Montpellier)
Pour aller plus loin... les solutions enjeu par enjeu et des citations supplémentaires

Il y a un an la France entamait sa première période de confinement afin de ralentir la propagation d’une nouvelle maladie : la Covid-19. Causée par l’émergence d’un coronavirus, cette maladie infectieuse est devenue en quelques mois une pandémie et a soulevé de nombreuses interrogations tant sur le plan médical, sanitaire ou environnemental. Au cours des derniers mois, des chercheurs français et internationaux ont rassemblé les connaissances existantes pour mettre en lumière les consensus et dissensus sur les zoonoses au sein de la communauté scientifique et identifier les lacunes de connaissances dans ce domaine. Plusieurs rapports ont été publiés par différentes instances, à l’instar des 22 fiches réalisées par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dès mai 2020 ou encore du rapport de l’Ipbes sorti en octobre dernier. Retour sur les points clés de ces travaux.
MALADIES INFECTIEUSES, ZOONOSES, PANDÉMIES… DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes (les agents infectieux), tels que des bactéries, des virus, différents organismes parasites ou encore des champignons. Elles peuvent se transmettre d’un individu à un autre, au sein d’une même espèce ou d’une espèce à une autre. Dans le cas d’une transmission d’un animal vertébré à un être humain, ces maladies sont appelées zoonoses.
On dit des maladies infectieuses qu’elles sont « émergentes » lorsqu’elles émanent d’un nouvel agent infectieux ou que leur diagnostic et leur identification est récente. Si elles se propagent rapidement au sein d’une population et que l’on constate un grand nombre de cas infectés, on parle d’épidémie, puis de pandémie quand la propagation atteint plusieurs pays et plusieurs continents1.

Une étude issue du projet de recherche Woodiv, co-financé par le Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et le Labex OT-Med, a récemment été reconnue par la Société botanique de France comme étant le meilleur article scientifique publié en 2020 dans la revue Botany Letters. Les auteurs de l’étude ont reçu le prix Jussieu, d’une valeur de 5 000 €, qui a pour vocation de soutenir la recherche en botanique.
Les travaux menés par Cheikh Albassatneh et ses collègues ont permis de produire, pour la première fois, un arbre phylogénétique des différents genres d’arbres présents en Méditerranée européenne, genres identifiés par le consortium dans l’article de Médail et al. (2019). Cette représentation, qui tire son nom du grec phylon pour « famille » et genesis pour « création », figure les liens de parentés entre les êtres vivants, afin de retracer et dater les principales étapes de l’évolution des organismes depuis un ancêtre commun.
Les chercheurs ont ainsi étudié les 64 genres d’arbres indigènes de l’Europe méditerranéenne et construit un arbre phylogénétique basé sur leurs séquences ADN chloroplastiques [1]. Ils ont ensuite comparé cet arbre phylogénétique avec un autre, basé cette fois sur les caractéristiques biologiques, aussi appelées traits fonctionnels.
Les traits fonctionnels, liés au type de reproduction (pollinisation, fleurs hermaphrodites ou unisexe) ou au type de dispersion des graines, sont souvent utilisés comme indicateurs de biodiversité. Ils permettent de caractériser à la fois les menaces qui pèsent sur la diversité taxonomique (c’est-à-dire les différentes espèces ou genres d’arbres) et celles qui pèsent sur la diversité fonctionnelle (c’est-à-dire liée aux différents traits biologiques).
Ces deux méthodes de classification des êtres vivants ont fourni des résultats différents, montrant que la diversité fonctionnelle n’est pas prédictible par la diversité phylogénétique ou taxonomique, et vice versa.
De plus, contrairement à l’arbre basé sur les traits fonctionnels, la fréquence au sein des genres des espèces classées comme vulnérables par l’UICN [2] est distribuée au hasard dans l’arbre phylogénétique (basé sur les séquences d’ADN), hormis pour certains taxons particulièrement mal connus. Ainsi, les causes de la vulnérabilité des arbres de Méditerranée ne sont pas seulement liées à la façon dont ils ont évolués au cours du temps. Elles sont essentiellement à rechercher dans des menaces plus globales se manifestant dans l’ensemble de la Méditerranée (par exemple, changement d’utilisation des terres, incendies, etc.). Les stratégies de conservation des arbres de Méditerranée ne peuvent donc pas se focaliser uniquement sur certains groupes et doivent envisager une réduction générale des impacts affectant leurs habitats.
La phylogénie permet d’aller encore plus loin pour alimenter les stratégies de protection et de conservation des arbres forestiers méditerranéens. Une nouvelle étude issue du même projet de recherche Woodiv a été publié le 7 février dernier dans la revue Diversity and Distributions. Des chercheurs ont utilisé l’arbre phylogénétique des 64 genres d’arbres méditerranéens pour en évaluer la variabilité spatiale, dans 643 parcelles de 50 km x 50 km sur tout le bassin méditerranéen européen (voir Figure). Ils montrent que le sud de l’Espagne, Chypre et certaines îles de la mer Égée contiennent des zones d’une diversité phylogénétique disproportionnellement grande et identifient ces zones comme des cibles prioritaires pour la conservation des arbres forestiers européens.
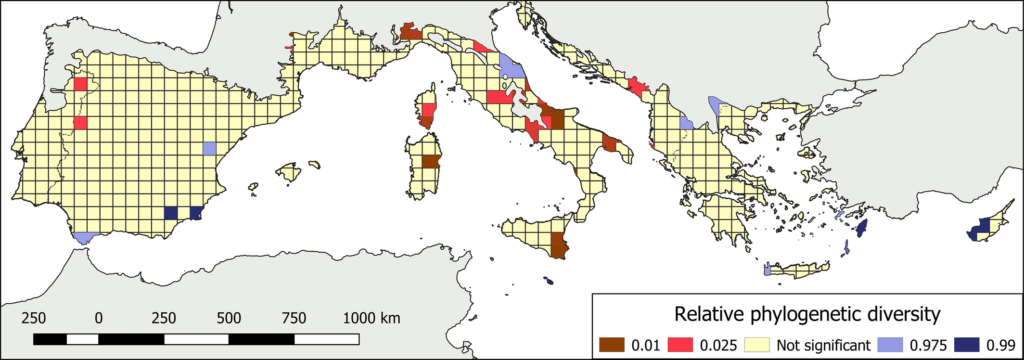
Figure : Carte de diversité génétique relative. Les zones en bleu clair et en bleu foncé, indiquent une diversité phylogénétique des genres euro-méditerranéen significativement plus forte qu’attendue. A l’inverse, les zones rouges et marrons, indiquent une diversité phylogénétique des genres euro-méditerranéens significativement plus faibles qu’attendue.
Les données utilisées dans ces deux études sont issues d’une base de données construite par les chercheurs du projet Woodiv et mise à disposition de la communauté scientifique. Elle fait l’objet d’une publication dans Nature Scientific Data et rassemble plus de un million de données de présence, phylogénétiques et écologiques pour les arbres indigènes de Méditerranée européenne.
[1] Les chloroplastes sont les éléments cellulaires responsables de la photosynthèse
[2] L’Union internationale pour la conservation de la nature est l’une des principales organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature. Elle classe les espèces selon leur risque d’extinction, de « préoccupation mineure » à « éteint » en passant par « quasi menacée », « vulnérable » ou encore « en danger ».



Peut-on se passer des énergies fossiles et préserver la biodiversité ? Comme l’ont montré les échanges lors des journées FRB 2017 et de nombreux travaux de re- cherche sur le sujet, la réponse est loin d’être aisée. À l’occasion de la sortie du prochain rapport de l’Ipbes sur l’état de la biodiversité en Europe et en Asie centrale, la FRB a synthétisé l’une des rares études à avoir compilé et analysé un ensemble de travaux sur la question de production de bois-énergie et de ses impacts potentiels sur la biodiversité européenne : Effects of fuelwood harvesting on biodiversity — a review focused on the situation in Europe de Bouget, Lassauce et Jonsell, 2012. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie possible parmi d’autres, les auteurs se sont ici placés dans un contexte d’intensification de cette filière.

Bonne nouvelle pour la biodiversité marine de la mer du Nord ! Alors que la biodiversité mondiale connait une crise majeure [1], une étude publiée la semaine dernière dans Proceedings of the Royal Society B montre que l’abondance de la plupart des espèces présentant des stratégies écologiques originales vivant en mer du Nord augmente à mesure que la pression de la pêche diminue et que les océans se réchauffent.
La résistance et la résilience des écosystèmes marins face au changement climatique et aux activités humaines sont des préoccupations majeures, notamment car ces écosystèmes assurent toute une série de services essentiels à l’Homme. La pêche par exemple permet de nourrir plus de 10 % de la population mondiale. Le maintien des stocks halieutiques constitue donc aujourd’hui un défi majeur face à une demande accrue. Optimiser la gestion de la pêche est plus que jamais indispensable et nécessite de mieux connaître la réponse des communautés de poissons face aux diverses variations de leur environnement, qu’elles soient d’origine anthropique ou naturelle.
Coordonnée par des chercheurs français et américains et co-financée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans le cadre de son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) et par le groupe Électricité de France (EDF), cette étude apporte des éléments de réponse en se basant sur un travail de synthèse conséquent, rassemblant 33 ans d’enquêtes scientifiques sur l’ensemble de la mer du Nord ! L’objectif ? Caractériser et comprendre la dynamique des communautés de poissons de la mer du Nord dans un contexte de réchauffement des eaux et de réduction progressive de l’intensité de pêche [2].
L’enjeu de l’originalité fonctionnelle (ou de la diversité des fonctions)
L’équipe de chercheurs s’est notamment intéressée aux espèces originales de par leurs caractéristiques biologiques et écologiques que sont les espèces « fonctionnellement distinctes ». Pour cela, elle a étudié les données issues de campagnes scientifiques et les caractéristiques écologiques des espèces de poissons vivant en mer du Nord : leur régime alimentaire, leur âge à maturité sexuelle, la taille de leurs œufs, leur positionnement dans la colonne d’eau, etc. – autant d’éléments qui donnent des indications sur le rôle écologique de ces espèces dans leur écosystème. Pour ce travail, les chercheurs sont partis du principe que les espèces fonctionnellement distinctes – c’est-à-dire les espèces ayant des caractéristiques uniques comme, par exemple, une maturité sexuelle très tardive ou un régime alimentaire particulier par rapport aux autres espèces – peuvent soutenir des rôles écologiques importants et potentiellement irremplaçables, et ainsi contribuer de manière disproportionnée au fonctionnement des écosystèmes.
En conséquence, les chercheurs distinguent à la fois des espèces fonctionnellement distinctes – par exemple le requin-hâ (Galeorhinus galeus) ou la grande castalogne (Brama brama) – et des espèces fonctionnellement communes – par exemple le rouget barbet (Mullus surmuletus) ou le grondin gris (Eutrigla gurnardus). Les chercheurs ont aussi montré que les espèces fonctionnellement distinctes se caractérisent par une maturité sexuelle tardive, une progéniture peu nombreuse et des soins parentaux importants, beaucoup étant des requins et des raies qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire marine.
Les résultats
Durant ces 30 dernières années, l’abondance de la plupart des espèces étudiées a augmenté, et ce, principalement en raison d’une pêche moins intense. Plus précisément, c’est principalement dans le sud de la mer du Nord, là où la pêche était historiquement la plus intense, que l’abondance des espèces fonctionnellement distinctes a le plus augmenté. C’est une bonne nouvelle pour les écosystèmes marins et une démonstration que les efforts de limitation des pressions liées à la pêche finissent par payer, surtout pour les espèces les plus fonctionnellement distinctes qui sont généralement non ciblées par les pêcheries mais malgré cela très sensibles à la pêche suite aux prises auxiliaires (voir figure).
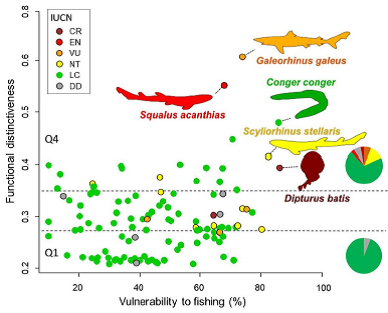
Figure : Les espèces ayant les caractéristiques les plus originales, et étant donc les plus fonctionnellement distinctes, sont les plus vulnérables face à la pêche, certaines d’entre elles étant aussi parmi les plus menacées selon l’UICN. Le statut UICN est représenté par couleur (CR = en danger critique d’extinction, rouge foncée; EN = en danger, rouge; VU = vulnérable, orange; NT = quasi-menacée, jaune; LC = préoccupation mineure, vert; DD = données insuffisantes, gris)
Nous devons cependant poursuivre nos efforts vers une gestion durable de ces milieux fragiles, notamment parce que parmi les espèces les plus distinctes, certaines d’entre elles sont considérées comme menacées d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ont vu leur abondance diminuer au cours des 30 dernières années en mer du Nord, comme le pocheteau gris (Dipturus batis) et l’aiguillat commun (Squalus acanthias).
Enfin, l’équipe de chercheurs souligne l’importance de l’inclusion d’une composante fonctionnelle dans les plans de gestion pour permettre d’assurer une conservation plus pertinente des espèces et des écosystèmes.
[1] Dans son rapport de 2019, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) évoque près d’un million d’espèces animales et végétales menacées d’extinction si aucune mesure n’est prise pour freiner cette tendance.
[2] La réduction progressive de l’intensité de la pêche s’est faite suit à la mise en place, dans les années 1990, d’une réglementation basée sur l’application de quotas en vue d’une exploitation durable.



Julie de Bouville : Qu’est-ce que l’agroécologie ?
Sandrine Petit-Michaut : L’agroécologie scientifique est une branche de l’écologie consacrée aux écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Elle vise à comprendre la façon dont fonctionne les milieux naturels domestiqués par l’homme, et ce dans toute leur complexité : les interactions entre les végétaux, les hommes et les animaux mais aussi les éléments biologiques, physiques, climatiques, etc. C’est une approche holistique qui tend à la fois à analyser la façon dont les pratiques agricoles modifient les écosystèmes, mais surtout à apporter des solutions en s’appuyant sur la biodiversité.
Julie de Bouville : Comment la biodiversité peut-elle être employée dans l’agriculture ?
Sandrine Petit-Michaut : Il y a de nombreuses façons, mais l’une d’elle est de se servir de prédateurs pour diminuer la présence de nuisibles dans les champs. C’est ce qu’on appelle le contrôle biologique par conservation. Les carabes sont par exemple de grands alliés pour les agriculteurs. Ces petits coléoptères consomment des limaces et des pucerons, mais sont aussi de grands consommateurs de graines d‘adventices. Nous avons calculé que ces insectes peuvent absorber jusqu’à 4 000 graines par mètre carré et par jour, ce qui représente une consommation de 50 % des graines produites par les adventices. Plus il y a de carabes dans une parcelle cultivée et plus le renouvellement du stock de graines d’adventices diminue.
Julie de Bouville : Comment favoriser la présence de tels alliés ?
Sandrine Petit-Michaut : Dans une étude récente que j’ai menée à INRAE, nous avons étudié les taux de prédation de pucerons, d’œufs de Lépidoptères et de graines d’adventices au champ en fonction de la structure du paysage et de l’usage de pesticides. Nous avons montré que moins l’on utilisait de pesticides et plus les paysages autour des champs étaient variés, plus la prédation des pucerons dans les parcelles augmentait. En effet l’usage des pesticides peut impacter les espèces alliées. Dans le cas d’un usage modéré ou faible de pesticides, on montre que le contrôle biologique par conservation est plus efficace si les parcelles se situent dans des paysages comprenant de nombreux habitats semi-naturels pour les espèces alliées.
Julie de Bouville : Suffit-il d’avoir des paysages variés autour des cultures pour réduire les intrants ?
Sandrine Petit-Michaut : Non ce n’est évidemment pas suffisant. Néanmoins, des paysages qui abritent beaucoup de cultures de différente nature et des habitats semi-naturels seront plus à même de fournir le gîte et le couvert à de nombreux organismes utiles. De plus, quand il y adifférentes cultures dans un paysage, cela signifie souvent que les agriculteurs font pousser une diversité de cultures sur une même parcelle au cours des années. Cette diversité de la rotation est un bon moyen d’éviter les infestations de nuisibles, et permet donc de réduire l’usage de pesticides. Certaines façons de conduire les cultures peuvent être intéressantes. Prenons l’exemple des carabes qui pondent leurs larves dans les sols. Si les sols des champs sont trop travaillés, le risque est de tuer les larves. Un champ de blé conduit en agriculture de conservation, dont le principe est de réduireconsidérablement le travail du sol, sera donc plus favorable à ces coléoptères qu’un champ de blé voisin régulièrement labouré.
Julie de Bouville : Est-on à même de mesurer l’efficacité de tels systèmes ?
Sandrine Petit-Michaut : Les systèmes agroécologiques sont difficiles à évaluer car nous avons vu qu’ils reposent sur de nombreux facteurs et organismes qui interagissent entre eux. Les effets du déploiement de ces systèmes à l’échelle du paysage est encore plus complexe. Néanmoins, sur la base de suivis sur le long terme dans différents paysages, on observe des tendances qui peuvent alimenter des modèles et nous permettent de faire des projections. On peut par exemple estimer dans quelle mesure l’ajout de haies ou la diversification des cultures dans un paysage permettrait d’augmenter le nombre de carabes. Mais les modèles ne sont pas suffisants pour convaincre les agriculteurs du bien fondé de nos affirmations, nous devons aussi passer par le terrain de l’expérimentation pour prouver nos affirmations.
Julie de Bouville : Avez-vous justement des terrains d’expérimentation ?
Sandrine Petit-Michaut : En France, INRAE a installé à Bretenière, non loin de Dijon, la plateforme CA-SYS qui vise à concevoir et à évaluer des systèmes agroécologiques sur une exploitation de 120 hectares. L’objectif est de remplacer les pesticides en s’appuyant sur la biodiversité, cultivée et sauvage, comme moyen de lutte contre les bioagresseurs, en favorisant les auxiliaires, mais aussi pour améliorer la fertilité des sols, en favorisant les organismes dans le sol. En plus de la baisse de l’usage des pesticides, nous cherchons aussi à réduire l’utilisation d’intrants comme l’eau ou l’azote afin de proposer des systèmes agricoles multi performants d’un point de vue agronomique, économique, environnemental et social. La plateforme se donne entre cinq à dix ans pour parvenir à trouver des équilibres écologiques favorables à l’agriculture. Aujourd’hui beaucoup d’agriculteurs sont intrigués et passent sur la plateforme voir ce que nous faisons. C’est encourageant.

À compter de 2008, l’équipe de recherche part, chaque année, dans les terrasses de Yuan Yang caractériser le riz : « nous avions dans l’idée que la résistance de ce riz tenait à sa diversité » précise Jean-Benoît Morel. Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques prélèvent dans une centaine de champs plusieurs plants de riz et les séquencent. Et ce qu’ils découvrent se révèle extraordinaire : « La diversité des riz des terrasses est complètement fractale, à toutes les échelles y compris dans chaque parcelle de champs. » poursuit le scientifique. Les chercheurs la comparent alors aux 3 000 variétés de riz séquencées dans le reste du monde « et ce que l’on a constaté, c’est que ce riz à un niveau de diversité qui approche 80 % du niveau de diversité des riz mondiaux ». Mieux encore, l’analyse de 400 génomes du Yuan Yang leur fait penser que ces variétés sont très anciennes : « On a l’impression que c’est un riz qui a peut-être même été cultivé avant les autres, il y a plusieurs milliers d’années ».
Jean-Benoît Morel et son équipe poursuivent leur enquête et réalisent des tests pour déterminer les gènes sous pression de l’environnement, comprenez des gènes dont la forme fluctue en fonction des pressions extérieures que la plante subit : « On a constaté que les seuls gènes qui répondaient à ce critère étaient les gènes de l’immunité. » Autrement dit la seule pression détectée à laquelle s’adapterait en permanence le riz est la pression exercée par les agents pathogènes. « Le déploiement de systèmes immunitaires très différents entre les riz cultivés à Yuan Yang a poussé l’agent pathogène à se spécialiser sur chaque type de riz, l’empêchant de passer facilement de l’un à l’autre » commente le scientifique.
Dans les terrasses du Yuan Yang, la sélection naturelle darwinienne joue donc à plein régime. Lorsque les champignons parviennent à s’attaquer à certains plants de riz, les autres plants disposent de gènes pour y faire face. Les plants sensibles aux pathogènes diminuent tandis que les autres, insensibles, croissent. Ce sac et ressac, permis par la diversité au sein de l’espèce, offre donc au riz d’avoir le meilleur antidote.
Mais la diversité du riz n’explique pas tout. La longévité des terrasses réside entre les mains de la population locale qui depuis des millénaires sème et travaille le riz. Pour comprendre la façon dont la population Hani gère sa diversité, l’équipe de recherche a fait appel à des sociologues pour mener l’enquête. Trois règles sociales ont été identifiées :
« À elles seules, ces règles permettent spontanément d’instaurer dans ce territoire un accès illimité, immédiat et très peu couteux, à un large stock de semences maintenues in situ. »
Ce modèle serait-il d’une façon ou d’une autre transposable en Europe ? « Dans les terrasses, on a estimé qu’il fallait maintenir une vingtaine de gènes de résistances différents, cela n’est évidemment pas généralisable, car les socio-écosystèmes ne sont pas les mêmes, mais cela donne un ordre d’idée. » Lorsque l’on sait qu’en France seules quelques variétés de riz sont cultivées, le chemin semble encore long pour avoir une agriculture résiliente et durable. « En France, les agriculteurs qui cultivent le blé commencent néanmoins à suivre cette tendance, souligne le chercheur. Aujourd’hui, 12 % des surfaces de blé sont cultivées avec plus d’une variété par parcelle. » Les sorties de ce travail de recherche vont permettre d’aider les agriculteurs à constituer des mélanges de variétés durables et pertinentes. Une autre idée que souhaiterait faire passer Jean-Benoît Morel serait de sensibiliser les agriculteurs à la diversité comme bien commun. « Si on ne la conserve pas, les agents pathogènes sauront développer des contre-attaques. ». Mais les agriculteurs ne sont pas les seuls à convaincre : « Il y a de puissants verrous notamment du côté de la filière qui n’a pas intérêt à proposer de nombreuses variétés, mais à privilégier une variété qui rapporte beaucoup au détriment d’autres variétés qui ne représenteraient que des micros marchés. »
La diversité fait pourtant partie des solutions de demain « Or le problème est qu’il n’y en a de moins en moins en France. Pour l’étudier, il faut aller la chercher ailleurs, dans les pays du sud notamment » rappelle Jean-Benoît Morel. Dans ces pays, celle-ci est encore active, de nombreux paysans la travaillent au quotidien. « INRAE est en train d’identifier avec le Cirad des chantiers communs au sud dans cette perspective. L’enjeu est à la fois de protéger les cultures et de voir comment transposer leurs solutions chez nous. » Car, vous l’aurez compris, de la diversité découle l’éternité.

Réduction des pesticides et engrais, prédiction des récoltes, adaptation au changement climatique… Les défis posés à l’agriculture sont multiples et les mathématiciens ont des solutions à apporter. Focus sur leurs travaux à l’occasion du Salon de l’agriculture qui s’est tenu à la Porte de Versailles en mars dernier.

Le réchauffement climatique impacte les productions agricoles en Afrique de l’Ouest… depuis déjà une vingtaine d’années ! Si de nombreux travaux prévoyaient une baisse des rendements agricoles de 10 à 15 % en 2050 dans ces régions du fait de l’élévation des températures, aucune ne s’intéressait jusqu’alors à la situation actuelle. Deux climatologues de l’UMR Espace-Dev, Benjamin Sultan et Dimitri Defrance, viennent de publier une étude sur ce sujet en collaboration avec un laboratoire japonais, spécialisé dans les simulations environnementales.

Répartir les efforts entre la production de biocarburants, une transition vers des régimes alimentaires moins carnés et la reforestation de pâture serait une bien meilleure option pour l’agriculture de demain que de miser uniquement sur une seule de ces stratégies. Cette combinaison permettrait d’allier à la fois des objectifs de sécurité alimentaire, de préservation de la biodiversité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon une étude publiée par le Cirad et ses partenaires dans Environmental Research Letters.

Contre la paroi du quai, des plongeurs font descendre dans les profondeurs trois murs végétaux de roselières de 150 mètres carrés. Ces herbiers artificiels reproduisent les habitats des espèces marines locales en imitant les caractéristiques des herbiers de posidonie méditerranéens. Ils ont été conçus pour abriter les juvéniles de plusieurs espèces locales de poissons. Au pieds de ces herbiers, des blocs de bétons, réalisés en impression 3D, sont accrochés pour recréer des cavités dans lesquels les poissons devenus un peu plus grands s’abriteront. Marc Bouchoucha, responsable du projet et membre du laboratoire Environnement Ressources Provence-Azur-Corse de l’Ifremer explique : « Les ports ont rarement été perçus comme des écosystèmes, ils ont été très souvent envisagés sous l’angle économique ou culturel, mais peu sous l’angle écologique. Or, ce que nous constatons, c’est qu’ils ont majoritairement été construits sur des petits fonds côtiers abrités, qui ont, pour les poissons, des fonctions écologiques très importantes. »
Le cycle de vie des poissons est en effet tel qu’ils pondent au large, voient leurs œufs flotter et être portés par les courants, puis éclore. Au niveau des côtes, les larves trouvent abri dans les herbiers. Les juvéniles s’y développent et, avant d’atteindre le stade adulte, quittent les roselières pour s’abriter, un peu plus bas, dans de petits rochers. Une fois arrivés à maturité, les poissons rejoignent le large pour y accomplir le reste de leur cycle.
« Aujourd’hui, ce cycle de vie est particulièrement bousculé par les taux d’artificialisation du pourtour méditerranéen qui ne cesse de croitre depuis les années 1950. Dans certaines zones comme Monaco, on atteint même des taux d’artificialisation à 90 % souligne Marc Bouchoucha. »
Le chercheur et son équipe ont donc pour objectif de limiter l’impact de l’artificialisation sur le cycle de vie des poissons en réparant certaines fonctions écosystémiques dégradées . « Mais avant cela, il a fallu nous assurer que les conditions environnementales étaient satisfaisantes ». Une attention particulière a été portée à la contamination chimique en Méditerranée. « Sur ce point, les réseaux de surveillance et les études mis en œuvre par l’Ifremer sur les masses d’eau côtières au cours des 20 dernières années ont montré que la tendance globale est à l’amélioration. » Les indicateurs sont donc « au vert » : pas de hausse significative des niveaux de contamination ; des niveaux constants en contaminants et inférieurs aux normes de qualité environnementale pour la grande majorité des sites suivis ; certes il reste quelques foyers de contamination historique dans certains secteurs identifiés, mais globalement les efforts d’assainissement des dernières décennies ont porté leurs fruits. « Les conditions étaient donc réunies pour restaurer efficacement le milieu. »
En s’inspirant des habitats naturels, la société Seaboost a recréé les habitats des juvéniles. Pour s’assurer de leur efficacité, les scientifiques ont prévu de réaliser des suivis à grande échelle. Ceux-ci sont effectués à différents niveaux. Tout d’abord dans les ports, pour s’assurer que ces habitats ne soient pas colonisés par des espèces envahissantes issues des bateaux provenant du monde entier. Puis sur les espèces elles-mêmes, pour comprendre comment ces populations s’adaptent à ce milieu pollué et sonore. Enfin, dans les zones naturelles, pour voir comment les poissons se développent : «Nous devons pouvoir scientifiquement prouver que de telles installations contribuent à l’amélioration des populations naturelles, souligne Marc Bouchoucha ». Tous les moyens sont mobilisés pour assurer le suivi « On a installé à demeure des caméras sur les récifs pour filmer en continu les poissons, on a couplé cela avec des logiciels de reconnaissance automatique issus de l’intelligence artificielles pour nous permettre d’identifier et de compter les poissons. L’ADN environnemental est aussi utilisé pour étudier la biodiversité difficilement observable à l’œil nu, comme les espèces dites cryptiques qui, sur le plan morphologique, ne présentent aucune différence, mais qui, d’un point de génétique, présentent des différences notables. »
Dans les années à venir, d’autres ports devraient mettre en place ces nurseries de poisson. Cette nouvelle est accueillie avec prudence par Marc Bouchoucha : « La restauration est un outil qui ne doit pas servir à justifier la dégradation d’habitats naturels. Il est important de rappeler qu’elle est en général utilisée lorsque l’on n’a plus d’autres solutions. La protection doit toujours primer sur la restauration. »

Philippe Clergeau, chercheur au Muséum national d’histoires naturelles de Paris et spécialiste de la nature en ville constate « Les politiques de verdissement des villes sont évidemment une bonne chose, à la fois pour la qualité du cadre de vie et pour la reconnexion des citadins avec la nature. Néanmoins, on remarque que ce sont trop souvent les mêmes espèces qu’on emploie en milieu urbain au risque de les voir un jour disparaître. » Ainsi les platanes alignés dans de nombreuses villes françaises pour leur résistance à la pollution ou la sécheresse se retrouvent aujourd’hui menacés par la maladie du Chancre et risquent de connaître le même destin que l’Orme dans les années 60, décimé par un champignon pathogène. « Le problème n’est pas l’espèce en tant que telle, souligne Philippe Clergeau, mais le fait que ce soit une monoculture. » À l’approche monospécifique, le scientifique répond par l’approche « biodiversitaire ». « Si les grandes pelouses, les alignements de platanes ou les toitures de sedum constituent autant de monocultures qui pourront se révéler fragiles face aux aléas climatiques ou sanitaires, à l’inverse, la diversité d’espèces ayant des relations entre elles s’avère bien plus résistante ; elle apporte une certaine stabilité aux chaînes alimentaires, aux paysages urbains. Une ou des espèces peuvent disparaître sans que toute la plantation soit détruite. » S’inspirer du fonctionnement de la nature et de sa complexité fait donc partie des pistes pour rendre les villes plus durables.
D’ores et déjà dans le monde de l’architecture, les praticiens dissèquent le fonctionnement des habitats ou des plantes pour bâtir leurs immeubles. À Harare, capitale du Zimbabwe, l’architecte Mike Pearce s’est inspiré des termitières pour construire un centre d’affaire sans air conditionné : en y laissant l’air circuler par une multitude de petits trous, il a permis à la température du bâtiment de se réguler d’elle-même sans jamais dépasser les 27°. D’autres bâtisseurs, tels que les frères Vernoux, respectivement architecte et biologiste, créent des bâtiments vertueux inspirés de la phyllotaxie, comprenez la façon dont les végétaux disposent et arrangent leurs feuilles pour favoriser au mieux la récupération de la lumière. Aujourd’hui, leurs bâtiments construits en forme de spirale gagnent en énergie.
Mais le scientifique Philippe Clergeau invite à aller plus loin. « Ce biomimétisme appliqué aux objets ou aux bâtiments, doit pouvoir s’appliquer à l’urbanisme. » L’idée centrale est, à l’image des écosystèmes, de privilégier un fonctionnement circulaire qui permet à la fois l’auto-entretient et le maintien des espèces. « Si on a une platebande de fleurs par exemple, il va falloir l’entretenir, biner, sarcler, arroser régulièrement pour la maintenir en bon état. L’approche « biodiversitaire » va en revanche nous permettre d’éviter cela. L’idée est de reconstituer un petit écosystème : en utilisant des couvres sols, on va conserver plus d’humidité dans le sol, limiter les espèces envahissantes et la faune qui va s’y développer permettra de reconstituer une litière. La gestion en sera d’autant plus réduite ». Le scientifique appelle à ouvrir les lentilles de nos jumelles et à penser cette bio inspiration à l’échelle de la ville.
Dès à présent des projets urbains tendent à s’approcher de ce principe d’ « urbanisme écosystémique ». Ainsi aux États-Unis, à Portland, un plan d’urbanisme prenant en compte l’écosystème a-t-il été pensé pour le quartier de Lloyd. L’idée de départ était de se rapprocher du fonctionnement de l’écosystème préexistant: une forêt de conifères. Des mesures ont été prises pour établir une base théorique représentant le profil écologique du site avant la présence humaine. L’objectif était de réaménager le quartier, inverser les impacts environnementaux négatifs et redonner certaines fonctionnalités écologiques au lieu.
Avant la présence humaine, 90 % de la forêt était composée d’un couvert arboré abritant de très nombreuses espèces. Le plan d’urbanisme a prévu d’augmenter le couvert forestier indigène de 30 %, de planter des végétaux diversifiés à la fois dans les sols et sur les murs des façades, de créer 8000 mètres carré de « parcelles » de forêt de conifères et de fournir un habitat aquatique grâce à la collecte des eaux pluviales. La collecte des eaux de pluie a aussi été étudiée pour répondre à 100 % de la demande en eau potable. Le plan envisageait d’utiliser les bâtiments, paysages et systèmes techniques pour imiter la récupération d’eau de la forêt tout en permettant une multiplication par cinq de la densité urbaine. Enfin, l’énergie solaire et les cycles du carbone ont été pris en compte pour s’approcher des conditions d’utilisation de l’énergie solaire par la forêt et réduire les émissions de carbone aux niveaux d’avant le développement. Le quartier ainsi conçu n’était alors plus pensé comme une ville, mais plutôt comme un écosystème urbain dans lequel devait se déployer un système social et économique.
En dépit de leur théorisation, ces types d’approches demeurent encore à l’état de projet et trop souvent la biodiversité n’est pas un des axes majeurs de la réflexion : « On reste beaucoup sur les flux et le métabolisme. Le vivant est encore peu pris en compte, déplore Philippe Clergeau. » Bien que les scientifiques soient au début des recherches d’opérationnalité, les connaissances pour s’engager dans ce type de projets sont bien réelles. « La plupart des municipalités l’ont bien compris, les trames vertes et bleues ne sont pas toujours une science exacte permettant aux musaraignes ou hérissons d’arriver en centre-ville, mais elles font partie d’un ensemble de projets qui tendent doucement mais sûrement à créer une nouvelle forme de milieu urbain résilient et évolutif. »
POUR EN SAVOIR PLUS
Clergeau P. (coord.) (2020) Urbanisme et biodiversité, vers un paysage vivant structurant le projet urbain. Apogée ed.
Blanco E. et al. (soumis) Urban ecosystem-level biomimicry and regenerative design: Linking ecosystem functioning and urban built environments. Sustainability

Il a longtemps été supposé que les espèces rares contribuaient faiblement au fonctionnement des écosystèmes. Des études récentes ont cependant remis en cause cette hypothèse, la notion de rareté ne recouvrant pas seulement l’abondance ou l’étendue géographique des espèces, mais aussi l’originalité de leurs rôles écologiques. Ces espèces aux fonctions uniques étant irremplaçables, il est désormais fondamental de comprendre leurs caractéristiques écologiques, de cartographier leur distribution et d’évaluer leur vulnérabilité aux menaces actuelles et futures.
À partir de deux bases de données regroupant les espèces de mammifères terrestres (4 654 espèces) et d’oiseaux (9 287 espèces) à l’échelle mondiale, des scientifiques du Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité (Cesab) de la FRB, de laboratoires du CNRS, des universités Grenoble Alpes et de Montpellier et de leurs partenaires ont cartographié le nombre d’espèces écologiquement rares dans des zones géographiques de 50 km par 50 km à travers le monde. Ils ont démontré que la rareté écologique des mammifères se concentre dans les tropiques et dans l’hémisphère sud, avec des pics dans les îles indonésiennes, à Madagascar et au Costa Rica. Il s’agit surtout d’espèces nocturnes et frugivores (par exemple, les chauves-souris ou les lémuriens) ou insectivores (comme certains petits rongeurs). Les espèces d’oiseaux écologiquement rares se rencontrent principalement dans les régions montagneuses tropicales et subtropicales, en particulier en Nouvelle-Guinée, en Indonésie, dans les Andes et en Amérique centrale. Il s’agit essentiellement de espèces frugivores ou nectarivores (comme les oiseaux mouches). Dans les deux cas, la rareté écologique est largement surreprésentée dans les îles.
Les chercheuses et chercheurs ont également classé ces espèces en fonction de leur statut sur la liste rouge de l’UICN1. Ils ont ainsi constaté que les espèces écologiquement rares étaient surreprésentées dans les catégories menacées de l’UICN, tant pour les mammifères (71 %) que pour les oiseaux (44,2%) par rapport aux espèces écologiquement communes (2 % et 0,5 %, respectivement). Pour chaque espèce, ils ont évalué leur exposition à l’impact anthropique, au développement humain (IDH) et aux conflits armés, ces deux derniers influençant les politiques de conservation. Ils ont constaté que les mammifères et les oiseaux écologiquement rares étaient plus touchés par l’influence humaine que les espèces plus communes et qu’ils étaient présents dans tous les types de pays, indépendamment de leur indice de développement ou du nombre de conflits2. Concernant l’influence du changement climatique, les scientifiques ont montré, à l’aide de modélisations, que les oiseaux écologiquement rares seront les plus touchés et que nombre d’entre eux risquent l’extinction d’ici 40 ans.
Ce « profilage » des espèces écologiquement rares met en évidence que leur préservation, même dans les zones actuellement protégées, n’est pas suffisante. La conservation des espèces est, aujourd’hui encore, trop souvent basée sur leur identité et leur statut démographique. Pourtant, la prise en compte de l’originalité de leurs rôles écologiques est essentielle et devrait aussi guider les actions de conservation. C’est un vrai changement de paradigme des politiques de conservation qu’il faut désormais mettre en oeuvre pour préserver ces espèces essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes.
Pour en savoir plus... des exemples d'espèces écologiquement rares
[1] L’Union internationale pour la conservation de la nature est l’une des principales organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature. Elle classe les espèces selon leur risque d’extinction, de « préoccupation mineure » à « éteint » en passant par « quasi menacée », « vulnérable » ou encore « en danger ».
[2] Par exemple, les Philippines possèdent un indice de développement humain (IDH) faible et un nombre élevé de conflits et sont considérées comme un point chaud de rareté écologique (19 espèces de mammifères et 15 d’oiseaux écologiquement rares) tout comme l’Australie qui, à l’inverse, possède un IDH élevé et un faible nombre de conflits et accueille respectivement 10 espèces de mammifères et d’oiseaux écologiquement rares.
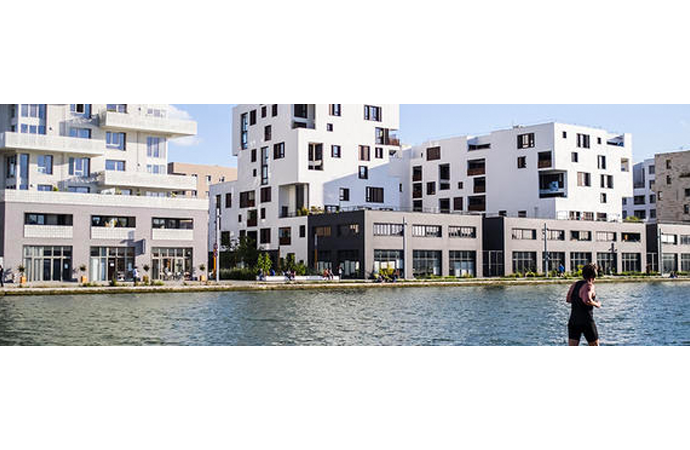
La densité humaine facilite la propagation des virus. Retraçant l’histoire des liens entre urbanisme et préoccupations sanitaires, le philosophe Thierry Paquot nous invite dans ce podcast à repenser la configuration des villes, jouer la complémentarité avec la nature et réfléchir à ce que signifie à notre époque une ville à « échelle humaine ».

Les zones urbanisées occupent environ 10 % des surfaces terrestres, une proportion qui ne cesse de croître. Ces espaces constituent les milieux de vie de plus de 50 % de la population mondiale et contribuent de manière importante au changement climatique.
Face à ces réalités, des efforts de plus en plus importants sont engagés dans de nombreuses villes pour améliorer la qualité de vie et limiter les contributions de ces espaces aux changements globaux, grâce notamment à des plans d’adaptation au changement climatique et en faveur de la biodiversité.
Parmi ces actions, l’accroissement de la place accordée aux arbres, avec l’objectif d’évoluer vers de véritables « forêts urbaines », représente une contribution majeure.

Pour celles et ceux qui ont la chance de posséder un coin de verdure, la période de confinement a offert l’occasion de jardiner, s’adonner à l’exercice physique ou simplement – aujourd’hui plus que jamais – de contempler. Contempler la végétation généreuse en ce printemps avancé, son cortège de pollinisateurs virevoltant autour des premières fleurs ; contempler les oiseaux chanteurs donnant fièrement de la voix.
Pourtant, tous les jardins ne connaissent pas la même vitalité. Ils sont d’abord le reflet des paysages alentour : un jardin bordé de monoculture hypertraitée abritera une biodiversité certainement plus pauvre, malgré l’effet refuge dont pourront bénéficier quelques espèces. Mais le degré d’attractivité tient beaucoup à nos comportements. Ce sont nos pratiques qui garantissent la bonne santé du jardin et des écosystèmes qu’il renferme.

Vous avez publié il y a un mois une opinion intitulée D’une économie de la biodiversité à une économie de la conservation de la biodiversité sur le site de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). Que vous inspire la publication du Conseil d’analyse économique1 (CAE) qui pour la première fois publie une note sur la biodiversité ?
Pour la communauté des économistes, c’est une réelle avancée car c’est le premier rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) sur la thématique biodiversité. Par ailleurs, le diagnostic proposé est concret et les solutions proposées adaptées à la crise que subit le monde vivant. Notre pays qui héberge une biodiversité exceptionnelle à la fois en métropole et dans ses territoires et ses départements d’outre-mer a une responsabilité de premier plan.
Êtes-vous en accord avec les conclusions du Conseil d’analyse économique ?
Oui tout à fait. Le rapport fait le constat que la biodiversité s’effondre et s’interroge sur la raison pour laquelle on ne parvient pas à stopper cette érosion. Il pointe notamment du doigt les subventions dommageables à la biodiversité, qui sont aujourd’hui nombreuses. Le Conseil cite par exemple la fiscalité sur les terrains non bâtis qui encouragent les propriétaires à construire pour gagner de l’argent. Le Conseil souligne aussi le besoin majeur de renforcer la séquence “Éviter Réduire Compenser” (ERC). Il y a aujourd’hui trop de dérogations, trop de manquements à la loi sur ce sujet. Tant qu’il n’y a pas de sanction, les aménageurs ne chercheront pas à mettre en place des stratégies visant à réduire leur empreinte sur les écosystèmes naturels, à investir dans de l’ingénierie écologique pour réduire leurs impacts. Ils pointent aussi comme autre dysfonctionnement les mille feuilles réglementaires autour de la protection de la biodiversité qui posent des problèmes de gouvernance. Tout cela fait partie d’un constat partagé avec celui que nous faisons dans l’Opinion publiée sur le site de la FRB.
Quels sont vos points de divergence ?
La note du Conseil d’analyse économique souligne, à plusieurs reprises, que c’est le manque de prise en compte de la valeur économique de la biodiversité qui est une des origines du problème. Certes, il est évident que les bénéfices fournis par la biodiversité sont considérables, mais ils restent de nature collective et tous les travaux qui ont détaillé la nature et les montants de ces bénéfices depuis plus de 20 ans n’ont pas réussi à convaincre les entreprises d’investir dans la biodiversité. Prenons l’exemple des produits pharmaceutiques. Dans les années 1990, le discours était le suivant : c’est en investissant dans la préservation de la biodiversité sauvage – notamment dans les pays du Sud – que l’on réussira à trouver de nouveaux médicaments dont le secteur pharmaceutique pourra tirer des bénéfices. 30 ans plus tard, on constate que le coût de la recherche sur ces dîtes molécules naturelles est trop élevé. La R&D pharmaceutique a totalement réinvesti ses recherches dans la chimie. Un autre secteur où l’on constate un net recul de l’utilisation des ressources naturelles, c’est le textile. On est passé de 41 % de la production mondiale en 2008 à moins de 30 % en 2018. La note du Conseil souligne ce manque d’investissement des entreprises, mais elle ne propose pas pour autant un changement d’approche – dans le champ de l’économie de la biodiversité – sur le sujet. C’est notre constat de départ dans la note d’opinion de la FRB : la biodiversité s’avère moins utile ou moins rentable que prévue pour le monde de l’entreprise, tout du moins à court-terme, c’est-à-dire l’échelle de temps à laquelle raisonnent les entreprises.
Que faudrait-il faire alors, selon vous, pour que le secteur économique prenne en compte efficacement la biodiversité ?
Nous pensons qu’il faut mettre la biodiversité au cœur du projet économique. En reconnaissant la nature comme composée d’entités que l’on veut maintenir pour elles-mêmes et non pas pour ce qu’elles valent économiquement. La nature n’a pas besoin d’être pensée comme un capital ou un actif, mais comme une entité qui bénéficie de droits à être préservée. Cela ne veut pas dire qu’on personnifie la nature mais plutôt qu’on lui reconnait des droits à être réparée lorsqu’elle subit des dommages, des préjudices écologiques issus d’activités humaines. Ce droit existe cependant déjà. Cette année, dans les calanques par exemple, des braconniers ont été sanctionnés au titre du préjudice écologique et ont dû payer le coût nécessaire pour réparer ce qu’ils avaient pris à la nature. Mais il faut admettre que ce type de décision est encore très rares et, malheureusement, les délits environnementaux sont ceux pour lesquels on constate le plus faible taux de sanction, sous prétexte que l’on aurait recours à une “écologie punitive”. Il nous semble, de notre côté, qu’il s’agit surtout de respecter un principe de responsabilité et de réciprocité vis-à-vis d’une nature qui nous donne tout mais à qui on ne restitue jamais rien.
Comment ce droit pourrait-il se traduire d’un point de vue économique ?
La nature ne doit plus être évaluée sur la base d’équivalence en valeurs économiques, mais sur celle d’équivalence en valeurs écologiques. D’un point de vue comptable, la nature n’est plus un actif que l’on fait entrer dans les comptes des entreprises, des administrations ou des ménages, mais une entité à part avec laquelle on effectue des transactions et pour laquelle on crée des comptes spécifiques de créances et de dettes. Si une entreprise utilise – ou détruit – des populations animales sauvages pour sa production, elle va générer une dette vis-à-vis de la nature. Il faut que dans ses comptes, cette dette apparaisse et que dans les comptes de la nature, on puisse rendre visible la créance dont elle bénéficie. Le remboursement peut se faire alors par la restauration écologique ou par tout investissement de l’entreprise qui permette à la biodiversité de se régénérer (si on est dans une situation où la nature peut se régénérer). Tout cela peut aussi être créateur de nouveaux emplois et de croissance, comme cela a été observé à chaque fois que l’État a décidé d’investir dans la protection de biens publics – comme les monuments historiques ou encore l’approvisionnement en eau – ou de réguler des marchés qui détruisait ces biens publics.
Vous donnez en somme à la nature des droits pour se défendre…
Oui, car ce qu’omet le Conseil dans sa note, c’est la puissance des lobbies dans les négociations où la conservation de la biodiversité est en jeu. Or il est important de rappeler que les transitions écologiques des secteurs économiques sont le fruit de négociations où les défenseurs de la nature ne pèsent pas, ou très peu. Les arguments autour de la création d’emplois, de la croissance, de la crise que connaît un secteur, etc. sont toujours ceux qui vont peser le plus. À l’échelle des territoires, ils sont portés par les secteurs économiques et défendus par les préfets et les élus locaux. Au sein des multinationales par les directions financières ou des ressources humaines. De l’autre côté, qui défend la nature ? Le ministre de l’environnement, les associations, certaines administrations déconcentrées pour les territoires, les directions de l’environnement ou du développement durable pour les multinationales. Mais au fond, soyons clair, ces acteurs pèsent peu dans ces négociations. C’est pourquoi une approche par le droit de la biodiversité à être véritablement représentée et défendue lors des négociations qui s’opèrent à différentes échelles territoriales et organisationnelles pourraient faire évoluer les choses en matière de transition écologique de notre système économique.
La recherche économique sur la biodiversité peut-elle contribuer à cette transition écologique ?
Au niveau des instituts de recherche et des universités, nous avons besoin d’économistes qui connaissent mieux l’écologie scientifique et les modèles qui y sont associées, comme le propose en partie l’économie écologique. Par ailleurs, de nombreuses innovations, facilitant l’analyse des conditions d’une transition écologique de l’économie, peuvent être attendues en matière de comptabilité, d’ingénierie technico-économique, de planification territoriale et sectorielle, d’économie du droit, etc. Du point de vue de la R&D, il y a aussi la nécessité de renforcer les compétences au sein de nombreux secteurs économiques. Il est par exemple aujourd’hui compliqué d’accompagner un agriculteur dans une transition écologique qui nécessite de changer la structure de son exploitation, à utiliser des solutions fondées sur la nature et à utiliser de l’ingénierie écologique pour maintenir des rendements importants tout en renonçant aux pesticides ou à certains outils mécaniques. Il y a aussi un besoin d’économistes en mesure de travailler à la fois sur des modèles standards de business model, mais aussi capable d’évaluer les coûts et des méthodes associées à certaines réglementations environnementales pour réduire les risques de contentieux et proposer des solutions opérationnelles.
Le plan de relance proposé par le gouvernement vous parait-il prendre suffisamment en compte la biodiversité ?
100 milliards d’euros sont annoncés pour relancer l’économie française dont 30 milliards pour la transition écologique. C’est bien, mais le problème est que cette transition écologique est avant tout énergétique. 11 milliards sont investis dans les transports, 9 milliards dans l’industrie énergétique, 7,5 pour le bâtiment et le logement, et quasi rien pour la biodiversité. Par ailleurs, ce que l’on constate depuis 20 ans, c’est une baisse des investissements privés en matière de protection de la biodiversité, comme le souligne la note du Conseil d’analyses économique d’ailleurs. L’État a donc un rôle majeur à jouer. Un vrai plan de relance écologique pourrait être un plan de relance fondé sur des espaces de restauration naturelle comme pour les forêts ou les prairies. L’avantage lorsque qu’on a des logiques d’investissement dans la biodiversité, c’est d’en voir très vite les effets. Il suffit de restaurer une zone humide ou de mettre en réserve intégrale un écosystème marin pour tout de suite voir des résultats. C’est très concret. Et pour conclure sur une note économique : les emplois qui accompagneraient ces investissements sont non délocalisables et les personnes qui vivent à proximité de ces espaces peuvent bénéficier de plein d’opportunités associées à cette nouvelle biodiversité…
—


Au cœur de l’été, la nouvelle est presque passée inaperçue. Et pourtant, à travers le monde, les populations de poissons migrateurs (saumon, anguille, alose, esturgeon…) ont chuté de 76 % en près de 50 ans. Un pourcentage vertigineux, mis en lumière par un rapport inédit publié en juillet dernier par plusieurs ONG. Or ce déclin n’est pas inéluctable. De nombreuses équipes de recherche, comme celle de l’INRAE où travaille Patrick Lambert, luttent au quotidien pour conserver les poissons migrateurs.
Ce sont les cinq pressions identifiées par l’Ipbes qui sont responsables de cette chute des populations : le changement climatique, la pollution, la surexploitation des ressources, ici la pêche, la perte d’habitat, en particulier les barrages, et les espèces envahissantes. Toutes cumulées, ces pressions impactent les poissons migrateurs qui voient leur population se réduire à un rythme alarmant d’année en année.
Il n’y a pas de solutions simples. Pour enrayer le déclin, il faut pouvoir agir sur toutes les causes. Si certaines actions, comme la lutte contre le changement climatique et la pollution, vont profiter indirectement aux poissons migrateurs, il est également possible de mettre en place des actions ciblées pour les protéger. Par exemple les passes ou ascenseurs à poissons vont permettre aux migrateurs de franchir les barrages et leur permettre ainsi d’atteindre les lieux de reproduction. Nous pouvons aussi inciter les pouvoirs publics à réduire l’effort de pêche. Le plan national anguille, mis en place en 2009, vise, par exemple à réduire drastiquement la pêche à l’anguille.
En effet, cette espèce fréquentait tous les cours d’eau d’Europe, de l’Espagne à l’Allemagne en passant par les îles britanniques, au début du XIXe. Or depuis un siècle, on assiste à son déclin. La dernière reproduction naturelle a eu lieu en 1994. À cette date, nous avons réussi à récupérer quelques individus et nous les avons aidés à se reproduire. Ces poissons mesurent 2 mètres et effectuent des milliers de kilomètres, les tenir en captivité est un vrai défi. Il a fallu ensuite attendre 15 ans pour que leurs portées atteignent leur maturité sexuelle et se reproduisent à leur tour. En 2007, nous avons relâché 6 000 individus, mais cela n’était pas assez. Nous estimons que seule une dizaine a survécu. En 2012, nous avons relâché 700 000 larves. C’est cet ordre de grandeur que nous devons atteindre pendant quelques années si nous voulons espérer que suffisamment d’esturgeons survivent. Cette année, des pêcheurs nous ont signalé un individu de plus d’1m50 près des zones de reproduction. Peut-être un animal de 2007. On a donc des signes encourageants mais l’histoire n’est pas encore écrite.
C’est effectivement un risque. Nous avons dû pour répondre à cette question, mener des travaux de génétique. Les résultats sont plutôt encourageants, car avons constaté qu’originellement leur diversité génétique était faible. Nous faisons néanmoins tout notre possible lors de la reproduction assistée pour choisir les mâles et les femelles les plus différents possibles. Ce type de restauration ne pose pas seulement des questions de recherche génétique, elle pose aussi des questions liées à l’éthologie, la toxicologie ou encore au climat.
Il y a toute une réflexion à mener sur l’approche intégrative, c’est-à-dire l’approche qui combine différentes disciplines comme ici l’éthologie, la toxicologie ou encore l’étude du changement climatique (cf exemple encadré). L’idée est d’intégrer toutes les questions soulevées par ces disciplines dans des modèles pour prédire le devenir des populations de migrateurs. Ces résultats nous aideront à discuter avec les décideurs et le public au niveau national, mais aussi au niveau international, car nombre de ces espèces parcourent de grandes distances et traversent les frontières. La volonté politique doit également être transfrontalière.
« Nous développons des approches qui permettent de diagnostiquer la présence de contaminants dans les milieux et leurs effets. Nous travaillons notamment avec une équipe de INRAE sur le cas de l’alose, un poisson migrateur qui disparait d’un de ses bassins de reproduction en Gironde. Nous cherchons à vérifier si leurs frayères, c’est-à-dire les endroits où ces poissons vont se reproduire, sont de qualité chimique suffisante pour permettre le développement embryonnaire. Pour cela, nous avons développé une approche ex situ (hors du milieu naturel) basée sur la dérivation d’eau de la rivière pour l’étudier. Nous avons ainsi l’avantage d’être en conditions contrôlées de laboratoire, avec de l’eau de la rivière qui coule en continu. Nous avons disposé des embryons de l’alose dans ce canal et attendons de voir s’ils se développent correctement. Nous en sommes au tout début de l’expérience. Si les aloses se développent bien nous aurons prouvé que le milieu n’est pas contaminé et il faudra alors expliquer pourquoi ces poissons migrateurs disparaissent de ce bassin. »

Centré sur un prototype innovant situé dans le bois de Boulogne à l’ouest de Paris, le projet Life Adsorb va tester de nouveaux modes de dépollution des eaux issues principalement du ruissellement pluvial du périphérique avec de rares contributions d’eaux usées. L’objectif du projet est de réduire de 95 % la pollution minérale et organique, c’est à dire de macro et micro polluants. La solution proposée sera transférable à des sites densément urbanisés tel que le site parisien mais aussi également à des sites plus ruraux.

Si l’environnement contient naturellement des bactéries antibiorésistantes, les activités humaines peuvent tout à la fois les favoriser ou les éliminer par le traitement des rejets et déchets.
Depuis 2017, la FRB accompagne un projet ambitieux de synthèse scientifique visant à faire le bilan des solutions efficaces pour éviter que la résistance aux antibiotiques ne continue à se propager dans l’environnement. Une revue systématique de la littérature scientifique menée en 2019 par Anaïs Goulas, post-doctorante, appuyée par les experts d’un consortium piloté par l’Inserm, avec notamment l’Inrae (anciennement Inra) et le CNRS et des experts méthodologiques, a permis d’évaluer les connaissances actuelles sur les effets de différentes stratégies sur la réduction de l’antibiorésistance, évaluée par la quantification et la qualification des bactéries résistantes aux antibiotiques, gènes de résistance aux antibiotiques ou éléments génétiques mobiles.
Les principaux résultats de cette revue systématique ont été présenté dans un résumé pour décideurs disponible via le lien suivant.
Consulter le résumé pour décideurs

À l’image des grandes métropoles sud-américaines, les besoins en eau de la capitale de l’Équateur ne cessent d’augmenter. L’entreprise publique qui gère cette ressource précieuse à Quito s’est associée à l’IRD afin d’approvisionner la population de cette ville en eau de bonne qualité sans compromettre l’environnement.

Apparue au milieu des années 1980, cette jeune science invite à identifier les espèces et les écosystèmes menacés, diagnostiquer les causes de leur déclin, proposer, tester et valider des moyens d’y remédier : « Jusqu’alors, c’était l’affaire de naturalistes passionnés, de gestionnaires d’espaces protégés ou d’ONG, souligne le biologiste de la conservation François Sarrazin. Depuis, les scientifiques les aident à identifier les priorités et améliorer les pratiques de conservation, à comprendre leurs causes de succès et d’échecs. » Là où le gestionnaire s’empare d’une action à une échelle locale, le scientifique peut apporter le recul statistique sur un grand nombre d’opérations et permet d’améliorer les pratiques à une échelle plus globale.

Longtemps considérées comme de « mauvaises herbes » pour la compétition qu’elles exercent sur les plantes cultivées, les plantes adventices se révèlent être en réalité de grandes alliées dans les écosystèmes agricoles. C’est ce que montre l’étude du projet Disco-Weed publiée le 28 mai 2020 dans Frontiers in Sustainable Food Systems. À partir de données récoltées sur 184 parcelles cultivées de la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre, une plaine céréalière de 450 km² s’étendant autour du centre d’études biologiques de Chizé (CNRS/La Rochelle Université), les chercheurs ont montré que la diversité des plantes adventices, et en particulier les espèces rares, contribuaient à la fourniture simultanée de plusieurs fonctions écologiques (multifonctionnalité). En effet, les plantes adventices favorisent : le contrôle des ravageurs des cultures ; la fertilité du sol et des fonctions associées aux cycles du Carbone, de l’Azote et du Phosphore ; la pollinisation et le nombre d’espèces d’abeilles sauvages, un indicateur de la biodiversité.
Dans la seconde étude publiée le 8 juillet 2020 dans Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, les scientifiques ont cherché à comprendre les mécanismes à l’origine du maintien de la diversité de plantes adventices dans les parcelles agricoles pour favoriser leur présence. L’équipe a étudié la flore adventice dans 444 parcelles cultivées de la même Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre. Dans ces différentes parcelles, les chercheurs ont montré que la diversité des adventices est plus importante dans les zones « d’interfaces », situées entre la bordure de parcelle et le premier rang de culture. L’étude montre pour la première fois qu’en plus de leur rôle de refuge pour la diversité de la flore adventice, ces zones non-cultivées agissent comme des ‘corridors’ (milieux reliant fonctionnellement entre eux des habitats vitaux pour une espèce) entre les différentes parcelles d’un paysage agricole. L’étude montre aussi qu’une plus grande proportion d’agriculture biologique dans le paysage augmente la diversité de plantes adventices dans ces zones d’interfaces, en particulier dans les parcelles en céréales d’hiver. « La diversité des plantes adventices étant essentielle pour la fourniture de multiples fonctions écologiques, une gestion extensive de ces zones est une stratégie pour la préserver dans les paysages agricoles » souligne Sabrina Gaba, chercheuse à l’INRAE, auteure des deux publications et porteuse du projet Disco-Weed. L‘étude met en effet en évidence l’importance de :


Alors que la biodiversité est en péril sur notre planète, le retour des loups en Amérique du Nord et en Europe, notamment en France, pourrait avoir de quoi réjouir. Pourtant, les médias et l’opinion publique se focalisent sur la mortalité engendrée dans les troupeaux : « Les effets négatifs de la présence des loups, comme le nombre de moutons tués, sont visibles et faciles à attester. Des effets positifs existent, mais ils sont souvent indirects et donc difficiles à mettre en évidence », souligne Jean-Louis Martin1, co-auteur avec Simon Chamaillé-Jammes2 et Donald M. Waller3 d’une synthèse4 inédite sur les enjeux posés par la cohabitation entre cerfs, loups et humains. Cette synthèse s’appuie sur leurs propres travaux et sur les dernières études disponibles. Les chercheurs y alertent sur la nécessité de prendre du recul pour mieux apprécier toute l’étendue des enjeux que pose cette cohabitation.
__________
1 Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE – CNRS / Univ. Montpellier / Univ. Paul Valéry Montpellier / EPHE / IRD)
2 Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE – CNRS / Univ. Montpellier / Univ. Paul Valéry Montpellier / EPHE / IRD)
3 Université du Wisconsin
4 Martin et al. 2020 Deer, wolves, and people: costs, benefits and challenges of living together Biol.Reviews

Une lutte biologique bien menée en agriculture peut ralentir la déforestation et prévenir la perte de biodiversité. C’est ce que vient de montrer une équipe internationale comprenant des entomologistes, des biologistes de la conservation, des agro-écologistes et des géographes. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Communications Biology – Nature.

Il est toutefois intéressant de constater que le terme, peu importe son contexte d’utilisation, s’est longtemps ancré dans un même et unique rapport au monde : l’appréhension de ce qui est autre par le seul prisme de la division entre deux mondes, celui de l’humain et celui de la nature. Plusieurs auteurs ont depuis contesté cette posture.
Les auteurs de cet article proposent de remettre en perspective ces critiques pour cheminer vers un nouveau champ d’études à explorer dans le domaine de l’écologie. Soit la découverte et les potentialités offertes par l’étude des liens entre l’humain et le non-humain, qu’ils nomment « écologie relationnelle ».

L’île a perdu 44 % de ses forêts naturelles depuis les années 50 et le rythme de la déforestation s’accélère. Avec 90 % d’espèces endémiques, c’est une biodiversité unique qui est menacée de disparition. L’enjeu de la Grande île est de concilier la sauvegarde de son patrimoine naturel et la lutte contre la pauvreté. Un défi de taille qui nécessite des actions menées sur plusieurs fronts. Les recherches du Cirad et de ses partenaires accompagnent le pays dans ce sens au travers de plusieurs projets. Revue de détails à l’occasion de la journée internationale des forêts, le 21 mars.

Or comme le souligne une opinion coordonnée par l’économiste Harold Levrel D’une économie de la biodiversité à une économie de la conservation de la biodiversité, pour être réellement efficace, cette démarche nécessite une véritable révolution copernicienne des stratégies qui sont associées à cet objectif. L’Opinion invite nos dirigeants à passer d’une « économie de la biodiversité » à un « projet économique de conservation de la biodiversité ». Pour cela, les objectifs de conservation de la biodiversité, tels qu’ils sont mentionnés dans les textes légaux, doivent être envisagés comme le point de départ des réflexions en matière de transition écologique des secteurs économiques, ce qui nécessite une certaine refonte des outils de régulation et d’évaluation économique. Comme l’avait déjà affirmé l’Ipbes dans son évaluation mondiale de la biodiversité, revisiter l’économie et ses fondements est la condition nécessaire pour entrer dans « le monde d’après ».
L’opinion est disponible dans les ressources téléchargeables ci-dessous.
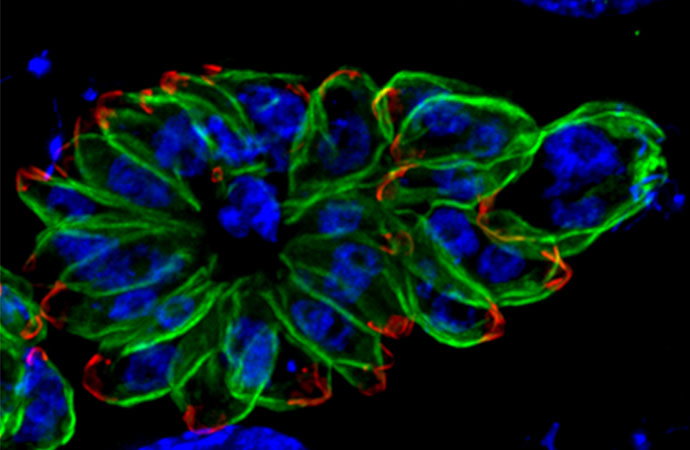
Les parasites impressionnent aussi bien par leurs capacités d’adaptation que leur taux de multiplication souvent extraordinaire, ou encore leurs modes de circulation efficaces dans tous les écosystèmes …. Le MNHN en détient une des plus grandes collections au monde : « La collection des Vers Parasites du Muséum a été principalement constituée entre 1960 et 1990 sur la base du matériel récolté par le laboratoire dirigé par le Professeur Alain Chabaud, au cours de missions réalisées à l’étranger, précise la parasitologue. Depuis, on vient nous consulter dans le monde entier pour les étudier ou les identifier » Ainsi Coralie Martin se souvient du cas de ce jeune brésilien de 16 ans qui avait un vers de 10 cm traversant l’œil. Le vers était à la fois situé dans la chambre postérieure et antérieure de l’œil. « Ce qui était étonnant, c’est que ce parasite se retrouvait généralement chez les oiseaux, mais pas chez l’homme souligne la scientifique ». Après enquête, les chercheurs ont découvert que le jeune garçon travaillait sur les poteaux électriques ou nichaient de nombreux oiseaux. « Nous supposons que ces nids étaient infestés de puces et de tiques porteuses du parasite, c’est ainsi que la transmission a pu se faire. » Après le diagnostic posé, les chercheurs ont pu affirmer que ce cas était accidentel et que le risque était ponctuel et limité. « Ce type de conclusions, seuls les parasitologues peuvent les poser, pas les médecins qui n’ont pas ces connaissances poursuit Coralie Martin. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de pouvoir travailler ensemble ».
Depuis quelques années, les collaborations pluridisciplinaires se multiplient au travers d’initiatives comme One Health. Née du constat que 60% des maladies humaines infectieuses connues ont une origine animale, One Health invite à une approche collaborative entre les grands secteurs scientifiques pour prévenir et contrôler les infections. En ces temps troublés, ou les crises sanitaires se multiplient, la chercheuse Coralie Martin, se surprend même à rêver de voir ressusciter des professions qui disparaissent sûrement : « Faire appel à des taxonomistes1 spécialistes des moustiques par exemple aurait pour avantage d’aider à déterminer les zones à risque ou circulent les pathogènes, mais aussi et surtout à identifier les espèces qui en sont porteuses. » Car pour le paludisme comme pour la maladie de Lyme, tous les moustiques ou toutes les tiques ne sont pas porteurs du parasite pathogène. « Une réponse fine et mesurée des experts permettrait d’éviter de graves erreurs sur l’environnement, comme ce fut le cas dans les années 60 avec l’emploi massif de DDT dans la lutte contre le paludisme poursuit la chercheuse. » L’emploi du pesticide a eu en effet pour conséquence de s’accumuler dans l’environnement et d’avoir des effets délétères sur la reproduction des oiseaux au point d’être à l’origine du célèbre livre de Rachel Carson « Printemps silencieux » qui fustigeait l’emploi massif des biocides sur l’environnement.
L’étude de la biologie des parasites dans la faune sauvage permet aussi d’extrapoler les connaissances en travaillant en laboratoire pour apporter des informations utiles à la médecine humaine et vétérinaire. « Nous avons été un des premiers laboratoires à développer des modèles d’étude du paludisme chez la souris avec l’agent pathogène Plasmodium précise Coralie Martin. » Une avancée majeure pour la compréhension du fonctionnement d’une des maladies humaines les plus répandues au monde. Présents dans les glandes salivaires du moustique, les parasites sont injectés à l’homme lors de repas sanguin de l’insecte. Ils envahissent d’abord le foie pour se multiplier et donner plusieurs milliers de parasites qui circulent dans le sang. C’est cette phase sanguine qui est responsable des symptômes et la cible des principaux médicaments antipaludiques.
Si l’étude des parasites est porteuse d’espoir pour guérir des parasites, la compréhension de leur fonctionnement est aussi source d’espoir pour la recherche médicale « On touche ici au biomimétisme précise Coralie Martin. On espère en effet pouvoir utiliser certaines molécules que les parasites produisent pour abaisser la réponse immunitaire de l’organisme qu’ils occupent et lutter ainsi contre certaines maladies auto immune. » Si, longtemps, les chercheurs se sont intéressés à quelques groupes présentant une menace immédiate pour la santé humaine ou pour celle des espèces domestiquées, les recherches sur le monde des parasites révèlent depuis peu de temps pourquoi ils représentent une dimension fascinante de la vie par leur capacité adaptative et les promesses de traitements thérapeutiques. L’étude de leur diversité permettra dans les années à venir des avancées majeures pour la santé humaine et la compréhension toujours plus fine du monde du vivant.
__________
1 La taxinomiste a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier, les nommer et les classer.
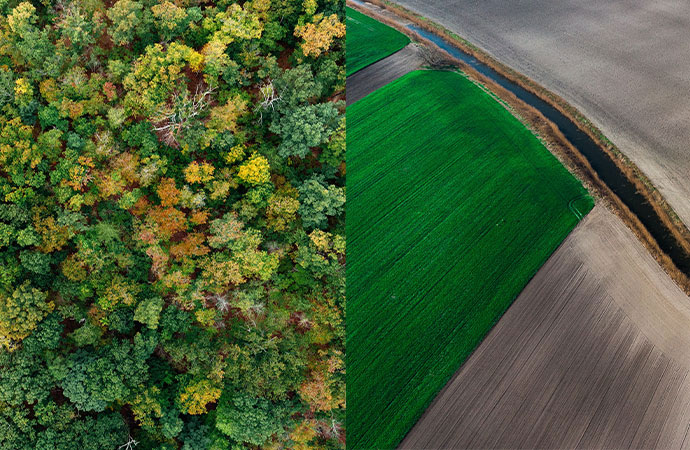
Pour le chercheur du CNRS, et du Cirad, Serge Morand, cette sur-mobilité n’est pas seulement responsable des crises environnementales, mais elle est aussi responsable des crises sanitaires que nous vivons aujourd’hui : « Avant les années 60, une épidémie restait habituellement confinée à un ou quelques pays étroitement liés. Par la suite, les épidémies sont devenues de plus en plus pandémiques. » Ainsi la dengue, les coronavirus, le chikungunya sont autant d’épidémies devenues pandémiques en se propageant à l’échelle planétaire grâce à l’ultra mobilité des marchandises et des personnes. Pour l’écologue de la santé, une des causes majeures est notamment due à l’augmentation du trafic aérien : « Le nombre total de passagers est passé d’environ 330 millions en 1970 à plus de 4 milliards en 2017 : une augmentation de 1 200 % ! » Les foyers secondaires d’infection apparaissent ainsi en des temps records dans des pays connectés les uns aux autres.
Dans un récent article scientifique intitulé Les risques d’accélération des maladies infectieuses dans l’Anthropocène, Serge Morand et un de ses confrères ont notamment démontré que les pays les plus impactés par les épidémies ont paradoxalement tendance à faire partie des pays les plus riches. Ainsi trouve-t-on les États-Unis à la première place des pays les plus touchés, suivis par le Royaume-Uni, l’Inde, le Canada, le Japon, la France se situant, quant à elle, à la 9e place de ce triste palmarès, juste avant l’Italie et derrière l’Espagne. « La mondialisation a accéléré les interconnexions entre les villes de la planète qui deviennent les points centraux du départ − Wuhan en Chine avec la crise du coronavirus − et de l’arrivée des épidémies, souligne le chercheur. Enrayer ces pandémies nous oblige donc à repenser la mobilité et à réorganiser nos territoires. »
Parmi les solutions évoquées par Serge Morand, une idée prend modèle sur les écosystèmes résilients : « On a constaté que les épidémies se propagent dans des territoires homogènes, urbains. » Cette homogénéisation se retrouve dans l’agriculture ou la sylviculture avec les monocultures, des territoires modelés par l’homme, très peu résilients aux maladies et aux invasions biologiques. « A contrario, les territoires en mosaïques, c’est à dire composés d’une multitude d’entités hétérogènes formant le paysage, sont, on le sait, d’un point de vue écologique très résilients. Mon pari, poursuit le chercheur, est le suivant : si ces écosystèmes diversifiés sont bons pour la santé animale ou végétale, pourquoi ne le seraient-ils pas pour l’homme ? »
Si de très nombreuses études se sont penchées ses dernières années sur les bienfaits de la nature sur le bien être humain, aucune n’a pour le moment réussie à prouver qu’un paysage diversifié dans son ensemble améliorait la santé humaine. « On a néanmoins des faisceaux d’indices qui montrent que vivre à proximité de la nature est bon pour la santé, poursuit Serge Morand » Ainsi une équipe de recherche a montré que lorsque l’environnement est peu diversifié, notamment en plantes, le microbiote1 humain est moins riche en bactéries utiles à notre système immunitaire, rendant ainsi notre organisme moins résilient et sujet à des maladies auto immunes s’accélérant avec l’âge. « Le système immunitaire des humains a besoin d’être éduqué au contact d’antigènes véhiculés par des bactéries que l’on retrouve dans l’eau potable de milieux naturelles, mais aussi par tous les animaux qui les portent. »
Si les liens entre biodiversité et santé humaines doivent être encore explorés, l’écologie de la santé livre néanmoins plusieurs enseignements pour contrer la densité, vectrice d’épidémie « Il faut se servir de la biodiversité en ville comme d’un pare feu pour se préserver des rongeurs ou des insectes réservoirs de virus ou bactéries. Il faut s’inspirer des régulations écologiques qui jouent dans les milieux riches en biodiversité. » Une équipe de recherche s’est ainsi intéressée aux « paysages de la peur » des rongeurs, et plus précisément aux formes particulières d’habitat que ces animaux ressentent comme dangereux. L’intérêt supplémentaire de cette méthode est d’éviter la dératisation par produits chimiques.
Se servir de la biodiversité pour réguler les espèces donc, mais aussi s’inspirer des organisations de la nature pour limiter les dommages de l’extrême interconnexion : « c’est l’idée de la modularité. Il faut organiser de l’espace de façon à compartimenter les réseaux d’interactions entre les humains. » Rendre les territoires plus autonomes, c’est ce qu’offre dès à présent les écoquartiers. Ces territoires à échelle humaine proposent commerces, jardins, bureaux, activités sportives et sociales. « On pourrait même imaginer qu’en période de crise, ces quartiers se ferment évitant ainsi de mettre toute une ville en confinement. »
La modularité de la ville, comme en écologie, crée la résilience et invite à une vie plus sédentaire. « Car à terme, le scénario le plus durable est de diminuer, voire d’inverser les taux de mobilité mondiale, surtout s’il fait partie intégrante d’un mouvement beaucoup plus important visant à la durabilité planétaire en réduisant l’empreinte environnementale » conclut Serge Morand. Comme le montre l’expérience de la pandémie actuelle, seule une réduction considérable des taux de mobilité et de contact permet de ralentir et d’arrêter ce virus terriblement contagieux.
_______________
1 Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes – bactéries, virus, parasites, champignons non pathogènes, dits commensaux – qui vivent dans notre organisme. Dans l’organisme, il existe différents microbiotes, au niveau de la peau, de la bouche, du nez… Le microbiote intestinal est le plus important d’entre eux pour un poids de 2 kilos !

Le commerce des espèces sauvages et la consommation de viande d’animaux sauvages jouent un rôle dans la transmission de pathogènes des animaux aux humains. C’est ce que révèle notamment la crise actuelle liée au Covid-19. L’augmentation de la consommation d’animaux sauvages, en particulier en Asie du Sud-Est, constitue ainsi une menace croissante pour la santé publique. Le projet international ZooCov, coordonné par le Cirad, entend développer un système flexible et intégré de détection précoce de la transmission du virus entre l’animal sauvage et l’être humain. Sélectionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre d’un appel spécifique aux recherche sur les coronavirus, il contribuera à prévenir de futures pandémies de zoonoses.
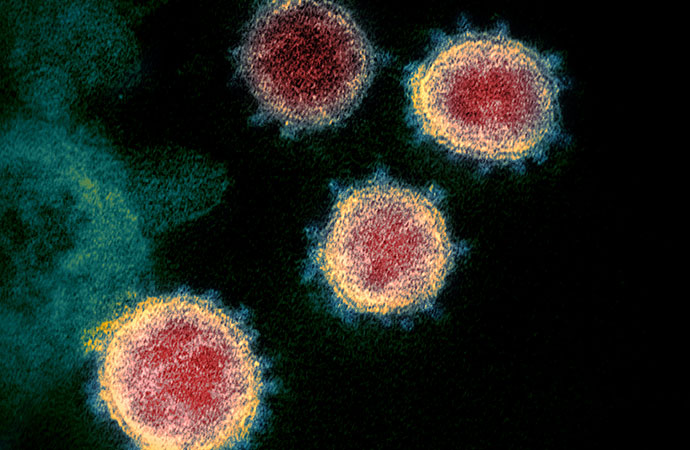
Spécialiste de la réplication virale des virus à ARN comme les coronavirus, Bruno Canard nous livre son regard sur l’épidémie de Covid-19 et l’importance de la recherche fondamentale, sur le long terme, pour lutter plus efficacement contre ces virus.

L’appel provient d’un collectif de 23 chercheurs, consultants et acteurs d’ONG de 13 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Une publication qui marque une première étape de leur collaboration. Ensemble, ils affirment que les politiques de déforestation et de reforestation doivent revoir la façon dont elles prennent en compte les décisions humaines, et non leurs ambitions. Pour ces spécialistes, les choix et les activités humaines qui en découlent sont un angle mort des politiques et des discours sur la transition forestière et paysagère. L’article insiste sur la nécessité de rendre explicites les enjeux et intérêts des décideurs quels qu’ils soient lors des négociations.
Les auteurs proposent ainsi une toute nouvelle approche : celle des jeux de stratégie, qui mettent en lumière les objectifs et les contraintes des acteurs de la gestion forestière. Cette méthode a d’ailleurs déjà fait ses preuves dans plusieurs arènes de négociations à des échelles locales et régionales. Ces jeux aident les joueurs à surmonter les préjugés et à sortir des impasses. Audacieux, les auteurs de l’article suggèrent que les négociateurs des grandes négociations internationales, telles que la Cop15 de la Convention sur la diversité biologique (2021, Kunming, Chine) et la Cop26 de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (2021, Glasgow, Royaume-Uni), se prêtent au jeu ! « Cela fait un quart de siècle que nous discutons, et pourtant nous sommes loin d’avoir inversé les tendances. Il est peut-être temps d’essayer autre chose », déclare Claude Garcia, écologiste au Cirad et premier auteur de l’article.

L’épidémie de Covid-19 questionne en profondeur notre rapport aux animaux. Dans un podcast proposé par le CNRS, Frédéric Keck, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d’anthropologie sociale de l’EHESS (unité CNRS/Collège de France/EHESS), nous rappelle l’importance de maintenir le lien avec la faune qui nous entoure, afin de percevoir plus rapidement les signes précurseurs de maladie chez ceux qu’il appelle « les sentinelles des pandémies ».

Cette équipe internationale, coordonnée par le European Topic Center on Biological Diversity (ETC/BD), a réalisé un travail de synthèse conséquent, en parti financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), et par le groupe Electricité de France (EDF).
L’équipe de recherche a analysé des données recueillies dans plusieurs pays européens au cours d’enquêtes de sciences participatives – des programmes de surveillance à long terme basés sur le volontariat. Au total, 14 programmes de suivi d’oiseaux et 6 programmes de suivi de papillons ont été comparés au réseau de sites protégés.
L’étude montre qu’au-delà des espèces ciblées, la moitié des 155 espèces d’oiseaux suivis bénéficient de la protection des sites Natura 2000, et particulièrement dans les forêts. Les chercheurs soulignent ici l’importance d’un suivi standardisé de la biodiversité et l’intérêt de rendre ces données disponibles afin d’évaluer l’état de la biodiversité à grande échelle et d’informer au mieux les acteurs des besoins de conservation.
Si la protection s’avère efficace pour les oiseaux, elle l’est en revanche moins pour les papillons. En effet, les sites Natura 2000 prennent avant tout en compte les exigences des oiseaux et peu celles des insectes. « 38 % des aires protégées sont des zones agricoles et des prairies fréquentées par les papillons » souligne Guy Pe’er, porteur du projet Cesab Lola BMS. « Or ceux-ci n’y bénéficient pas d’une bonne protection. La PAC (Politique agricole commune) n’a mis en place ni moyens ni plan de gestion pour soutenir les zones agricoles abritant pourtant une grande biodiversité». Guy Pe’er met aussi en avant le besoin « de cibler les efforts pour limiter les facteurs de pressions sur la biodiversité, et notamment l’agriculture », particulièrement cette année où sera discuté la réforme de la PAC et les objectifs post-2020 pour la CDB (Convention sur la diversité biologique).

Pour le microbiologiste Francis Martin, chercheur à l’INRAE, exploiter l’arbre seul n’est pas suffisant : « Pour bien assimiler le carbone, la plante a besoin de tout son cortège d’espèces microbiennes associées, ainsi que des bactéries, des collemboles1, des nématodes et autres petits animaux de la rhizosphère2 qui assurent le cycle du carbone dans les sols. » Dans ce processus de recyclage, chacun a son rôle à jouer. Mais certains microorganismes se révèlent clé. « Les champignons symbiotiques ont en effet une place privilégiée dans la récupération du carbone, poursuit Francis Martin. Ils créent l’interface entre la racine de la plante et le reste de la communauté microbienne du sol. Ils sont les répartiteurs du carbone vers leurs propres réseaux de filaments fongiques. » Un quart du carbone de la photosynthèse est ainsi redistribuée aux communautés microbiennes du sol par les champignons mycorhiziens.
Si ces découvertes laissent entrevoir la possibilité pour les forestiers de sélectionner le microbiome3 et l’associer aux arbres pour les rendre plus performant dans leur capture du carbone, la vision du microbiologiste est tout autre : « le meilleur des systèmes est déjà en place. Et ce depuis des millions d’années… » En effet, dans les forêts primaires ou peu anthropisées réside une très grande diversité d’espèces. Chaque arbre vit avec 200 à 300 champignons symbiotiques bénéfiques, qui jouent chacun un rôle bien spécifique. Certains sont spécialisés dans l’absorption de l’azote, d’autres du phosphate ou des microéléments, d’autres encore protègent la racine des pathogènes. « Donc ces systèmes naturels qui ont évolué depuis des dizaines de millions d’années, ont atteint un optimal écologique que les forestiers auront bien du mal à imiter. » Ainsi, laisser les forêts revenir à leur état naturel, ne plus couper les arbres, ne plus ramasser le bois mort, laisser la diversité des champignons et des autres organismes se développer est l’une des solutions pour atténuer le changement climatique. Cette gestion durable pourrait d’ailleurs être développée sur près du 20 % du territoire européen grâce au réseau Natura 2000.
« En revanche, dans certains cas, comme dans celui de la sylviculture intensive, où les plantations forestières sont utilisées pour la production industrielle du bois, il est envisageable d’associer aux arbres un cortège de champignons symbiotiques mycorhiziens4 spécifique pour stimuler fortement leur croissance initiale » souligne Francis Martin. Ces champignons symbiotiques mutualistes5, appelés champignons mycorhiziens, se rencontrent à l’automne dans les forêts. Ainsi, le Cèpe de Bordeaux, les Chanterelles, la Truffe, l’Amanite tue-mouche font partie de ce groupe de champignons stimulant la croissance des arbres … « Ce que l’on récolte à l’automne en forêt n’est autre que l’organe sexuel de ce réseau fongique de filaments – le mycélium – qui vit en interaction avec la plante. Nous voyons seulement la partie émergée de l’iceberg ».

Le carbone bleu correspond au carbone séquestré par les écosystèmes côtiers végétalisés. Les marais salés, les mangroves, ou encore les herbiers, sont autant d’écosystèmes susceptibles de capter le carbone sur le court terme, environ une dizaine d’années, dans leur biomasse et sur des temps encore plus longs, des milliers d’années, dans leurs sédiments. Contrairement aux sols terrestres, ces sédiments côtiers ont tendance à s’étendre avec l’augmentation du niveau de la mer On constate donc que la séquestration de carbone par les sédiments et les végétaux augmentent au cours du temps, en particulier lorsque ces écosystèmes sont sains et en bonne santé.
On sait que les marais salés, les mangroves ou les herbiers stockent le carbone 10 à 20 fois plus que les forêts tempérées ou boréales. Lorsque que les forêts séquestrent moins de 10 g de CO2 par mètre carré et par an, les écosystèmes côtiers en retiennent 100 à 200 g. Néanmoins ces écosystèmes représentent une partie moins importante de la surface du globe que les océans ou les forêts. Si certaines études indiquent qu’on obtient un stockage de carbone équivalent aux forêts, les travaux se poursuivent pour mieux quantifier cette séquestration et la part du carbone relâchée vers l’atmosphère.
C’est extrêmement complexe. Nous travaillons avec d’autres scientifiques à la meilleure compréhension du rôle des zones côtières dans ce cycle du carbone. La principale difficulté vient du fait que nous avons une très forte hétérogénéité spatiale et temporelle. Les échanges de carbone interviennent au niveau de multiples interfaces terrestre-aquatique. Si on sait par exemple que l’océan côtier représente un puits de carbone incontestable grâce à sa production primaire phytoplanctonique, les estuaires émettent, quant à eux, d’importantes quantités de CO2 vers l’atmosphère du fait de l’intense minéralisation de la matière organique qui existe dans ces eaux turbides, c’est-à-dire troubles, limitant la photosynthèse. Entre ces écosystèmes, se trouvent les marais et les vasières intertidales1. Là, de multiples échanges horizontaux et verticaux de carbone existent au sein et entre les compartiments terrestre, aquatique et atmosphérique aux échelles du jour et de la nuit, de la marée, de la saison et de l’année. Ces échanges particulièrement complexes et dynamiques ne peuvent alors être appréhendés que de façon intégrative et multidisciplinaire en faisant appel à des équipes de géographes, de géologues ou d’écologues pour mieux préciser leurs statuts de puits ou source de carbone.
Incontestablement si les débats portent sur la qualification des processus et la quantification des échanges, ils ne retirent rien aux services écosystémiques que nous retirons de cette biodiversité. Si son érosion se poursuit, la capacité à capturer efficacement le carbone de l’atmosphère pourrait être compromise, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre et d’intensifier l’acidification des eaux côtières. Malheureusement, ces écosystèmes ne sont pas épargnés par le changement d’usage des terres. D’après les chiffres de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on sait par exemple que chaque année, près de 2 % des mangroves disparaissent et contribuent au relâchement de 120 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Depuis les années 1990, les surfaces des herbiers marins ont diminué de moitié à travers le monde. Ceci est à la fois dû à des pressions anthropiques, mais aussi à une pression de parasitisme. Pour protéger ces zones, un certain nombre d’actions ont été mises en place, comme aux États-Unis sur la côte de Virginie où se trouve le site de South Bay choisi pour faire partie d’un vaste projet de restauration des herbiers initié au début des années 2000. À partir d’un simple vestige découvert dans une baie en bord de mer au large de la côte est, The Nature Conservancy et le Virginia Institute for Marine Science ont diffusé plus de 72 millions de graines pour aider à accélérer la propagation naturelle de la zostère (Zostera marina), qui couvre aujourd’hui 13,5 km2. Une étude publiée dans Plos One a montré que ces prairies sous-marines restaurées devraient accumuler du carbone à un taux comparable à celui mesuré dans les prairies sous-marines naturelles. C’est extrêmement encourageant.
par Thierry Thibaut, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanographie (MIO), Marseille. Travaillant sur le projet Marfor de Biodiversa.
« Si les forêts marines d’algues (kelps) ne jouent pas un rôle direct dans l’atténuation du changement climatique, elles y contribuent largement en permettant à la biodiversité côtière de se maintenir. Comme les forêts terrestres, elles abritent un très grand nombre d’espèces. Les forêts sous-marines de Kelps géants, par exemple en Californie, font plus de 40 mètres de haut et sont considérées comme le plus haut niveau trophique du monde avec ses sept à huit niveaux. Lors de perturbations d’origine naturelle ou antropique , plus la biodiversité est importante, plus l’écosystème a la possibilité de se régénérer. De même, lorsque l’écosystème est peu diversifié, les chances de le voir se reconstituer sont faibles. Ainsi assiste-t-on dans certaines zones abimées à des dénudements presque totaux, à cause d’herbivores comme les oursins qui y prolifèrent. Les forêts marines maintiennent donc de haut niveau de services écosystémiques, dont l’atténuation du changement climatique, en contribuant à préserver les écosystèmes côtiers qui sont pour certains des puits de carbone (herbiers de plantes à fleurs marines). C’est entre autres pour cela qu’il faut les préserver à un moment où on assiste à des déclins dans toutes les mers et tous les océans de ces écosystèmes côtiers, notamment en raison de la destruction irrémédiable des habitats due à la construction de ports, de marinas, parkings, mais aussi au surpâturage des herbivores et à une augmentation des températures. »
_______________
1 Zone au-dessus du niveau de l’eau à marée basse et sous l’eau à marée haute en d’autres termes, des vasières se situant dans le secteur des marées.

Les paysans africains pourront bientôt lutter tout à la fois contre les causes et contre les conséquences du changement climatique avec leur production de céréales. « Une solution très pragmatique pour contrer l’effet de serre, formulée en objectif chiffré dans l’initiative “4 pour 1000” [voir encadré ci-dessous], consiste à piéger une partie du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique dans la matière organique des sols , explique le pédologue Vincent Chaplot. Pour ce faire, les plantes cultivées qui emmagasinent de grandes quantités de carbone dans leurs parties non-récoltées sont de très bons outils. Avec une équipe de l’université du Kwazulu-Natal (Afrique du Sud), nous étudions en ce sens les espèces communes de blé exploitées en Afrique. Il s’agit de caractériser celles qui stockent le mieux le carbone malgré les conditions de stress hydrique justement induites par le changement climatique. »

De l’échantillon moléculaire au balayage satellite, les spécialistes du milieu marin déploient un arsenal multi-échelles pour observer et caractériser mers et océans. Avec l’aide des populations et usagers de la mer, ils scrutent en permanence ces étendues salées qui couvrent les deux tiers de la planète. Les données qui en résultent bénéficient à la compréhension et la gestion de nombreuses questions : variation du climat, fonctionnement des écosystèmes, préservation de la biodiversité, gestion des ressources vivantes, lutte contre les facteurs de dégradation…

Mieux identifier les espèces de poissons pour optimiser la gestion des ressources et mieux comprendre leur écologie. Tels sont deux des enjeux du barcoding ADN, l’analyse de fragments ADN permettant de déterminer l’espèce à laquelle appartient un individu. A l’aide de cette approche, une équipe de scientifiques menée par l’IRD vient de produire un nouveau jeu de données de barcodes des poissons récifaux de Nouvelle-Calédonie, complétant une base de données commune aux océans Indien et Pacifique. Ils ont identifié 805 espèces sur trois sites différents : Île de La Réunion et Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française.

Cette solution repose sur un principe simple : les animaux se déplacent depuis leur site de reproduction jusqu’aux zones où ils trouvent de la nourriture. Ainsi, en identifiant les zones de l’océan Austral où les prédateurs se rendent le plus souvent, on peut en déduire où se trouvent leurs proies. Par exemple, les baleines à bosse se déplacent dans des endroits où elles peuvent avoir accès au krill, tandis que les éléphants de mer et les albatros se déplacent dans des endroits où ils peuvent trouver poissons, calmars ou autres proies. Si tous ces prédateurs et leurs diverses proies se trouvent en un même endroit, alors cette zone présente à la fois une grande biodiversité et une grande abondance d’espèces, ce qui en fait une zone de grande importance écologique.
Ce projet a été mené par le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), avec le soutien de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans son centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab) au travers du projet RAATD, et du WWF-UK. Le SCAR a fait appel à son vaste réseau de chercheurs travaillant sur l’Antarctique pour rassembler les données existantes sur le suivi des prédateurs de l’océan Austral. Une énorme base de données, en accès libre, a ainsi été créée avec les suivis de plus de 4 000 individus de 17 espèces différentes, recueillis par plus de 70 scientifiques dans le cadre de 12 programmes en Antarctique.
Cependant, il est impossible de suivre toutes les espèces à partir de tous leurs sites de reproduction : une simple carte fournirait donc une représentation biaisée de la distribution des animaux. Pour surmonter ce problème, des modèles statistiques sophistiqués ont été développés afin d’estimer les mouvements en mer des différentes espèces de prédateur, depuis leurs sites de reproduction. Ces estimations, combinées aux données obtenues sur les 17 espèces suivies, ont permis d’élaborer des cartes représentant les zones utilisées par un ensemble de prédateurs ayant des besoins en proies variés (cf. ci-dessous).
Ces zones d’importance écologique sont en partie couvertes par les aires marines protégées (AMP) existantes (créées dans un but de conservation), ce qui laisse à penser qu’elles sont actuellement aux bons endroits. Pourtant, si on s’intéresse à la façon dont ces zones d’importance écologique sont susceptibles de se déplacer d’ici 2100, d’après les projections des modèles climatiques du GIEC, ces mêmes zones ne se retrouvent plus couvertes par les aires marines protégées. Il est donc nécessaire de commencer à envisager des aires marines protégées dynamiques qui seraient mises à jour au fil du temps en fonction des changements environnementaux, afin d’assurer une protection continue dans le temps et dans l’espace de l’océan Austral et de ses ressources.
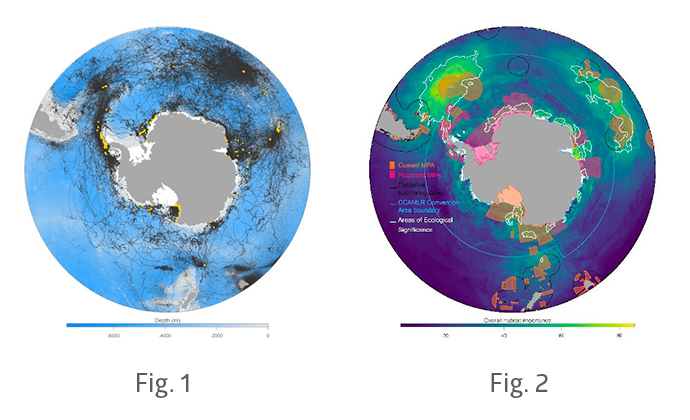
Fig. 1 : Carte de l’océan Austral montrant les données de suivi des mouvements (points noirs) de 4060 individus de 17 espèces de prédateurs marins qui ont été utilisées pour prévoir les zones d’importance écologique. Les points jaunes indiquent les endroits où chaque piste a commencé, autrement dit les sites de reproduction des individus.
Fig. 2 : Carte de l’océan Austral montrant les habitats d’importance écologique définies à l’aide des données de suivi de 17 espèces de prédateurs marins. Les zones présentant les valeurs les plus élevées en termes d’importance écologique sont entourées en blanc, dont deux zones hauturières : une au niveau de la péninsule Antarctique et se projetant sur l’arc de Scott, et l’autre entourant les îles subantarctiques dans le secteur indien de l’Océan Austral. Elles sont mises en rapport avec les aires marines protégées (AMPs) actuelles (en orange) et proposées (en magenta). Sont également indiquées, en noir, les limites des eaux nationales (ou zones économiques exclusives) et la limite de la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique).

Une étude parue dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment indique que seule 1,4 % de cette surface est en réalité intégralement protégée, alors que les aires intégralement protégées sont considérées comme les moyens de protection les plus efficaces. Selon Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS, et coauteur de l’article, « on constate à la fois dans la littérature scientifique et sur le terrain que non seulement les aires marines intégralement protégés sont minoritaires, mais qu’en plus, sur toutes celles qui existent, une infime minorité fonctionne. » Pour le chercheur, l’explication est simple : « les aires protégées qu’elles soient marines ou terrestres sont aujourd’hui trop souvent conçues uniquement sur des pré-requis écologiques, alors qu’elles devraient être pensées également en termes socio-écologiques. » Autrement dit pour protéger la biodiversité, il faudrait avant tout comprendre comment les hommes interagissent avec elle pour trouver les meilleures solutions de préservation. Fort de cette intuition, le chercheur et son équipe ont développé une méthode socio-écologique pour identifier les outils de gestion (dont les aires protégées) les plus à même d’être efficaces.
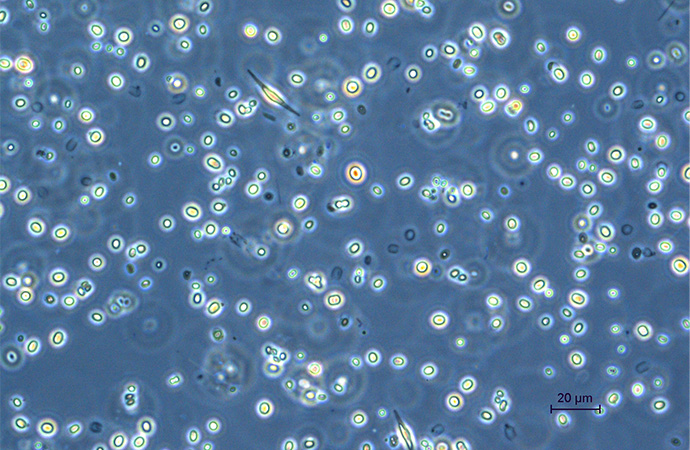
En pratique, l’aquaculture multi-trophique intégrée consiste à inclure dans les écosystèmes aquacoles des organismes de niveaux trophiques inférieurs, comme de petits invertébrés, capables d’ingérer les rejets organiques, sources de pollution environnementale : « Les effluents d’élevage génèrent des nutriments (carbone, azote et phosphore). Ils peuvent, dans certains cas, s’accumuler dans le milieu et engendrer une réduction de la disponibilité en oxygène néfaste pour les espèces benthiques présentes à proximité. » poursuit la chercheuse. À l’heure où la demande mondiale de produits aquatiques est passée de 9,9 kg par habitant et par an à 18,6 kg en moins d’un demi-siècle, parvenir à un modèle durable devient un enjeu majeur pour le secteur aquacole « d’autant que cet accroissement n’est pas assuré par les pêcheries traditionnelles mais par l’aquaculture » poursuit Myriam Callier.
Afin de limiter les impacts sur l’environnement, l’Ifremer et dix autres instituts de recherche européens ont mené le projet IMTA-Effect. Leur objectif : évaluer les différents systèmes d’intégration des systèmes d’aquaculture multi-trophique intégrée dans des pays aussi différents que la France, le Portugal, la Roumanie et la Grèce. « Nous avons cherché à comprendre comment optimiser la chaine trophique entre le poisson, les microalgues, les mollusques et les détritivores, poursuit Myriam Callier. Nous avons travaillé sur chaque espèce pour bien comprendre sa biologie et son rôle dans les écosystèmes piscicoles. » Le choix de l’espèce extractive à intégrer est évidemment fonction du service de bioremédiation recherché.
Le projet IMTA-Effect s’est notamment concentré sur un ver polychète marin (Hediste diversicolor), détritivore, qui se nourrit des excréments des poissons. « On connait sa biologie, précise la chercheuse. Il vit dans des milieux naturellement riches en matière organique, tolère de faible concentration en oxygène et de fortes variations de température. Il a l’avantage de pouvoir aussi être valorisé comme appât de pêche. Son élevage en aquaculture multi-trophique intégrée pourrait permettre de diminuer son exploitation, car il est lui-même péché dans le milieu naturel. » Par ailleurs, son étude, à la fois réalisée en laboratoire et en milieu contrôlé, a permis de comprendre dans différentes conditions environnementales sa capacité de bioremédiation. « Nous sommes désormais en mesure de dire exactement combien de rejets de poisson le polychète marin peut ingérer au mètre carré. »
La difficulté est que chaque système d’élevage est spécifique. Répondre aux besoins de chaque espèce, surveiller les températures, les changements de saisons sont autant de facteurs à prendre en compte pour harmoniser les écosystèmes. Dans sa forme la plus complexe, un système en aquaculture multi-trophique intégrée peut comprendre jusqu’à quatre compartiments extractifs à équilibrer : les espèces autotrophes (macro et microalgues), les filtreurs (ex. bivalves), les détritivores (ex. polychètes, concombre de mer et autres invertébrés benthiques) et les bactéries. « Les résultats de ces études permettent de paramétrer des modèles qui serviront par la suite à prédire la capacité de bioremédiation de chaque maillon trophique et de tester différents scénarios, comme l’effet d’un changement de température » souligne la chercheuse.
À une échelle plus fine, le chercheur de l’Ifremer Cyrille Przybyla s’est lui intéressé au compartiment des microalgues qui ont pour particularité de purifier l’eau des bassins, mais aussi d’être potentiellement des aliments pour les poissons. Un enjeu majeur lorsque l’on sait que l’aquaculture impacte les stocks de petits poissons sauvages pêchés. Réduits en farine et en huile, ils sont utilisés pour nourrir principalement les poissons des fermes et plus largement certains animaux d’élevages ou domestiques. Pour alléger les pressions sur cette biodiversité marine, de très nombreux instituts de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course pour sélectionner l’algue qui serait en mesure de devenir une source d’alimentation alternative pour le poisson d’élevage. « Notre démarche dans le projet MARINALGAE4Aqua, est tout autre, précise Cyrille Przybyla. Nous avons décidé de laisser faire la nature, en favorisant une polyculture algale naturelle. ». Pour cela, les effluents sont laissés en bassin ouvert permettant à la nature de mettre sa diversité locale au service de l’épuration de l’eau d’élevage et de la nutrition en aquaculture. « Ce n’est pas une seule algue qui vient se développer sur les effluents, mais toute une prairie de microalgues dont la diversité change en fonction des saisons. » Ces microalgues ont néanmoins des valeurs protéiques et lipidiques bien réelles. Cyrille Przybyla et son équipe sont arrivés à récolter 5kg de farine sèche, fertilisée par les effluents sortant des bassins d’aquaculture, qu’ils ont réussi à réinjecter dans l’alimentation du poisson « On a substitué 20% des farines et huiles de poissons dans la composition de l’alimentation des élevages. On est parvenu à améliorer la durabilité de l’aliment en se basant sur le principe de l’aquaculture multi-trophique intégrée, sans qu’il y ait de conséquence sur la croissance et le bien-être des poissons. » L’aquaculture multi-trophique intégrée peut donc se décliner sur le modèle des poupées russes et permettre à la filière aquacole d’opérer sa transition environnementale pour devenir la grande source d’alimentation durable qui participera de façon substantielle à nourrir de 8,5 milliards d’humains en 2030.
_______________
Auteur : Julie de Bouville
Relecteurs : Myriam Callier, Cyrille Przybyla, Hélène Soubelet, Jean-François Silvain, Pauline Coulomb

L’équipe, composée de 39 scientifiques de 20 pays différents, a réalisé un travail de synthèse conséquent au travers du projet Geisha, co-financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), dans son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), et par le centre d’analyse et de synthèse John Wesley Powell de l’U.S. Geological Survey. Elle s’est intéressée aux effets des tempêtes sur les lacs, et particulièrement sur le phytoplancton : algues microscopiques, à la base des chaînes alimentaires et un des facteurs régulant la qualité de l’eau. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Global Change Biology le 5 mars 2020.
Il est aujourd’hui avéré que les phénomènes météorologiques extrêmes endommagent les biens, les infrastructures et impactent l’environnement, y compris les ressources en eau douce qui sont essentielles à la santé humaine. Les lacs sont ainsi particulièrement vulnérables : ils subissent de manière directe les tempêtes puis reçoivent les eaux de ruissellement de l’ensemble de leurs bassins versants, qui arrivent alors chargées de sédiments, de nutriments, de microplastiques, et bien plus encore.
“Nous avons une idée assez claire de la façon dont les lacs réagissent physiquement aux tempêtes : la colonne d’eau se mélange, la température de l’eau change et les sédiments peuvent être remontés du fond ou apportés par les rivières et les ruisseaux rendant ainsi le lac plus turbide”, raconte Jason Stockwell, auteur principal de la publication et co-porteur du projet Geisha. “Mais la réponse physique du lac n’est qu’une partie de l’histoire. Les conséquences biologiques des tempêtes sur le phytoplancton, mais aussi sur d’autres plantes et animaux, sont fondamentales dans la dynamique des lacs et pourtant, comme le révèle notre étude, elles sont encore mal comprises”.

Fig. L’impact des tempêtes sur les lacs varie en fonction des caractéristiques géographiques et morphologiques du lac, de ses conditions physico-chimiques et des propriétés de son bassin versant. Ces facteurs agissent comme des filtres qui tamponnent ou intensifient les effets des tempêtes. La réponse du phytoplancton (plantes microscopiques à la base du réseau trophique) à une tempête a des conséquences importantes pour les autres composantes du réseau trophique et les services écosystémiques rendus par le lac. © Gaël Dur
En analysant des milliers d’articles scientifiques du monde entier, les chercheurs n’ont trouvé que très peu d’études sur les effets des tempêtes sur les lacs, encore moins sur le phytoplancton, et les quelques résultats disponibles étaient contradictoires. Comment le phytoplancton réagit face aux tempêtes ? En quoi ses réactions peuvent différer selon les types de tempêtes, selon les lacs ou même selon les périodes de l’année ? “Si les phénomènes météorologiques extrêmes modifient de manière significative le cycle du carbone, des nutriments ou de l’énergie dans les lacs, nous ferions mieux de le découvrir rapidement”, avertit Jason Stockwell. Les scientifiques appellent donc à un effort de collaboration pluridisciplinaire de la part des chercheurs pour développer et faire progresser la recherche sur ces questions. Ils suggèrent notamment l’utilisation de modèles et l’extension de programmes de surveillance à long terme des lacs par le biais de réseaux tels que le Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON, https://gleon.org).
Références de l’article :
Stockwell, J., J.P. Doubek, R. Adrian, O. Anneville, C.C. Carey, L. Carvalho, L. de Senerpont Domis, G. Dur, M. Frassl, H.-P. Grossart, B. Ibelings, M. Lajeunesse, A. Lewandowska, M. Llames, S.S. Matsuzaki, E. Nodine, P. Noges, V. Patil, F. Pomati, K. Rinke, L. Rudstam, J. Rusak, N. Salmaso, C. Seltmann, D. Straile, S. Thackeray, W. Thiery, P. Urrutia-Cordero, P. Venail, P. Verburg, R. Woolway, T. Zohary, M. Andersen, R. Bhattacharya, J. Hejzlar, N. Janatian Ghadikolaei, T. Kpodonu, T. Williamson, and H. Wilson. Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes. Global Change Biology. DOI: 10.1111/gcb.15033

Connaître et comprendre pour mieux préserver… en s’inscrivant dans l’adage, le Conseil scientifique de la FRB partage avec vous sa bibliothèque idéale, sa vidéothèque éclectique et choisie.
Les références, accessibles et portées par des spécialistes de leurs domaines, ouvrent la porte aux principaux concepts de l’écologie et de ses différentes disciplines. Elles permettent aussi de tendre l’oreille vers les débats contemporains en ayant des clés de compréhension et d’appréhension critique. Dans certains cas, elles lèvent le voile sur le métier de chercheur !
Que vous vous intéressiez à la biodiversité, découvriez l’écologie scientifique ou souhaitiez approfondir vos connaissances ; que vous disposiez de deux minutes ou d’une année : il y a forcément les références qui vous conviennent !

Le séquençage du virus de Wuhan suggère que ce dernier est proche de coronavirus que l’on trouve chez les chauves-souris même si d’autres mammifères peuvent transmettre ce type de virus, comme cela a été le cas avec le SRAS, dont des formes proches ont été retrouvées chez des chauves-souris Rhinolophes, mais qui aurait probablement été transmis à l’Homme par des civettes vendues sur les marchés de la province de Guangdong (Cyranoski, 2017). Une étude controversée (Ji et al., 2020) suggère aussi qu’un serpent pourrait être à l’origine du virus de Wuhan. Mais la communauté scientifique a exprimé son scepticisme, considérant que les betacoronavirus, groupe auquel appartient le virus du SRAS et le virus de Wuhan, ne sont trouvés que chez les mammifères. Plus récemment le rôle des pangolins comme hôte intermédiaire du virus a été mis en avant, mais là encore la communauté scientifique est en attente d’une publication (Cyranoski, 2020). L’hypothèse la plus probable est donc que le virus de Wuhan provient initialement d’une chauve-souris.
Ce constat n’est probablement pas étonnant car ce groupe de mammifères s’avère constituer un réservoir assez extraordinaire de virus susceptibles de se transmettre à l’Homme. Il suffit de regarder la littérature récente sur les zoonoses (maladies transmises par les animaux aux Hommes) pour s’en convaincre. Des chauves-souris sont notamment à l’origine du virus d’Ebola (Buceta & Johnson, 2017) et de Marburg (Kurth et al., 2012), d’une large diversité de Coronavirus en Afrique et Asie (Tao et al., 2017 ; Lacroix et al., 2017) ; elles peuvent transmettre le virus de la rage (Alegria-Moran et al., 2017) et d’autres lyssavirus (Nokireki et al., 2017), le virus Hendra fatal pour les chevaux et les humains en Australie (Smith et al. 2014), etc. En Europe, des chauves-souris sont des réservoirs d’adénovirus (Rossetto et al., 2020), de paramyxovirus (la famille qui inclut les virus Hendra et Nipah) (Kurth et al., 2012) et de lyssavirus (Schatz et al., 2014 ; Nokireki et al.,2017, Šimić et al., 2018). Alors qu’il existe deux fois moins d’espèces de chauves-souris que de rongeurs, on identifie pratiquement autant de virus chez les premières que chez les derniers, un même virus pouvant infecter en moyenne deux fois plus d’espèces de chauves-souris que de rongeurs (Luis et al., 2013). Comme cela a été montré récemment par Rossetto et al. (2020) dans le cas des adénovirus, il existe des différences importantes entre les espèces pour ce qui est de la prévalence des virus, certaines s’avérant négatives alors que chez d’autres jusqu’à 40 % des individus peuvent être positifs.
Alors pourquoi une telle situation, qui remet au premier plan le vieil antagonisme entre les humains et les chauves-souris à l’exemple de la première page récente du quotidien 20 minutes associant l’image d’une chauve-souris frugivore avec les mots « sauvage » et « virus » ?

Au début des années 1980, Rudolph Bühler, un jeune ingénieur agronome allemand, rentre au pays reprendre la ferme familiale après quelques années passées en Asie à travailler dans l’humanitaire. Pleins d’idéaux et d’envies, le jeune Bühler se lance dans l’agriculture paysanne pour explorer des pistes alternatives à l’industrie agroalimentaire qui promet des profits élevés avec des races importées jugées plus productives. Ainsi sur le territoire de Hohenlohe, les producteurs de porcs élèvent depuis quelques temps un cochon venant de Hollande jugé plus productif que les races locales car produisant plus de viande mais néanmoins mal adapté à son environnement, car souvent malade et traité aux antibiotiques.
Convaincu par ses années passées sur le terrain que les variétés locales supportent bien mieux la nourriture et le climat régional que les animaux importés, Rudolph Bühler s’allie à d’autres agriculteurs pour sauver de l’extinction une ancienne race porcine locale – issue d’un croisement entre le cochon chinois Meishan importé au 19e siècle – et une race allemande. Bien vite leur petite production se développe. Les journaux locaux titrent « Une viande de porc qui a du goût ! ».
Fort de leur succès, les agriculteurs vont plus loin et établissent un système de tarification communautaire : les prix de la viande et les montants de production sont fixés en commun. Mais les coûts de production des porcs souabes sont environ 12 % plus élevés que pour les autres races dîtes « industrielles ». Au lieu de devenir un fardeau économique pour les éleveurs ceux-ci redistribuent une partie de leur bénéfice au réseau comme un soutien financier. Ces mesures garantissent ainsi un revenu stable et une juste part des bénéfices, tout en permettant une stabilité dans le processus de production.
Pour le chercheur en science politique Brendan Coolsaet, qui porte le projet JustConservation du Cesab de la FRB, ce cas est devenu un sujet d’étude.
« Ce qui m’a intéressé chez les éleveurs allemands de Hohenlohe, c’est qu’il s’agissait d’un cas européen qui différait radicalement du système dominant, autant dans sa dimension agricole que dans sa dimension politique. » Pour le chercheur, prendre en compte ce type d’alternative permet d’apporter des solutions en matière de conservation de la biodiversité. « Je me suis inspiré des travaux sur la justice sociale et environnementale pour étudier le combat de ces éleveurs pour la conservation du porc Souabe. Je me suis particulièrement intéressé au concept de la « reconnaissance », qui je pense est clé pour tenter de comprendre les nouveaux mouvements sociaux pour l’environnement en général, et pour la conservation de la biodiversité en particulier. En effet, reconnaître et respecter la différence ce n’est pas seulement une question éthique ou morale, la recherche montre comment la reconnaissance des différences culturelles dans le contexte de la conservation permet d’apporter des solutions alternatives utiles, voir même vitales. » La conservation de la biodiversité agricole est à ce titre un bon exemple.
Elle nécessite des connaissances agronomiques propres au milieu, que les agriculteurs ont progressivement perdues avec la modernisation. « L’agriculture industrielle a standardisé et centralisé les connaissances et les pratiques agricoles à travers le monde, et a conduit à un déclin massif de la biodiversité agricole, » poursuit Brendan Coolsaet. Reconnaître d’autres pratiques permet l’émergence d’alternatives, qui dans le cas du cochon Souabe sont à la fois respectueuses de l’environnement, du bien-être animal et des communautés rurales.
Afin de faire reconnaître leurs pratiques, les éleveurs allemands de Hohenlohe se sont employés à créer des espaces d’apprentissage collaboratifs autogérés et à s’associer à des universités allemandes pour lancer un projet commun dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 de l’Union européenne, en étudiant les liens entre les aliments traditionnels comme l’herbe et l’amélioration de la qualité de la viande par exemple. Rudolf Bühler ne s’est pas arrêté là.
Cet été, invité par l’ONU au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, l’éleveur a appelé à ce que les objectifs de développement durable (ODD) soient mis en œuvre au niveau local et d’ajouter que le passage à l’agriculture biologique et la gestion naturelle ne suffisait pas : « l’agriculture doit aller de pair avec une économie solidaire axée sur le bien-être animal et la justice sociale, en particulier sur la scène internationale. »
En attendant, le porc Souabe fait des petits. Aujourd’hui, près de 1 500 fermes en Allemagne élèvent ce vieux cochon sauvé de l’extinction.

Il y a deux ans, une trentaine de chercheurs nationaux et internationaux rendaient public Rainbio une base de données unique en libre accès, offrant le premier état des lieux jamais réalisé sur la flore d’Afrique tropicale. Cette synthèse d’envergure a été réalisée au Cesab de la FRB, un centre de synthèse unique en France permettant de rassembler de très nombreuses informations dépassant les simples jeux de données collectés lors de travaux individuels.
Grâce au Cesab, mis en place il y a 10 ans par la FRB, l’équipe de recherche menée par Thomas Couvreur – chercheur à l’IRD – a pu enregistrer plus de 600 000 occurrences végétales en Afrique tropicale, provenant de plus de 25 000 espèces de plantes vasculaires.
Ce mois-ci, trois études s’appuyant de façon directe ou indirecte sur la base de données Rainbio ont dévoilé des résultats sans précédent sur l’état et le devenir de la flore africaine ainsi que sur les espèces rares à l’échelle mondiale.
Pour la première fois à l’échelle planétaire, une étude parue le 27 novembre dans la revue Science Advances a pu déterminer que 36,5 % des 435 000 espèces végétales de la Terre sont à considérer comme extrêmement rares. Ces résultats sont basés sur BIEN, une immense base de données ayant intégré Rainbio. Les scientifiques ont localisé les régions qui les abritent et conclu qu’elles se situent majoritairement dans des régions climatiques stables. Or les événements extrêmes provoqués par le changement climatique risquent de bouleverser ces climats et avoir un impact majeur sur les espèces rares. D’après les prévisions, les Andes méridionales et l’Asie du Sud-Est devraient enregistrer les plus fortes baisses. Le changement d’usage des terres fait aussi partie des grandes menaces. Si rien n’est fait pour préserver la flore rare planétaire dans les années à venir, c’est environ 158 000 espèces de plantes qui sont menacées d’extinction.
Enquist, B.J., Feng, X., Boyle, B., Maitner, B., Newman, E.A., Jørgensen, P.M., Roehrdanz, P.R., Theirs, B.M., Burger, J.R., Corlett, R. and Donoghue, J.C., 2019. The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants. Science Advances, 5(11). DOI: 10.1126/sciadv.aaz0414
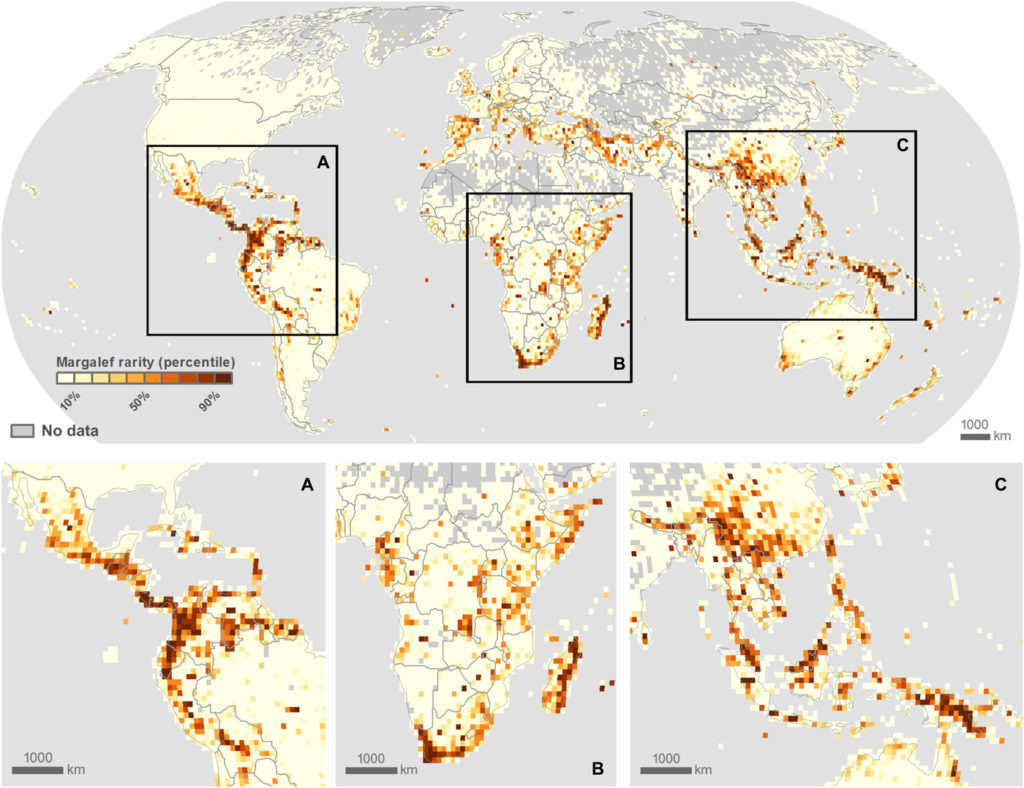
Le 20 novembre dernier sortait la première évaluation du statut de conservation préliminaire réalisée de la flore tropicale africaine. L’article a révélé que près d’un tiers – 31,7 % – de cette flore pourrait être menacé d’extinction. En superposant les cartes de distribution des espèces et celles de l’utilisation des terres – des plus préservés aux plus exploitées – réalisées à partir de la base de données Rainbio, les chercheurs sont parvenus pour la première fois, à évaluer le statut de conservation potentiel de la flore tropicale à l’échelle du continent. « Cette étude constitue la première évaluation du statut de conservation potentiel de la flore à une échelle continentale, suivant la méthodologie de l’UICN », souligne Thomas Couvreur, botaniste à l’IRD qui a coordonné l’étude. « Ces évaluations pourraient fournir des informations cruciales pour améliorer la gestion de la biodiversité et favoriser un développement économique durable en Afrique. »
Stévart, T., Dauby, G., Lowry, P.P., Blach-Overgaard, A., Droissart, V., Harris, D.J., Mackinder, B.A., Schatz, G.E., Sonké, B., Sosef, M.S.M. and Svenning, J.C., 2019. A third of the tropical African flora is potentially threatened with extinction. Science Advances, 5(11). DOI: 10.1126/sciadv.aax9444
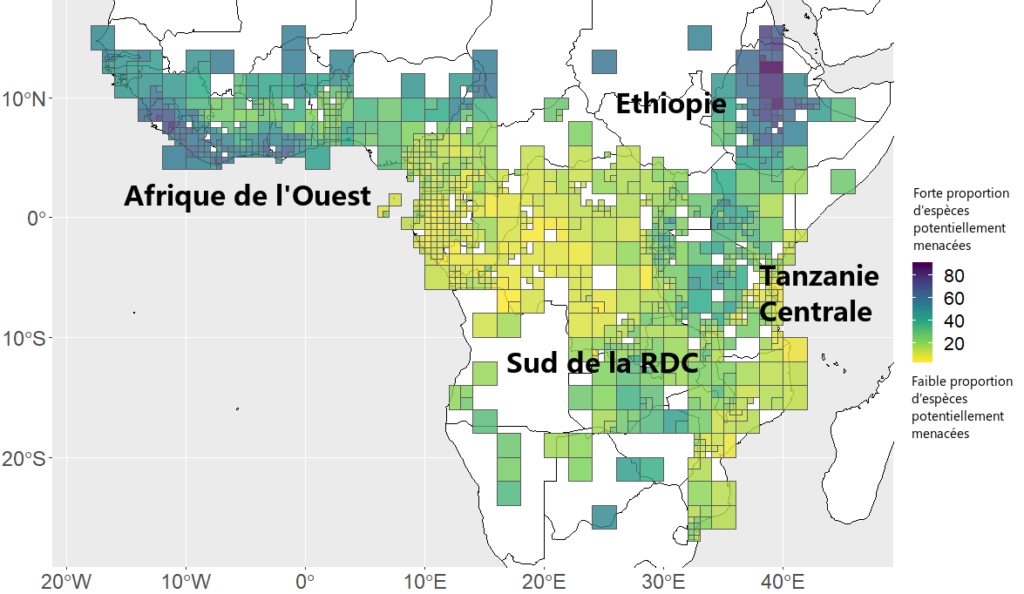
Dans l’étude parue dans la revue New phytologist le 30 octobre dernier, les scientifiques ont pu déterminer où les plantes d’Afrique tropicale se diversifient et persistent au cours du temps en s’appuyant sur la base de données Rainbio. Leur étude souligne le rôle vital joué par les montagnes agissant simultanément comme berceaux et lieux de persistance de la biodiversité végétale tropicale africaine. En revanche, les forêts tropicales des basses terres de l’Afrique de l’Ouest et Centrale servent principalement de musées, pour la diversité générique (i.e. régions où les genres persistent au cours du temps). Ces résultats permettent de comprendre la répartition de la biodiversité et les stratégies de conservation au niveau de la région.
Dagallier, L.P.M., Janssens, S.B., Dauby, G., Blach‐Overgaard, A., Mackinder, B.A., Droissart, V., Svenning, J.C., Sosef, M.S., Stévart, T., Harris, D.J. and Sonké, B., 2019. Cradles and museums of generic plant diversity across tropical Africa. New Phytologist. DOI: 10.1111/nph.16293
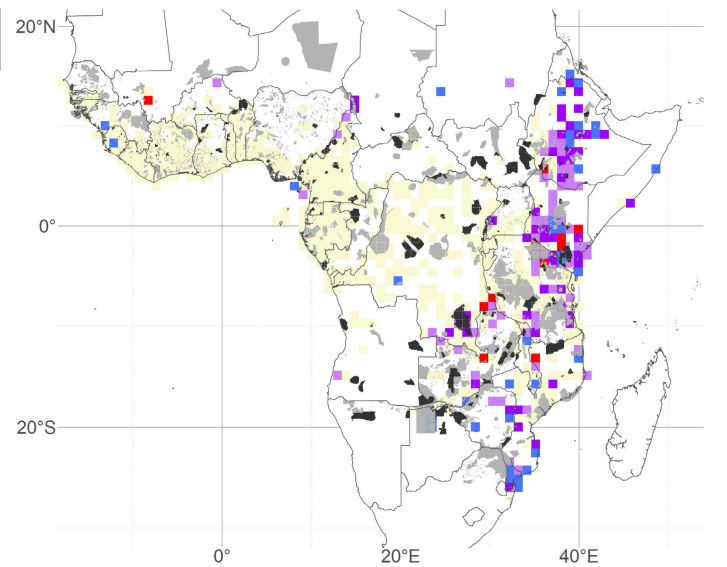

Les zones côtières du monde sont de plus en plus soumises à des pressions humaines nécessitant une gestion adaptée et stratégique. L’établissement d’aires marines protégées (AMP) est un outil couramment utilisé pour améliorer la conservation, la sécurité alimentaire et la gestion des pêches. L’étude des conséquences écologiques des aires intégralement protégées (c’est-à-dire des zones sans prélèvement) révèle que l’abondance et la taille des espèces exploitées sont généralement accrues et ce, même au-delà des zones protégées dans certains cas, grâce à un effet de débordement. Par ailleurs, ces aires intégralement protégées permettent le rétablissement des populations et des communautés de poissons et d’autres taxons marins assurant ainsi la préservation de la structure de l’habitat.
La mise en place de zones intégralement protégées a souvent entraîné des conflits entre les enjeux de conservation de la biodiversité et les objectifs socio-économiques, en particulier dans les zones exploitées par de nombreux utilisateurs et soumises à différents types d’usages. Ainsi, l’établissement d’aires partiellement protégées, dans lesquelles certaines activités extractives peuvent être autorisées, est devenue une option favorisée par de nombreux décideurs, car plus facile à mettre en place au vu des objectifs à la fois socio-économiques et écologiques affichés. À la suite des accords et engagements internationaux, de plus en plus d’aires marines protégées sont en cours de création, mais la plupart ne sont que partiellement protégées. Il est donc urgent de déterminer quelles formes de protection partielle peuvent apporter des avantages socio-économiques tout en conservant une pertinence en termes de protection de la biodiversité.
Les aires partiellement protégées dépendent du contexte et leurs réglementations varient en fonction des objectifs de gestion qui vont, à leur tour, affecter leur efficacité écologique.
Un nouveau système de classification des aires protégées en fonction des activités commerciales et récréatives autorisées a été récemment développé (Horta e Costa et al., 2016). Dans ce système, les aires protégées, partielles et intégrales, sont classées en fonction des impacts cumulés des activités autorisées. Il est donc essentiel de comprendre les conséquences écologiques des différents types de protection partielle, celles-ci étant très certainement liées à différents régimes de réglementation. Dans cet article, les chercheurs présentent une nouvelle approche pour étudier et déduire comment une diversité de niveaux de protection partielle peut entraîner différents niveaux d’efficacité écologique. Ils ont également examiné comment les caractéristiques des aires protégées (âge et taille) peuvent influer sur l’efficacité des zones partiellement protégées, ou comment les caractéristiques spécifiques aux aires protégées multi-zones, telles que la présence d’une zone intégralement protégée adjacente, peuvent influer sur l’efficacité de la protection partielle.

Les données archéologiques montrent que les changements anthropiques ont commencé plus tôt et se sont répandus plus vite qu’estimé précédemment.
___
L’Anthropocène est la période au cours de laquelle les activités humaines ont acquis une influence majeure sur le changement climatique et l’environnement. Il est difficile d’estimer le début de cette ère, et en particulier d’estimer l’incidence de l’Homme avant la période historique et les écrits associés. L’hypothèse avait déjà été formulée que la déforestation préhistorique et la riziculture pourraient expliquer l’augmentation préindustrielle des concentrations de méthane et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère il y a environ 7 000 ans. Pour le dernier millénaire, les chercheurs se basent sur des documents historiques et, pour la période précédente, sur les observations archéologiques et paléo-écologiques. Les données archéologiques sont d’une grande importance mais jusqu’à récemment il était difficile d’en retirer des tendances globales.
Les travaux de Stephens et al. rapportés ci-dessous suggèrent que la Terre avait déjà été considérablement transformée par les activités humaines il y a 3 000 ans. Ce jalon temporel pour les changements d’origine anthropique de la couverture terrestre est en accord avec les interprétations issues de l’analyse de plusieurs autres sources de données (par exemple, les reconstructions des pertes de forêts en Europe tempérée) et conforte largement l’hypothèse de Ruddiman et al. en 2016 qui voyaient une origine anthropogénique dans le réchauffement préindustriel de l’Holocène tardif.
A contrario, l’utilisation de la base de données historique sur l’environnement mondial (HYDE, Klein Goldewijk et al., 2017), qui simule la couverture terrestre mondiale passée, abouti à des conclusions en contradiction avec celles de Stephens et al. en mettant en avant un faible volume d’impacts anthropiques à l’époque préhistorique.
Ces différences dans les conclusions des deux types d’études peuvent être dues aux biais associés aux données archéologiques qui proviennent d’endroits habités par l’Homme et ne renseignent pas directement sur l’état des zones sauvages. Les enseignements issus notamment de données paléo-écologiques (pollens) devraient conduire à d’utiles comparaisons de dates.
Enfin, si de grandes régions ayant eu une longue histoire d’agriculture et de pastoralisme (Europe et Chine par exemple) au cours des six derniers millénaires devraient montrer des trajectoires globales similaires pour le changement de couverture du sol, quelle que soit la source de données utilisée, ce n’est pas le cas pour beaucoup d’autres régions. En Europe tempérée et dans le nord-est de la Chine, le modèle HYDE indique une augmentation exponentielle des terres agricoles et des pâturages il y a environ 1 000 ans alors que les résultats ArchaeoGLOBE pour ces régions font apparaître une importante conversion de terres d’origine humaine il y a 3 000 ans. Quant aux analyses polliniques, qui permettent une estimation des terres libres de toute empreinte, elles établissent plutôt cette augmentation entre 1 000 et 3 000 ans. Quelle que soit la méthode utilisée, les tendances temporelles se ressemblent uniquement dans la zone de forêt boréale européenne.
Quoiqu’il en soit, les résultats très impressionnants des analyses collaboratives du type « big data » effectuées par le consortium ArchaeoGLOBE indiquent que la transformation humaine de la surface de la Terre a commencé bien avant ce que certains chercheurs appellent « la grande accélération » et devraient inciter la communauté scientifique à raisonner sur un plus long terme les émissions de carbone et l’évolution de l’utilisation des terres.

Références de l’article :
Letessier TB, Mouillot D, Bouchet PJ, Vigliola L, Fernandes MC, Thompson C, et al. (2019) Remote reefs and seamounts are the last refuges for marine predators across the Indo-Pacific. PLoS Biol 17(8): e3000366. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000366
Publié dans PLoS Biology, le 6 août 2019
____
La pêche industrielle est en pleine expansion depuis les années 1950, et ce, à l’échelle mondiale. Le volume de la pêche industrielle représente plus de 80 millions de tonnes aujourd’hui, contre 20 millions en 1950. Au total, ce sont 55 % des zones océaniques qui sont exploitées par la pêche industrielle. Afin de remplir leurs filets, les pêcheurs doivent maintenant aller de plus en plus loin. Les derniers refuges de la faune marine, c’est-à-dire les espaces situés au-delà de la zone d’influence humaine détectable, sont ainsi de plus en plus rares. De vastes aires marines protégées (AMP), où la pêche est interdite, ont été établies depuis le début des années 2000 afin de préserver la biodiversité des océans. En 2015, les AMP atteignaient 3,4 % de la surface des océans mais nous manquons de connaissances sur la distribution globale de la biodiversité, de l’abondance et de la taille des prédateurs marins.
C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche, co-financée par la FRB et accompagnée par son Cesab, s’est attachée à analyser des données recueillies dans les océans Indien et Pacifique entre 2012 et 2015. La richesse (nombre d’espèces), la taille et l’abondance de plusieurs prédateurs marins, dont des requins, ont été estimées à l’aide de systèmes vidéo avec appâts sur plus de 1 000 sites. Aucun animal n’a été manipulé directement.
Publiés le 6 août 2019 dans PLOS Biology, les résultats démontrent que, bien que la richesse des espèces ne soit pas impactée par les activités humaines, la taille du corps et l’abondance des requins sont fortement corrélées avec la distance aux pressions anthropiques et notamment l’éloignement des ports de pêche. Ainsi, l’équipe de chercheurs a constaté que le nombre de requins diminuait de moitié dans les mers les plus proches des villes de plus de 10 000 habitants. Proche de l’Homme, la plupart des caméras n’ont pas enregistré la moindre présence de prédateurs qui, notamment les plus gros individus, se concentrent dans des zones situées à plus de 1 250 km des ports.
Malheureusement, comme les chercheurs le font remarquer, ces derniers refuges de prédateurs sont peu couverts par les AMP. Les travaux du projet Pelagic attirent donc l’attention sur la nécessité d’établir de nouvelles stratégies prenant en compte les habitats préférentiels des prédateurs marins, essentiels au maintien de la biodiversité dans nos océans et du fonctionnement des systèmes océaniques. Il s’agit d’établir au plus vite de nouvelles AMP comprenant des régions côtières comme des régions plus éloignées en mer.
L’auteur principal de l’étude, Tom Letessier (ZSL), a déclaré : “Seulement 13 % des océans de la planète peuvent maintenant être considérés comme “sauvages”, mais les requins et autres prédateurs sont beaucoup plus abondants et plus grands à des distances supérieures à 1 250 km des activités humaines. Cela suggère que les grands prédateurs marins sont incapables de prospérer à proximité des populations humaines et constitue un autre exemple clair de l’impact de la surexploitation humaine sur nos mers.”

À travers le monde, 14 espèces animales produisent 90 % des protéines consommées par les humains. Les processus d’intensification et de standardisation de la production agricole poussent à une certaine uniformisation de ces espèces. Une spécialisation toujours plus importante de ces animaux est alors recherchée et aboutit à une grande inégalité dans l’usage de ces races : certaines populations de vaches, sélectionnées par exemple pour leur grande production laitière, sont présentes partout dans le monde alors que des populations plus locales voient leurs effectifs baisser ou disparaissent. Cet appauvrissement de la diversité génétique pourrait avoir des conséquences importantes pour le futur de la production et les services rendus par les écosystèmes pâturés par des herbivores domestiques, en l’absence d’herbivores sauvages en nombre et avec une diversité suffisante. Alors comment maintenir une telle diversité ? Par quels acteurs passe cette conservation ? Pour quel rôle au sein des écosystèmes ? Anne Lauvie, chargée de recherche en gestion territoriale des populations animales locales à l’Inra nous éclaire sur les enjeux de la diversité génétique chez les animaux domestiqués.
La perte de biodiversité sur les territoires français et européens est maintenant actée. Que ce soit la perte de 30 % des espèces d’oiseaux communs en 15 ans dans les campagnes françaises (communiqué du MNHN, 2018), où la chute de plus de 75 % de la biomasse d’insectes en seulement 27 ans en Allemagne (Hallmann et al. 2017), les signaux d’alarmes sont tirés. Malgré ces alertes, l’artificialisation des terres – un des grands facteurs du déclin de la biodiversité – continu inlassablement, et ce dans toutes les régions. D’après une étude du Commissariat général au développement durable, 40 % de l’artificialisation en France se fait dans des zones où le taux de vacance de logements augmente fortement et 20 % dans des communes dont la population décroit. En l’absence de besoin apparent, comment expliquer la poursuite de ce phénomène ? Charlotte Bigard, chercheuse au centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (UMR CEFE), conduit des travaux à l’interface entre la recherche et l’aménagement. Elle nous explique les limites et les perspectives de la séquence Éviter-Réduire-Compenser, outil réglementaire majeur pour maintenir le lien entre aménagement et biodiversité.

Les antibiotiques sont des médicaments antimicrobiens qui tuent ou réduisent la croissance des bactéries. Ils sont utilisés en grande quantité depuis plusieurs décennies et la résistance d’agents pathogènes aux antibiotiques est depuis longtemps au cœur de la recherche en milieu clinique et, plus récemment, en recherche environnementale.
Les antibiotiques peuvent contourner les procédés de traitement de l’eau et peuvent se retrouver directement dans l’environnement. Ils sont détectés dans les rivières à des concentrations très faibles et dilués plus d’un million de fois par rapport aux concentrations observées dans le corps humain.
Cette étude démontre que les concentrations d’antibiotiques mesurées dans les eaux douces, quoique majoritairement inférieures aux concentrations cliniques efficaces, sont fortement susceptibles d’avoir des effets directs et indirects sur la composante microbienne des communautés aquatiques. En effet, même à de faibles concentrations, ces antibiotiques pourraient avoir des conséquences importantes pour les écosystèmes et pour la santé humaine. Les antibiotiques sont spécifiquement administrés pour traiter des infections ou pour augmenter les rendements notamment en élevage et en agriculture, mais, dans l’environnement, d’autres organismes vivants qui font partie de processus écologiques, tel que le cycle des nutriments, sont inévitablement exposés.
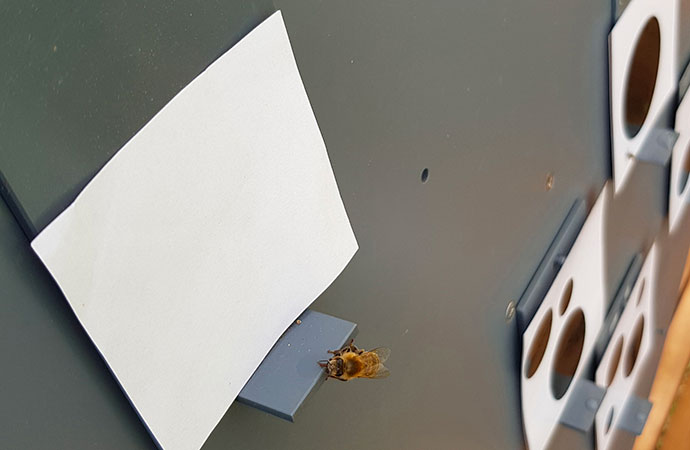
Une gageure lorsque l’on sait que derrière ce chiffre se cachent plusieurs niveaux de complexité. En effet, concevoir le « 0 », c’est être en mesure de comprendre qu’il est le reflet d’un ensemble parfaitement vide. C’est ensuite intégrer qu’il est un chiffre comme un autre, en allant jusqu’à comprendre son positionnement de manière logique dans une suite croissante ou décroissante de nombres.
La difficulté d’appréhension de la notion chez l’homme aura notamment été révélée lors d’une étude, menée en 2013, auprès d’enfants de maternelle2. Des scientifiques ont proposé un test sur tablette à vingtaine d’écoliers de 4 ans. Des formes contenant des points apparaissaient à l’écran et les enfants devaient indiquer tactilement la forme avec le moins de points. En cas de réussite, un soleil illuminait l’écran tandis qu’en cas d’échec, un écran noir s’affichait. Les chercheurs se sont ainsi rendus compte que, pour ces jeunes enfants ayant appris à compter, il n’y avait pas de difficulté à classer les chiffres les uns par rapports aux autres (de 1 à 4). Cependant, à l’intégration d’une forme vierge, beaucoup confondaient « 0 » et « 1 ». Des études chez les primates ont révélé des résultats similaires. Chez l’Homme, la compréhension de ce que représente le 0 n’est donc pas innée mais bien acquise au cours du développement.
Étonnamment, les abeilles n’ont pas semblé rencontrer ces mêmes difficultés. L’expérience a été menée par la chercheuse française Aurore Avarguès-Weber et ses collègues australiens3, et les résultats ont été publiés le mois dernier dans la revue Science4. S’il avait été précédemment démontré que ces insectes savaient compter de 1 à 5, les scientifiques les ont cette fois entraîné à compter de 5 à 1. Pour cela, des « cartes » sur lesquelles figuraient de 1 à 5 points étaient disposées sur un mur. À leur entrée dans l’espace dédié, les abeilles devaient alors voler vers la carte présentant le moins de points et se poser sur la plateforme attenante. Là, une boisson leur était proposée : sucrée en cas de bonne réponse, amère en cas de mauvaise.
Après s’être ainsi assurés que les insectes avaient intégré les notions de « inférieur » et de « supérieur », ils ont ajouté une carte sans point à l’expérience. À la surprise de l’équipe de recherche, les abeilles n’eurent pas de difficulté à identifier la carte vide comme une carte inférieure à 1.
« Pour la première fois, nous démontrons que des animaux invertébrés sont capables de comprendre des concepts complexes, là où certaines espèces de vertébrés rencontrent des difficultés, explique la chercheuse française. C’est une avancée inédite et qui ouvre pleins de nouvelles questions : comment le cerveau de ces insectes, bien plus petit que le nôtre fait-il pour intégrer cette notion complexe ? Mais aussi, quelle est l’utilité les abeilles tirent-elles de ce concept dans leur quotidien ? »
—
2. Dustin J. Merritt, Elizabeth M. Brannon, Nothing to it: Precursors to a zero concept in preschoolers, Behavioural Processes, Volume 93, 2013, Pages 91-97, ISSN 0376-6357, https://doi.org/10.1016/j.beproc.2012.11.001.
3. L’équipe est franco-australienne, un atout pour « bénéficier » de deux étés par an et pouvoir travailler en extérieur avec les abeilles toute l’année.
4. Scarlett R. Howard, Aurore Avarguès-Weber, Jair Garcia, Andrew Greentree, Adrian G. Dyer. Bees extrapolate ordered relations to place numerosity zero on a numerical continuum, Science, 2018. DOI : 10.1126/science.aar4975

Trois espaces et territoires étaient déjà dotés de règles d’APA avant l’adoption de la loi : le Parc amazonien de Guyane, la province sud de Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

La loi française vise les accès et les activités initiés après l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2016, qu’ils soient réalisés par des utilisateurs français ou étrangers.
Elle prévoit que l’État français est le fournisseur des ressources génétiques se trouvant sous sa souveraineté, sous réserve des compétences des collectivités d’outre-mer. Il est le bénéficiaire des avantages, qui sont dans la pratique versés à l’Office français de la biodiversité (OFB).
Elle met en place différentes procédures d’APA en fonction de la ressource et de l’utilisation envisagée (formulaire de déclaration ou d’autorisation), voire de leur provenance (métropole, outre-mer).
Elle établit une procédure spécifique pour l’accès et l’utilisation des CTA détenues par les seules communautés d’habitants présentes en Guyane et à Wallis et Futuna.
Elle prévoit des dispositions sur le partage des avantages – monétaire et non monétaire –, le transfert des ressources, des sanctions pénales et financières.
Des formulaires de déclaration et de demande d’autorisation sont disponibles auprès du ministère en charge de l’environnement, à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acces-et-partage-des-avantages-decoulant-lutilisation-des-ressources-genetiques-et-des-connaissances

Le Réglement (UE) n°511/20141 du 16 avril 2014 établit les règles concernant le respect des obligations portant sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Ce règlement s’applique aux ressources génétiques provenant des pays qui ont ratifié le Protocole de Nagoya.
Il a été complété par le règlement d’exécution (UE) 2015/18662 qui est entré en vigueur le 9 novembre 2015.
Il existe un document d’orientation (2016)3 sur le champ d’application et les obligations essentielles du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union.
Le règlement européen n°511/2014 s’applique aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées lorsque :
Les exclusions concernent :
Afin de respecter l’obligation de diligence nécessaire, les utilisateurs doivent prendre des mesures pour tracer, documenter, conserver et transférer les informations liées à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. La documentation doit être conservée 20 ans après la fin de l’utilisation.
Pour démontrer la diligence nécessaire, il est possible de faire référence à un certificat de conformité reconnu à l’échelle international (CCRI) ou d’obtenir les informations suivantes :
Les utilisateurs de ressources génétiques ont pour obligation de déclarer qu’ils ont fait preuve de diligence nécessaire à différents moments :
L’autorité compétente vis-à-vis de la réglementation européenne est le ministère en charge de la recherche :
Les sanctions prévues dans la loi française sont financières et peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement.
—


La France bénéficie d’un très riche ensemble d’écosystèmes marins et côtiers répartis sur l’ensemble du globe. Ceux-ci recèlent une biodiversité exceptionnelle dont on estime que 80% se situe dans les territoires ultra-marins. Avec un total de 55 000 km2, la France détient la quatrième plus grande surface de récifs coralliens au monde.

Depuis son émergence au Néolithique, l’agriculture modèle les écosystèmes afin de les rendre plus productifs et de couvrir les besoins croissants de la population humaine en produits végétaux et animaux. Les écosystèmes agricoles se caractérisent donc par un fort degré d’anthropisation qui résulte des actions de reconfiguration des milieux et de gestion des sols et de la biomasse par les agriculteurs. La tendance constatée depuis les années 1950 en France est à l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations, à la réduction du nombre d’espèces cultivées et à la simplification des structures paysagères. Tous ces facteurs entrainent une baisse de la diversité biologique et de l’abondance des espèces associées aux écosystèmes agricoles.




Une biodiversité exceptionnelle peuple les cours d’eau et les eaux marines des outre-mer français. Près de 500 espèces de poissons évoluent dans les fleuves et criques de la forêt amazonienne de Guyane ; plus de 150 variétés de coraux composent les récifs de Mayotte et de La Réunion ; un millier de taxons de diatomées, algues microscopiques unicellulaires, habite le fond des cours d’eau des Antilles, de Mayotte et de La Réunion. Cette nature exubérante subit pourtant les pressions des activités humaines et peut en être fortement impactée. Les rivières des territoires insulaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion pâtissent notamment d’importants prélèvements d’eau qui réduisent drastiquement sa disponibilité pour la vie et la migration des espèces. Les activités d’orpaillage en Guyane induisent destruction du milieu naturel, asphyxient des rivières par les boues et pollution au mercure. À Mayotte, les détergents et lessives utilisées par les lavandières génèrent une pression chimique importante sur les invertébrés benthiques, organismes qui peuplent le fond des cours d’eau.
Pour rendre compte des altérations subies par les écosystèmes aquatiques et les communautés animales et végétales qui les composent, et ainsi pouvoir alerter et agir pour leur protection, la Directive cadre sur l’eau (DCE) a amené à développer des outils pour la surveillance des milieux aquatiques. Cette directive européenne, adoptée en 2000, vise à maintenir ou restaurer leur bon état écologique. En faisant des communautés biologiques les sentinelles de la qualité des eaux, elle a érigé la biodiversité en « juge de paix » de la surveillance et de la reconquête de l’état des rivières, des lacs et des eaux littorales.

Chaque année en France, plus de 150 000 personnes sont infectées par des bactéries multirésistantes, c’està-dire résistantes à plusieurs antibiotiques, comme par exemple certains staphylocoques dorés en milieu hospitalier (Carlet & Le Coz, 2015). Ce phénomène, qualifié d’antibiorésistance, provient principalement de notre utilisation fréquente d’antibiotiques pour soigner les humains et les animaux d’élevage, mais pas uniquement. Le rôle de notre environnement dans ces échanges bactériens fait l’objet de nouvelles recherches. Les résidus d’antibiotiques dans les eaux usées, le contact de la faune sauvage avec les bactéries multirésistantes et même la pollution causée par d’autres biocides, tels que les désinfectants, sont des facteurs de propagation de la résistance aux antibiotiques. Marion Vittecoq, chargée de recherche en écologie de la santé à l’Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes (Tour du Valat), revient sur ces problématiques encore à l’étude.
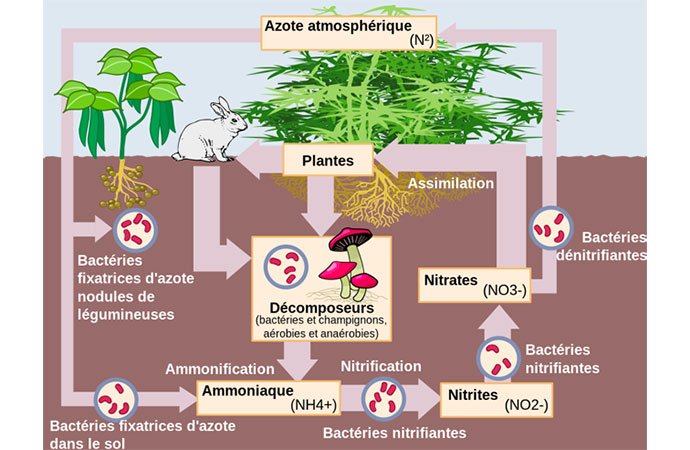
L’azote, bien que majoritaire dans notre atmosphère (78 % de l’air), est un élément limitant de la croissance pour les règnes animal et végétal dans de nombreux écosystèmes (Vitousek & Howarth, 1991). Il y a sur Terre beaucoup d’azote inerte (N2), mais peu de composés azotés réactifs comme le nitrate (NO3), l’ammonium (NH4) et l’ammoniac (NH3) qui sont les principales formes assimilables par les plantes, à l’exception de quelques familles botaniques comme les légumineuses fixant l’azote atmosphérique grâce aux symbioses avec des bactéries. Ceci amène un paradoxe évident qui resta longtemps indépassable : l’azote est partout sur la planète mais naturellement accessible seulement par quelques organismes qui conditionnent l’ensemble de l’accès à cette ressource pour toute la chaîne du vivant. Le cycle de l’azote, naturel comme anthropique, fut donc au départ basé sur une économie du recyclage de l’azote contenu dans les matières organiques en décomposition.
Les assolements1 dès le Moyen-Âge, les pratiques agricoles cherchant à bénéficier au mieux des fumures animales, la collecte des « boues, racluns et immondices urbaines » dans les villes du monde témoignent de ce souci historique et général de réinjecter cet engrais « naturel » dans les sols (Barles, 2005). Jusqu’au début du 20e siècle, « le fumier était or » selon les mots de Victor Hugo dans Les Misérables, invitant les villes à fumer la plaine au lieu de le jeter aux égouts « en empestant les eaux et en appauvrissant les sols ». Et puis, il y a un siècle, deux chimistes allemands inventent les engrais minéraux et le procédé Haber-Bosch qui permet la synthèse de l’ammoniac à partir de l’azote de l’air et l’hydrogène. C’est peu dire que cette histoire fût un succès. Associés à de nouvelles techniques culturales et de nouvelles variétés de pesticides, les engrais chimiques produits à échelle industrielle ont permis la révolution verte et l’intensification agricole mondiale, accroissant les rendements et permettant à de nombreuses régions de s’approcher de l’autosuffisance alimentaire. Cependant, les coûts environnementaux et sociaux de l’agriculture industrielle ont longtemps été ignorés. Ils se sont cumulés à d’autres coûts liés à d’autres transformations concomitantes : l’accroissement des combustions d’hydrocarbures d’origines domestique et industrielle a multiplié les apports d’une autre source d’azote réactif, les oxydes d’azote, dont certaines formes comme le protoxyde d’azote (N2O) entrent dans la catégorie des gaz à effet de serre. La durabilité de ce système est aujourd’hui mise en question à mesure que la dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines ou encore que l’impact sur les sols et la biodiversité se font sentir (Gowdy & Baveye, 2019).

Nos sociétés auraient développé une forme d’addiction au plastique, symbole de modernité d’hier devenu fléau environnemental. La mise au point du celluloïd par les frères Hyatt remonte à 1869 mais l’utilisation massive des plastiques débute seulement après la seconde guerre mondiale et se révèle déjà problématique : entre 1950 et 2015, 8,3 milliards de tonnes de plastiques ont été produits. Plus de 79 % sont déjà devenus déchets (Geyer et al., 2017) et s’accumulent dans les décharges ou en pleine nature. Ils contaminent ainsi les eaux et les sols de nombreux écosystèmes, affectant directement ou indirectement la santé humaine et animale. Aujourd’hui, sur l’ensemble du globe, on compte en moyenne 15 tonnes de déchets plastiques accumulés par kilomètre carré, sur terre comme sur mer. Nathalie Gontard, directrice de recherche dans l’unité « ingénierie des agro-polymères et technologies émergentes » à l’Inra, nous présente les enjeux et les implications de cette pollution globale qui nécessite un changement important des pratiques et une baisse de la consommation.

L’une des conséquences liées à l’augmentation des températures est le blanchissement corallien.
Le blanchissement se produit lorsque la densité des symbiotes algales, les zooxanthelles (Symbiodinium spp.), dans les tissus d’un hôte corallien diminue drastiquement à la suite d’un stress environnemental, révélant le squelette blanc du corail sous-jacent. La survie des coraux blanchis est alors compromise physiologiquement et nutritionnellement. Un blanchissement prolongé sur plusieurs mois conduit à des niveaux élevés de mortalité corallienne. La modélisation du climat mondial et les observations satellitaires indiquent également que les conditions thermiques requises pour le blanchissement des coraux prévalent de plus en plus, laissant présager que les zones de refuge, indemnes de blanchissement, pourraient disparaître au milieu du siècle.
Ces épisodes de blanchissement corallien, de plus en plus récurrents, et la mortalité des coraux qui en découle sont des phénomènes récents causés par l’impact anthropique. Ce qui, jusque dans les années 1980, n’était qu’un phénomène observable à l’échelle locale (quelques dizaines de kilomètres), causé par des facteurs de stress locaux (inondations d’eau douce, sédimentation ou encore temps inhabituellement froid ou chaud) est devenu un phénomène observable à l’échelle régionale (> 1000 km) et globale lié aux pressions anthropiques. C’est ce que révèle les bandes de croissance des coraux âgés des Caraïbes : les distorsions synchrones des dépôts squelettiques (bandes de stress) le long d’un tronçon de 400 km du récif mésoaméricain n’ont été trouvées que dernièrement suite aux conditions extrêmement chaudes.
Un des résultats majeurs de l’étude « Schémas spatiaux et temporels de blanchissement de masse des coraux pendant l’Anthropocène », publiée dans Science, est la mise en évidence de l’augmentation spectaculaire de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de blanchissement corallien qui atteignent des niveaux très élevés et quasiment irréversibles.
![[DCSMM] 1 minute pour comprendre la DCSMM](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-5-Anastasia-Wolff.jpg)
1 minute pour comprendre la DCSMM avec Anastasia Wolff, chargée de mission « bon état écologique des eaux marines » au ministère en charge de l’environnement :
![[DCSMM] 3 minutes pour comprendre l’impact des déchets en milieu marin](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-4-Francois-Galgani.jpg)
3 minutes pour comprendre l’impact des déchets en milieu marin avec François Galgani, responsable du groupe technique « déchets marins » pour la DCSMM :
![[DCSMM] 3 minutes pour comprendre l’état écologique des espèces halieutiques commerciales pêchées dans les eaux métropolitaines](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-3-Eric-Foucher.jpg)
3 minutes pour comprendre l’état écologique des espèces halieutiques commerciales pêchées dans les eaux métropolitaines par Éric Foucher, pilote scientifique « espèces commerciales » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :
![[DCSMM] 3 minutes pour comprendre le coût économique et sociale de la dégradation du milieu marin](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-2-Remi-Mongruel.jpg)
3 minutes pour comprendre le coût économique et sociale de la dégradation du milieu marin avec Rémi Mongruel, pilote scientifique « analyse économique et sociale » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :
![[DCSMM] 3 minutes pour comprendre l’état des mammifères marins dans les eaux métropolitaines](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-1-Jerome-Spitz.jpg)
3 minutes pour comprendre l’état des mammifères marins dans les eaux métropolitaines avec Jérôme Spitz, pilote scientifique « mammifères marins » pour la DCSMM et chercheur à l’Ifremer :

Selon une étude fondée sur des données satellitaires, un très fort recul de la végétation dans les steppes mongoles est en cours. Il serait largement dû à l’augmentation du bétail dans le pays. Si les variations des précipitations jouent un rôle important, le surpâturage paraît en être la cause principale. Cette baisse de biomasse végétale est loin d’être homogène sur l’ensemble du territoire, et pose encore question. Cependant, dans les zones limitrophes du désert de Gobi, on attribue plus de 80 % de la perte de végétation au cheptel. Et sur l’ensemble du pays, c’est une perte de 12 % de territoire végétalisé qui a été comptabilisée entre 2002 et 2012 (Hilker et al., 2014). Cette dégradation de la steppe se traduit par une désertification qui prend notamment sa source dans le développement d’un commerce lucratif : celui du cachemire.
Si, depuis la sortie de la Mongolie du bloc soviétique en 1990, les produits de l’élevage comme la viande et la laine ont connu un effondrement de leurs prix, le cachemire, lui, se porte bien et l’élevage des “chèvres cachemires” s’est accru.

Si la Chine et l’Inde exploitent toujours les ressources naturelles pour se soigner, l’industrie pharmaceutique repose elle principalement sur des produits synthétisés. Cette tendance est-elle un atout ou un risque supplémentaire pour la préservation de la biodiversité ? Bruno David, directeur du département Recherche substances naturelles aux laboratoires Pierre Fabre, nous éclaire sur les usages et le devenir de ces ressources.

Le Brésil reste marqué culturellement par son passé colonial de conquête du territoire. L’expansion du front pionnier vers le nord et l’ouest s’est faite au détriment de la forêt. L’appropriation est, elle, passée par la conversion des écosystèmes forestiers en terres agricoles ou en pâturages. La forêt n’est pas tant défrichée pour ses ressources – la productivité y est faible – mais plutôt comme réservoir de terres libres. Avec les préoccupations environnementales grandissantes, la forêt représente un gisement mondial de biodiversité et de carbone, et le Brésil doit à présent répondre de la déforestation de l’Amazonie aux yeux de l’opinion internationale.
Aussi, lors de chaque conférence internationale, sur la diversité biologique comme sur le changement climatique, le Brésil ne perd pas une occasion de revenir sur sa grande réussite : l’important recul de la déforestation de sa forêt amazonienne entre 2004 et 2014, passée de 27 772 km2 à 5 012 km2 par an, soit une réduction de 82 % de la surface annuelle défrichée (cf. graphique ci-dessous). Dans le même temps, la contribution des émissions de CO2 liées à la déforestation est ainsi passée de 71 % du total des émissions du Brésil à 33 %. Si l’on peut relativiser ces chiffres en pointant le choix opportun des dates de référence, le report de la déforestation sur le Cerrado1 et sa reprise récente en Amazonie, il importe de comprendre les clés de cette réussite, particulièrement dans le contexte actuel où la protection des forêts est remise en cause et fait à nouveau peser la menace d’un point de non-retour pour les écosystèmes.

GRAPHIQUE – Déforestation annuelle dans l’Amazonie légale brésilienne (AMZ)
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
Jusqu’à la veille du Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992, la déforestation de l’Amazonie est la conséquence des politiques d’intégration régionale : développement des infrastructures et fronts pionniers agricoles sont impulsés par le gouvernement fédéral et forment un “arc de déforestation” qui s’avance dans le massif amazonien à partir du sud et de l’est. Cependant, le Brésil peut déjà témoigner de son souci de protéger sa forêt tropicale à l’ouverture du Sommet, à travers plusieurs initiatives. L’une d’entre elles, le Programme de contrôle par satellite de la déforestation en Amazonie légale2 (Prodes) de l’Institut brésilien de recherches spatiales (INPE) a été créé en 1988. Ce programme a permis de connaître l’état des forêts et de suivre son évolution sur le temps long, apportant une vraie crédibilité à la démarche. Et dès 1991, les scientifiques brésiliens alertent sur le processus de déforestation et prédisent une savanisation de l’Amazonie, alors déboisée à 8 %. En 1989, l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles (IBAMA), chargé de la protection de l’environnement, est créé avec des pouvoirs législatifs et de police. Un ministère de l’Environnement sera mis en place à l’occasion du Sommet de la Terre en 1992.
Quelques années plus tard, le programme pilote pour la préservation des forêts tropicales, le PPG7, est engagé à l’initiative des pays du G7 et de l’Union européenne, lorsque l’image de “l’Amazonie en flammes” émeut l’opinion internationale, à la suite de la publication du chiffre record de 29 059 km2 de forêts disparues en 1995. En 1996, le président Cardoso édite une mesure provisoire qui modifie le code forestier, portant de 50 % à 80 % la surface des propriétés privées en forêt amazonienne devant rester en réserve de végétation originelle. Il interdit aussi provisoirement la conversion des forêts en terres agricoles. En 2000, le Système national des unités de conservation de la nature (SDUC) est promulgué. Malgré ces différentes initiatives, la déforestation se poursuit sous l’effet des dynamiques régionales et du manque de coordination politique.

Les comportements de préférence ou de protection entre parents ont été largement documentés chez les animaux et même expliqués en termes d’avantage évolutif. Ainsi les individus apparentés trouveraient avantage à collaborer pour transmettre leurs gènes.
Il y a plus de dix ans, une biologiste canadienne avait émis l’idée qu’il pouvait en être de même pour les plantes. Cependant, comme ces dernières ne possèdent pas le système nerveux qui permet aux animaux de reconnaître leur parentèle, sa théorie n’a pas été considérée comme sérieuse. Depuis, la science a démontré que les plantes pouvaient distinguer les racines relevant du “soi” et les racines relevant du “non-soi”, ouvrant une brèche vers un élargissement des perspectives en matière de comportement des plantes.
Les travaux scientifiques récents présentés par Elisabeth Pennisi dans une synthèse pour le journal Science en janvier 2019 vont encore plus loin.
Les conséquences pratiques que sous-tendent les premières études sur la reconnaissance familiale chez les plantes et ses conséquences ont suscité l’intérêt de la communauté scientifique. Les mécanismes en jeu pour favoriser les individus apparentés sont divers : certaines espèces limitent l’étendue de la propagation de leurs racines, d’autres modifient le nombre de fleurs qu’elles produisent et quelques-unes inclinent ou déplacent leurs feuilles pour minimiser l’ombrage des plantes voisines. Néanmoins, les questions persistent : une plante identifie-t-elle un parent génétique ou reconnaît-elle simplement que sa voisine est plus ou moins semblable à elle-même ?
“Il semble que chaque fois qu’un scientifique cherche un effet de préférence parentale chez les plantes, il le trouve”, a déclaré André Kessler, un spécialiste en écologie chimique à l’université de Cornell.
Un des premiers exemples intéressants est celui de la sauge buissonnante (Artemisia tridentata) en Amérique du nord. Attaqués par des herbivores, les arbustes libèrent des substances chimiques volatiles qui poussent l’arbre voisin à produire des composés toxiques pour leurs ennemis communs. L’écologue Richard Karban, de l’Université de Californie à Davis, s’est demandé si les parents étaient prévenus de manière préférentielle. Il avait déjà été établi que les buissons se divisaient en deux “chémotypes”1, émettant soit du camphre soit de la thuyone lorsque leurs feuilles sont endommagées. L’équipe a montré que les chémotypes étaient héritables, ce qui en faisait un signal potentiel de reconnaissance de parentèle. En 2014, les chercheurs ont indiqué que, lorsque les substances volatiles d’une plante présentant un chémotype donné étaient appliquées sur le même type de plante, ces plantes produisaient des défenses anti herbivores plus fortes et présentaient beaucoup moins de dommages causés par les insectes que lorsque les substances volatiles provenaient d’une plante de l’autre chémotype.
Un second exemple est fourni par la moutarde Arabidopsis thaliana. Il y a environ huit ans, Jorge Casal, biologiste spécialiste des plantes à l’université de Buenos Aires, a remarqué que les plants d’Arabidopsis poussant aux côtés de parents modifient l’arrangement de leurs feuilles pour réduire l’ombrage sur leurs voisines, mais qu’elles ne le font pas lorsque les voisins ne leur sont pas apparentés. Leur perception de la présence de parents était toutefois un mystère. En 2015, l’équipe de Casal a découvert que la force avec laquelle la lumière est réfléchie sur les feuilles voisines donne une indication de la parenté et initie les réarrangements dans les feuilles. Des membres d’une même famille ont tendance à produire des feuilles à la même hauteur et par conséquence à renvoyer plus de lumière vers leurs voisines. L’équipe de chercheurs a mis en évidence que cette réduction d’ombrage favorisait une croissance plus vigoureuse et une meilleure production de graines.
Ce fut le premier cas de reconnaissance des parents chez les plantes où la relation complète incluant la reconnaissance de la parentèle (signal et récepteur) et ses conséquences a été mis en évidence. Depuis lors, Casal et son équipe ont montré en 2017 dans les Actes de la National Academy of Sciences que, lorsque des tournesols apparentés sont plantés les uns à côté des autres, ils s’organisent également pour ne pas se gêner entre eux. Les tournesols inclinent leurs tiges en alternance d’un côté ou de l’autre de la rangée. Pour pousser encore plus loin l’expérience, ils ont planté entre 10 et 14 plantes apparentées par mètre carré – une densité plus élevée que dans les plantations commerciales – et ont obtenu 47 % d’huile en plus lorsque les plantes étaient libres de leur mouvement (et donc capables de s’éloigner les unes des autres) comparées aux mêmes plantes contraintes de pousser droit.
Plus tard, Susan Dudley, écologiste de l’évolution des plantes (university McMaster à Hamilton, au Canada) a déclaré : “nous devons reconnaître que les plantes ne détectent pas seulement s’il fait jour ou nuit, ou si elles ont été attaquées, mais qu’elles reconnaissent aussi avec qui elles interagissent”. Estimant que les mêmes forces évolutives qui conduisent à favoriser la parentèle devraient s’appliquer aux plantes, la chercheuse a conduit des expérimentations avec de la roquette des mers (Cakile edentula), une plante succulente trouvée sur les plages nord-américaines. Elle a ainsi publié en 2017 une étude démontrant que le système racinaire de la roquette était moins développé lorsqu’elle était cultivée en pots avec des plantes apparentées par rapport à la même roquette cultivée avec des plantes non apparentées de la même population. Elle a suggéré que la plante avait réduit la concurrence de ses propres racines en laissant plus de place à ses parents pour obtenir de la nourriture et de l’eau. Si son étude a été vivement critiquée tant en termes de rigueur statistique qu’en termes de conception, néanmoins d’autres chercheurs ont depuis publié des découvertes similaires.
Le 22 mai 2018, Rubén Torices et ses collègues de l’université de Lausanne (Suisse) et du Conseil national de la recherche espagnole ont publié dans Nature Communications les résultats d’une étude démontrant un phénomène de coopération chez une autre brassicacée d’ornement, Moricandia moricandioides. Après avoir cultivé 770 plantes en pot, seules ou avec trois ou six voisins de parenté variable, l’équipe a mis en évidence que les plantes cultivées avec des parents produisaient plus de fleurs, ce qui les rendaient plus attrayantes pour les pollinisateurs. Les expositions florales étaient particulièrement élevées dans les pots les plus peuplés. Torices, aujourd’hui enseignant à l’université King Juan Carlos à Madrid, qualifie ces effets “d’altruistes”, car chaque plante abandonne individuellement une partie de son potentiel de production de graines pour dépenser plus d’énergie dans la production de fleurs avec une présomption d’une meilleure fertilisation au bénéfice de la communauté.
Chui-Hua Kong, spécialiste en écologie chimique (université d’agriculture de Chine, Beijing), exploite un effet similaire pour stimuler les rendements chez le riz. Son laboratoire étudie des variétés de riz émettant des produits chimiques à effet désherbant à partir de leurs racines, mais qui obtiennent des rendements trop faibles pour remplacer les variétés couramment cultivées qui nécessitent des herbicides. Toutefois, en septembre 2018, à l’issue de tests de terrain conduits pendant trois ans, les chercheurs ont publié dans le journal New Phytologist des résultats démontrant que des variétés de riz “autoprotectrices” (capables de reconnaître leur parentèle), avaient des rendements augmentés de 5 % lorsqu’elles étaient cultivées avec des parents, plutôt qu’avec des plantes non apparentées.
Pour tester l’approche à plus grande échelle et confirmer que ces liens familiaux suggérés pouvaient être exploités pour améliorer les rendements des cultures, les chercheurs ont répété l’expérience dans des rizières du sud de la Chine.
Brian Pickles, écologiste à l’université de Reading au Royaume-Uni, propose, quant à lui, que la reconnaissance de la parentèle puisse aider les forêts à se régénérer. En traçant les flux de nutriments et les signaux chimiques entre les arbres reliés par des champignons souterrains, il a montré que les sapins nourrissent préférentiellement leurs parents et les avertissent des attaques d’insectes. Les résultats suggèrent qu’une famille de sapins grandirait plus rapidement qu’une communauté de sapins non apparentés.
Pour certains biologistes, ce nouveau paradigme des plantes en communication et en coopération nécessite encore la production de preuves. “Je ne pense pas que nous ayons actuellement des preuves convaincantes d’une reconnaissance parentale chez les plantes”, déclare Hélène Fréville, biologiste des populations à l’Inra de Montpellier. Laurent Keller, biologiste de l’évolution à l’université de Lausanne, a montré au contraire que les signes apparents de reconnaissance de la parentèle chez Arabidopsis provenaient plutôt de différences innées entre les plantes. Il appelle à plus de rigueur dans les études pour écarter d’autres explications potentielles, tout en prédisant que des preuves plus solides de la reconnaissance de la parentèle chez la plante émergeront. Karban, lui, est déjà pleinement convaincu. “Nous apprenons que les plantes sont capables d’un comportement beaucoup plus sophistiqué que nous avions pensé, c’est vraiment fascinant”.
—
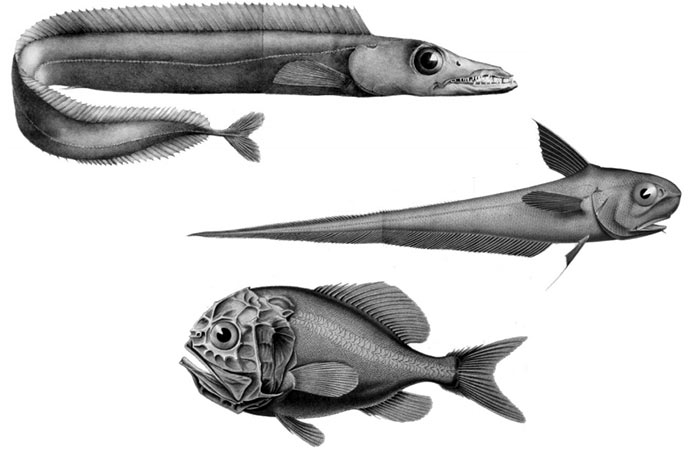
L’exploitation non-durable des espèces est la deuxième cause du déclin global de la biodiversité, après le changement d’utilisation des terres. Elle est aussi probablement une des plus évidentes à résoudre, via des règlementations pertinentes. En se fondant sur les connaissances scientifiques, elles permettent de mieux gérer le prélèvement des espèces et d’ainsi assurer le renouvellement naturel des ressources. Le secteur des pêches notamment dispose de nombreux outils. Mais comme le révèle le cas des poissons d’eaux profondes, des mesures tardent parfois à être prises, mettant en danger les équilibres des écosystèmes et compromettant donc également la durabilité des activités.
Ses poissons vivant à plusieurs centaines de mètres de profondeur se sont retrouvés sur nos étals à la fin des années 1980. Les populations de morues, de lieus noirs et de merlus en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse connaissent un déclin de leur biomasse en raison de leur surexploitation, ce qui provoque une baisse de rentabilité des pêcheries françaises de haute-mer. Les chalutiers se tournent alors vers les espèces vivant plus en profondeur, entre 800 et 1 500 mètres, telles que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), le sabre noir (Aphanopus carbo) et l’hoplostèthe orange, ou empereur (Hoplostethus atlanticus) (Charuau et al., 1996). À la même époque, la consommation de poisson évolue vers une demande plus importante de filets de poissons au détriment de l’achat de poissons entiers. Cette évolution des modes de consommation permet la mise sur les marchés de filets de ces poissons d’eaux profondes, alors que présentés entiers, leur aspect aurait probablement été peu engageant pour les consommateurs. Plusieurs espèces de requins profonds sont quant à elles présentées sous forme de saumonette (requins étêtés, vidés et pelés).
Dès la fin des années 1990, certaines populations de poissons profonds montrent à leur tour des signes de déclin. Dans certaines zones, les captures d’hoplostèthes oranges, d’abord abondantes, se sont effondrées au bout de 12 à 18 mois d’exploitation seulement, révélant que pour cette espèce la pêche peut extraire une forte proportion de la biomasse1 en seulement quelques mois.

Le changement climatique n’est pas un état problématique passager, mais bien une situation pérenne qu’il va falloir considérer dans sa globalité. Il nécessite une adaptation importante des écosystèmes et de ceux qui les étudient. Sous nos latitudes tempérées, ces changements prennent une signification particulière en modifiant la longueur relative des saisons. Or, l’arrivée du printemps rythme le cycle annuel de toute la biodiversité. La remontée printanière des températures s’accompagne d’une reprise explosive de la végétation. Les jeunes feuilles fournissent une nourriture de qualité pour une multitude d’invertébrés herbivores, aux premiers rangs desquels, les chenilles de papillons. Eux-mêmes sont alors consommés par des carnivores. Ce formidable accroissement de la biomasse va, en particulier, permettre aux prédateurs de se reproduire. Ce phénomène est cependant éphémère : les jeunes pousses tendres se chargent rapidement de tanin et deviennent indigestes. On assiste ainsi à un pic d’abondance de nourriture et chaque niveau de la chaîne alimentaire tente de se synchroniser sur le pic dont il dépend.

À mesure que le climat se réchauffe, les températures des mers augmentent également. Du plancton aux oiseaux, en passant par les poissons, ce phénomène modifie significativement toutes les composantes des écosystèmes marins. Un des effets les plus documentés de ce réchauffement est la migration des espèces vers les pôles, qui se traduit par une diminution de la biodiversité marine dans la zone intertropicale. Mais de nombreux autres facteurs influent sur les communautés d’espèces, notamment leur exploitation non-durable par la pêche. Cette dernière est alors responsable d’impacts très négatifs sur les populations de poissons, dont la diminution a aussi une incidence négative sur les oiseaux marins (Cury et al., 2011 ; Grémillet et al., 2018). Une proportion croissante de ces populations – un tiers des espèces pêchées en 2015 – est surexploitée, tandis que 60 % sont exploitées à leur maximum, et seules 7 % des populations sont sous-exploitées (FAO 2018). Or, l’océan reste une source essentielle d’approvisionnement en protéines pour des millions de personnes dans le monde, notamment dans les pays en développement.
Il est donc urgent de mettre en place une gestion soutenable des pêches, au moment même où les impacts négatifs du changement climatique rendent la tâche encore plus complexe : certains modèles prévoient une diminution de la biomasse des poissons allant jusqu’à 25 % d’ici la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre devaient s’intensifier (Lotze et al., 2018). Pour estimer les impacts des changements climatiques combinés à ceux des pratiques de pêche, une équipe de scientifiques menée par Caihong Fu (DFO, Canada) et Yunne-Jai Shin (IRD, France) a étudié neuf écosystèmes marins dans le monde entier. L’équipe s’est appuyée sur des modèles mathématiques développés pour chaque écosystème, et les a utilisés comme des laboratoires virtuels. En manipulant ces outils, les chercheurs ont pu explorer la manière dont le système évolue lorsque le changement climatique et la pêche entrent en interaction. L’objectif du projet est d’apporter un éclairage scientifique à la prise de décisions afin d’adapter les politiques de gestion des pêches au changement climatique.

En 2011, l’article de Cury et al. Global Seabird Response to Forage Fish Depletion — One-Third for the Birds soulignait combien les oiseaux marins étaient dépendants des ressources marines dans certaines régions du monde. Grémillet et ses collègues démontrent aujourd’hui que la compétition entre les oiseaux marins et les pêcheries est un facteur de stress significatif à l’échelle globale sur la période 1970-2010, pour une communauté mondiale d’oiseaux marins qui a décliné de 70 % depuis 1950 (Paleczny et al., 2015).


Avec près de 60 % des agents pathogènes humains et environ 60 % des maladies infectieuses émergentes classés comme zoonotiques, c’est-à-dire transmises des animaux à l’homme (Jones et al., 2008 ; Woolhouse & Gowtage-Sequeria, 2005), ces pathologies (grippe aviaire, VIH SIDA, SRAS et Ebola, etc.) représentent un enjeu croissant de santé publique au niveau mondial (Jones et al., 2008).
Les maladies, dont les zoonoses, sont des processus écologiques naturels au sein des écosystèmes. Leur éradication peut ne pas avoir que des effets positifs car d’autres parasites ou pathogènes sont susceptibles d’occuper les niches laissées vacantes (Lloyd-Smith, 2013).
En raison de la multiplicité des espèces et des échelles impliquées (Johnson, de Roode et Fenton, 2015), l’écologie des communautés associée à l’épidémiologie peut amener à une meilleure compréhension des processus et des dynamiques impliqués dans les épidémies de zoonoses et faciliter une meilleure gestion des risques liés aux maladies zoonotiques (Cunningham et al., 2017 ; Johnson et al., 2015 ; Young et al., 2017).
Par le biais d’exemples, les auteurs illustrent la nécessité de prendre en compte, en plus des exigences écologiques des agents pathogènes zoonotiques, d’une part, l’impact des interventions humaines et d’autre part les types d’écosystèmes concernés (urbain, péri-urbain et forestier) pour se préparer à l’émergence de ces zoonoses dans l’Anthropocène et les gérer efficacement.

En 1954, le livre de Jean Giono, “L’Homme qui plantait des arbres”, peignait l’histoire d’un berger écologiste. Jour après jour, tout en menant ses moutons, il enterrait des graines d’arbres au hasard de ses chemins, et, après des années, des paysages entiers étaient de nouveau couverts de forêts. Cette fable de l’action de l’Homme dans la durée est évocatrice et inspirante. En 2006, le programme des Nations Unies pour le développement lançait la Campagne pour planter un milliard d’arbres qui à ce jour revendique plus de 15 milliards d’arbres plantés.
Aujourd’hui l’enjeu de la forêt est associé à celui des changements climatiques. Planter des arbres aide sans nul doute à lutter contre ces changements. Lorsqu’ils grandissent, les arbres fixent le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre. Sans les forêts mondiales, le réchauffement de la planète serait deux fois plus rapide. L’accumulation de carbone concerne non seulement les arbres, mais aussi les sols, qui séquestrent près de la moitié du carbone d’un écosystème forestier. Seulement, la captation du carbone par les forêts ne suffit pas, à elle seule, à endiguer le changement climatique. De plus, dans les années à venir, ces changements pourraient avoir un effet adverse sur les forêts.

Les invasions biologiques de ces dernières décennies en Europe montrent que leur contrôle a posteriori est souvent impossible et que les discours d’éradication sont des leurres. Parmi ces invasions, celle du frelon asiatique est des plus spectaculaires. Aussi appelé frelon à pattes jaunes, Vespa velutina fait partie de la famille des Vespidae qui regroupe plus de 5 000 espèces (guêpes et frelons) qui peuvent être sociales ou solitaires. Les stades juvéniles des frelons sont principalement carnivores ; aussi les adultes sont bien connus pour la prédation qu’ils exercent sur de nombreux insectes afin de nourrir leurs larves, affectant ainsi l’entomofaune1. À ce titre, Vespa crabro, le frelon européen, est reconnu comme un insecte auxiliaire efficace en agriculture en consommant par exemple des pucerons.
Vespa velutina, quant à lui, est entré en France en 2004 dans le sud-ouest, près d’Agen (Rortais et al., 20102 ; Monceau et al., 2014), probablement par une cargaison d’articles exotiques. Bien que le premier témoignage sur ces insectes soit venu d’un producteur de bonsaïs (Villemant et al., 2006), la probabilité que le frelon soit entré par des containers d’une chaîne de grands magasins spécialisés dans ces produits nous paraît plus sérieuse. Dès l’année suivante, des apiculteurs locaux commencent à enregistrer la prédation d’abeilles domestiques sur leurs ruches. Très vite, les quelques nids de frelons deviennent plusieurs milliers en Nouvelle Aquitaine. L’expansion se déploie vers l’ouest, le long des réseaux hydriques, aboutissant à de très fortes populations.
Des scientifiques ont cherché à identifier la provenance des populations envahissantes (Arca et al., 2015) grâce à un travail de génétique. Les conclusions de l’étude sont claires : tous les individus collectés en France jusqu’en 2011 proviennent d’une seule fondatrice fécondée par quatre mâles issus de la province du Jiangsu en Chine. Quatorze ans après cette introduction, le nombre de colonies en France ne peut plus être quantifié. En 2018, un peu moins de 3 000 nids ont été détruits en Gironde (source D. Gerguouil, GDSA 33) et 5 000 dans la Manche (J. Constantinidis, destructeur de colonies de ferlons, 55).

À la fin des années 1860, le corps expéditionnaire anglais d’Abyssinie – aujourd’hui Éthiopie – importe de Bombay, capitale de leur colonie des Indes, 8 000 zébus afin de nourrir les troupes coloniales installées dans la corne de l’Afrique (Spinage, 2003). Le bétail s’avère contaminé par l’agent de la peste bovine1, le Rinderpest virus, un virus apparenté à celui de la rougeole. L’introduction du virus fut foudroyante, occasionnant une mortalité de plus de 80 % des ongulés sauvages d’Afrique, notamment dans la plaine du Serengeti, situé en Tanzanie, près du Lac Victoria. Le bétail domestique ne fut pas épargné. Principale ressource des sociétés de pasteurs éleveurs, sa mortalité par la peste bovine occasionna une des plus terribles famines jamais observées au Soudan et en Éthiopie.
L’histoire de l’introduction de la peste bovine en Afrique a ceci d’exemplaire qu’elle s’inscrit dans le cadre des premières grandes mondialisations associées au colonialisme européen, qui facilitèrent les échanges intercontinentaux et les mouvements des humains, des animaux, des végétaux et de leurs parasites et maladies infectieuses. Son étude nous renseigne sur les conséquences des introductions sur la diversité biologique, le fonctionnement des écosystèmes locaux et les effets cascades difficilement prévisibles sur l’économie, le bien-être et la santé des sociétés locales.

Dans un monde globalisé où les humains sont présents sur tous les continents et où les échanges se sont multipliés, les espèces animales et végétales voyagent avec eux. Intentionnellement ou non, des espèces sont introduites dans de nouveaux écosystèmes, parfois très éloignés de leur origine. Si ce phénomène n’est pas récent, la tendance de ces cinquante dernières années est claire : une étude parue dans la revue Nature Communications indique que, depuis le XIXe siècle, plus d’un tiers des introductions se sont déroulées après 1970, soit un rythme d’introduction de 50% supérieur depuis cette date. Et ce rythme accru ne semble pas faiblir (Seebens et al., 2017). Certaines de ces espèces – qualifiées d’exotiques par leur provenance – s’adaptent à leur nouveau milieu, puis se multiplient et font concurrence aux espèces autochtones. Lorsque l’entrée dans la compétition d’une espèce exotique est établie, elle est alors qualifiée d’ “envahissante” (Colautti & MacIsaac, 2004). Ce phénomène n’a rien d’anodin : ces espèces exotiques envahissantes seraient la 4e cause de perte de biodiversité dans le monde, avec des effets comparables à ceux liés à l’impact de l’Homme sur les habitats naturels. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les forêts de l’hémisphère nord (Murphy & Romanuk, 2014). D’après un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 2015), 354 espèces étaient directement menacées par des espèces exotiques envahissantes en Europe, soit 19 % de l’ensemble des espèces en danger.

La capacité de la population humaine à continuer de croître dépend fortement des services écosystémiques fournis par la nature. Or ceux-ci se dégradent de plus en plus à mesure que le nombre d’individus augmente, ce qui pourrait menacer le bien-être futur de la population humaine, comme cela a déjà été constaté par le passé avec la disparition de plusieurs civilisations humaines.
En construisant un modèle dynamique pour conceptualiser les liens entre la proportion mondiale des habitats naturels et la démographie humaine à travers quatre catégories de services écosystémiques (approvisionnement, réglementation, loisirs culturels et informationnels) les chercheurs ont essayé de déterminer si la trajectoire actuelle du développement humain pouvait conduire à un effondrement similaire.
Ils ont montré en premier lieu qu’il existe généralement un compromis entre la qualité de vie et la taille de la population humaine qui suit quatre scénarios :
Les deux scénarios de déclin sont dictés par des processus antagonistes entre conversion des terres pour l’agriculture et conservation des milieux naturels. Cependant, les deux sont incontestablement négatifs pour le bien-être humain et la nature : la conversion d’un trop grand nombre de terres naturelles en terres exploitées a des conséquences négatives sur les services de régulation et donc sur la population. Au contraire, la conservation de la nature préserve les services de régulation, mais est responsable de famine, si elle ne laisse pas de place à la production agricole.
La seule solution pour un futur souhaitable est de préserver à la fois les services écosystémiques d’approvisionnement et de régulation par un compromis équilibré entre la conservation de la nature et la conversion des terres pour l’agriculture. Ce scénario intermédiaire n’est possible qu’en évitant un emballement de la démographie et en conservant une population relativement « petite » autour de 10 milliards d’individus.

En conséquence, les régimes alimentaires humains qui étaient composés d’une grande variété de plantes et d’animaux ont progressivement été remplacés par des régimes alimentaires composés principalement d’aliments transformés et comprenant un nombre limité de denrées alimentaires (Drewnowski et al., 1997).
Ces nouveaux régimes sont sources de nouvelles maladies, dites maladies métaboliques non transmissibles (obésité, diabètes, hypertension, maladies cardio-vasculaires) et responsables de véritables épidémies au niveau mondial. Il est en effet établi que les régimes de faible qualité nutritionnelle constituent le principal facteur de risque de mauvaise santé dans le monde entier (Abajobir et al., 2017) et sont corrélés à des indicateurs socio-économiques et politiques tels que le revenu, l’éducation, la cohésion et les inégalités sexuelles ou sociales.
Alors qu’on estime à 300 000 les espèces de plantes comestibles disponibles pour l’Homme, plus de la moitié des besoins énergétiques mondiaux sont actuellement satisfaits par quatre cultures : le riz, les pommes de terre, le blé et le maïs.
La biodiversité agricole et sauvage revêt un aspect essentiel pour la bonne nutrition humaine et la durabilité des systèmes alimentaires. Cette biodiversité contribue notamment à la résilience des exploitations agricoles, en particulier face aux aléas tels que les effets du changement climatique, les épidémies et les fluctuations des prix du marché. Dans les pays objets de l’étude, l’apport d’aliments issus de cueillette dans la nature est une source complémentaire de résilience des systèmes alimentaires, en particulier pendant la période où les récoltes sont les moins abondantes.
De manière surprenante, les points chauds (“hot spots”) de biodiversité sauvage et agricole mondiaux coïncident souvent avec des zones de grande pauvreté, de forte dégradation des écosystèmes et de malnutrition. Les populations qui s’y trouvent vivent ainsi souvent dans un environnement dégradé où l’érosion de la biodiversité sauvage et cultivée réduit la diversité alimentaire disponible et donc diminue la qualité des régimes en fonction des saisons, entrainant des problèmes de malnutritions.
En restaurant les écosystèmes et leurs fonctions, la gestion et l’usage durable de la biodiversité alimentaire cultivée et sauvage peut remédier aux carences en micronutriments des populations vulnérables par le soutien de systèmes de production avec une plus grande diversité d’espèces consommables.

Les travaux scientifiques sont clairs. L’érosion de la biodiversité s’accélère. Ce constat, relayé par les récentes évaluations régionales de l’IPBES, souligne combien il est urgent de mettre en œuvre des solutions pour freiner cet effondrement. La science est indispensable pour accompagner ces efforts et favoriser des comportements sociaux et économiques moins dommageables, voire même favorables à la biodiversité. C’est ce dernier message que la Fondation pour la recherche sur la biodiversité veut, avec ses partenaires, faire passer.
Sauvegarder la biodiversité, utiliser plus durablement les ressources naturelles, et en particulier les ressources génétiques, préserver les services que l’Homme retire des écosystèmes, tout cela passe par une meilleure connaissance de l’état et du devenir de la biodiversité, une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes, une meilleure appréhension de l’incidence des activités humaines sur la biodiversité. Sauvegarder la biodiversité, c’est imaginer des pratiques nouvelles pour les acteurs économiques, des mesures innovantes pour les politiques publiques et des comportements repensés pour les citoyens. Là encore la science, les connaissances sur la biodiversité, enrichies par les données des associations naturalistes et de la science citoyenne, la compréhension des relations complexes entre l’Homme et la nature, doivent guider l’action.
Les messages passés par la science sur l’avenir de la biodiversité sont dramatiques, mais, dans le même temps, les études montrent que des politiques volontaristes permettent de sauvegarder des espèces en danger d’extinction et des biotopes ou écosystèmes fragilisés. Les aires marines protégées offrent des opportunités à la fois pour la sauvegarde de la faune marine, mais aussi pour atténuer le changement climatique ; les aires protégées terrestres jouent le même rôle tout en contribuant au bien-être humain. Inciter les entreprises qui perturbent l’environnement à évaluer le coût de cet impact et le bénéfice économique et humain qu’il y aurait à le réduire peut conduire à une diminution significative de la pression qu’exercent les activités industrielles sur la biodiversité. Amener les citoyens à adopter dans leurs vies quotidiennes, dans leurs choix alimentaires, dans leurs pratiques de consommateurs, des comportements plus respectueux de la nature peut générer rapidement des effets très positifs sur la biodiversité locale, mais aussi sur la biodiversité plus lointaine qui subit souvent très directement l’incidence de nos comportements.
Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de la biodiversité, des animaux, des plantes, des micro-organismes, emblématiques ou ordinaires, qui nous entourent et dont on doit favoriser la libre évolution. C’est aussi l’avenir des sociétés humaines qui demain comme hier et aujourd’hui ont besoin de la biodiversité et lui accordent de multiples valeurs.
À l’occasion de ses 10 ans, la FRB invite ses partenaires et le grand public à changer de perspective : alors que nous retirons depuis des millénaires des services incommensurables de la biodiversité, à nous collectivement de lui rendre désormais des services. Notre avenir commun en dépend.
Les partenaires de l’appel :


Cette question est fondamentale, surtout lorsqu’on sait qu’une des difficultés rencontrées pour la conservation des espèces est ce manque de soutien et de mobilisation du public. Par exemple, 20 millions d’américains sont descendus dans la rue pour la première manifestation “Jour de la Terre” en 1970, mais aucune mobilisation similaire n’a été constatée au 21e siècle pour la biodiversité et ce, malgré les messages redondant sur l’extinction.
Une opinion largement répandue, dans le grand public, mais aussi dans la littérature scientifique, est que les efforts de conservation profitent de manière disproportionnée aux espèces charismatiques et que, par conséquent, leur protection est suffisante et acquise. Plusieurs publications scientifiques recommandent par exemple de ne pas concentrer l’effort de conservation sur ces espèces, mais de s’intéresser aussi aux espèces moins connues ou même de privilégier des unités plus intégratives et moins visibles, comme les écosystèmes ou les fonctions écosystémiques dans les politiques de conservation (Keith et al., 2015).
Or, en étudiant 10 des espèces les plus charismatiques, l’étude a mis en évidence qu’elles couraient un risque élevé et imminent d’extinction dans la nature. Il apparait que le public ignore en réalité la situation de ces animaux, les résultats suggérant que cela pourrait être dû à la perception biaisée de leur abondance, émanant d’un décalage entre leur profusion dans notre culture et leur profusion réelle dans la nature. En utilisant librement l’image d’espèces rares et menacées pour la commercialisation de leurs produits, de nombreuses entreprises participent à cette perception biaisée. Les chercheurs émettent l’hypothèse que cette perception biaisée nuit involontairement aux efforts de conservation, d’une part parce que le public ignore que les animaux qu’il préfère font face à un danger d’extinction imminente et qu’il n’en perçoit donc pas le besoin urgent de conservation et que, par ailleurs, l’existence dans l’esprit du public de populations virtuelles renforce la perception que les populations réelles ne sont pas menacées. Cette sorte de compétition entre populations virtuelles et réelles, paradoxalement, diminue les efforts de conservation nécessaires et par conséquent accentue le risque d’extinction de ces espèces.
Cette situation devrait durer tant que cette utilisation ne sera pas accompagnée de campagnes d’informations adéquates sur les menaces auxquelles ces espèces font face. Les auteurs proposent donc de compenser ces effets préjudiciables sur les efforts de conservation en captant une partie des bénéfices associés à l’utilisation commerciale de l’image de ces espèces.

L’île de Bornéo a perdu un tiers de ses forêts primaires1 entre 1973 et 2015 (Gaveau et al. 2016). C’est bien en Indonésie, plus qu’en Amazonie, que la disparition des forêts primaires est la plus rapide, avec 840 000 hectares perdus par an en 2012 (Margono et al. 2014). La plantation industrielle de palmiers à huile (Elaeis guineensis) y constitue l’une des principales causes de déforestation, avec la production de pâte à papier et de bois (Abood et al. 2015). Dans ce pays, premier producteur d’huile de palme avant la Malaisie, la superficie totale plantée en palmiers a été multipliée par sept en une vingtaine d’années (Carlson et al. 2012).
L’huile de palme est l’huile la plus produite dans le monde avec 70 millions de tonnes (USDA 2018). Elle est destinée à l’industrie alimentaire2 et à la production de cosmétiques3, de produits d’entretien, d’agro-carburants et d’électricité. La déforestation associée touche non seulement l’Asie, mais aussi l’Amérique latine et l’Afrique (Varsha et al., 2016). Au niveau mondial, sa production représente 8% de la déforestation imputée aux cultures, après le soja (19%) et le maïs (11%) (Union Européenne, 2013). Si le problème affecte des contrées lointaines, l’Union Européenne est le deuxième importateur et le troisième consommateur d’huile de palme au niveau mondial (USDA, 2018). Et cette consommation intensive n’est pas sans conséquence sur les plantes et les animaux dans les pays producteurs.
“Le déclin le plus sévère des orangs-outans a eu lieu dans des environnements détériorés par la récolte de bois et par les plantations industrielles d’huile de palme.”
Parmi les 193 espèces menacées par la production d’huile de palme, il faut citer l’orang-outan (Pongo pygmaeus), en danger critique d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (Ancrenaz et al., 2016). Une étude internationale s’est tout récemment intéressée à l’influence de l’extraction de ressources naturelles, y compris l’huile de palme, sur ces primates (Voigt et al., 2018). Les auteurs sont allés sur le terrain compter les nids que ces grands singes construisent pour s’abriter la nuit. À l’aide de ces données et de modèles informatiques, ils ont estimé à 100 000 le nombre d’orangs-outans tués entre 1999 et 2015. Si la cause principale du déclin des primates est la chasse illégale, la moitié des orangs-outans de l’île de Bornéo se trouvait en 2015 dans des habitats dégradés par la récolte de bois, les plantations industrielles et la déforestation (Voigt et al., 2018). Le déclin le plus sévère a eu lieu dans ces environnements détériorés. Mais est-ce là la seule espèce victime de l’huile de palme ? Qu’en est-il de l’impact sur la biodiversité de façon plus générale ?
“Dans les plantations de palmiers à huile, l’abondance des chauves-souris insectivores diminue, faute de proies, et les oiseaux “spécialistes” disparaissent.”
Des chercheurs ont compilé et analysé 25 articles scientifiques consacrés aux conséquences de la production d’huile de palme sur la biodiversité. D’après leurs résultats, les plantations de palmiers à huile abritent, sans surprise, un nombre d’espèces (richesse spécifique) inférieur à celui de forêts primaires et secondaires (Savilaakso et al., 2014). Certaines espèces voient leur abondance diminuer, comme la plupart des chauves-souris insectivores, faute de proies. Les plantations défavorisent également les espèces d’oiseaux les moins répandues et les plus exigeantes en termes de conditions environnementales et de ressources (oiseaux dits spécialistes). Cette disparition des oiseaux spécialistes dans les plantations s’expliquerait par une végétation au sol réduite par rapport aux forêts. En outre, les conditions plus chaudes et sèches qui règnent dans ces plantations nuisent à certaines espèces de fourmis, de coléoptères et d’abeilles. D’où un impact très probable sur les services écosystémiques tels que la pollinisation, le contrôle des ravageurs de culture et le fonctionnement des sols (Savilaakso et al., 2014).
Un mode de gestion adapté pourrait réduire ces conséquences néfastes sur la biodiversité. En effet, des études ont démontré que le nombre d’espèces d’oiseaux était supérieur dans les plantations des petits producteurs, en comparaison avec celles des industriels (Azhar et al., 2011, dans Savilaakso et al., 2014). La recherche devrait aussi se pencher sur l’effet des standards de certification durable tels que RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). En effet, ce dernier, qui rassemble depuis 2004 des entreprises et des ONG, fait l’objet de vives critiques, portant sur des principes et critères trop peu contraignants qui favoriseraient les industriels au détriment des petits producteurs, des sanctions trop peu dissuasives et pas assez appliquées en cas de non respect, ainsi que des problèmes de traçabilité (FIAN/CNCD, 2018). Cela explique en partie des initiatives de boycott, parmi les consommateurs, de tout produit contenant de l’huile de palme, labellisée ou non.
“Les huiles de coco et de coprah sont elles aussi produites dans les pays tropicaux et prennent potentiellement la place de forêts.”
Cependant, les alternatives les plus fréquentes à l’huile de palme ne sont pas non plus sans incidence sur la biodiversité. Dans les cosmétiques, les huiles de coco et de coprah (chair de la noix de coco) sont elles aussi produites dans les pays tropicaux et prennent potentiellement la place de forêts. Dans l’alimentation, les huiles de colza et de tournesol, certes cultivées en Europe, le sont souvent de façon intensive et nécessitent, comme le souligne un récent rapport de l’UICN, des surfaces plus vastes pour une production équivalente (Meijaard et al. 2018). Alors qu’il est parfois compliqué de modifier les processus industriels (en termes de quantités disponibles ou de caractéristiques physico-chimiques requises), les consommateurs peuvent choisir de diversifier les sources d’huiles dans les produits quotidiens et privilégier certaines huiles, telles que l’olive, la noix, l’amande, l’argan, les pépins de raisins ou les noyaux d’abricot, parfois locales et plus durables. Le label Agriculture biologique de l’Union Européenne reste alors un outil précieux pour se repérer.
_______
1 Les forêts primaires sont relativement préservées des activités humaines et concentrent une biodiversité particulièrement riche. Les forêts secondaires, en revanche, ont généralement repoussé après la destruction d’une forêt primaire. Forêts primaires et secondaires sont détruites pour les plantations.
2 L’huile de palme alimentaire est parfois mentionnée dans la composition sous les termes imprécis de « graisse végétale » et « huile végétale ».
3 Dans la composition des cosmétiques, l’huile de palme est indiquée par la mention Elaeis guineensis Oil. Ses dérivés les plus courants : Sodium Palmate, Isostearyl Palmitate et Palmitate d’Isopropyl. Les dérivés suivants en sont souvent issus, sauf mention contraire du fabricant : Lauryl Glucoside, Sodium Lauryl Sulfate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Distearate, Isopropyl Myristate, Dodecanol(en gras, partie du nom indiquant le lien possible avec l’huile de palme).
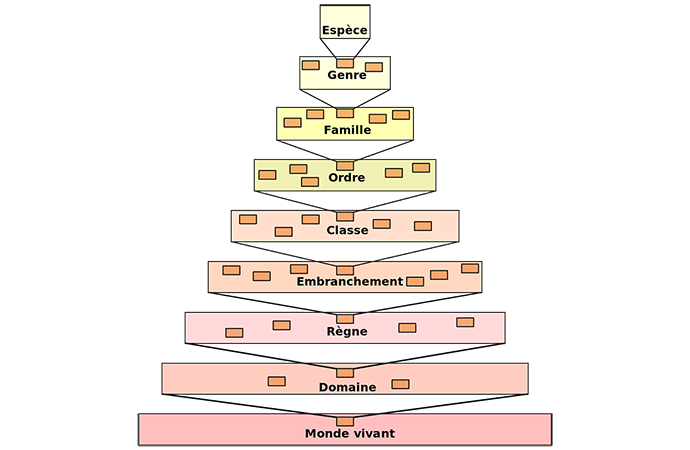
Alors que la protection de la biodiversité s’impose de plus en plus comme un enjeu majeur tant pour les décideurs politiques que pour les acteurs de la société civile (des entreprises aux associations), les discussions autour de la biodiversité se concentrent uniquement sur un petit sous-ensemble d’espèces et la majorité des Eucaryotes reste inconnue ou ignorée. C’est ce qu’on appelle un biais taxonomique et, quoiqu’omniprésent dans la recherche sur la biodiversité, il est peu étudié, peu compris et donc peu ou pas pris en compte dans les conclusions de la recherche alors même qu’il est connu et que ses conséquences peuvent empêcher d’élaborer des conclusions couvrant l’ensemble du vivant et de mettre en place des programmes de protection efficaces.
Ainsi, certains organismes – principalement des plantes et des vertébrés – sont surreprésentés dans divers domaines scientifiques, car ils sont considérés comme écologiquement plus importants que d’autres et de ce fait sont plus susceptibles de lever des fonds. Or, il a été scientifiquement démontré que les espèces rares, petites ou non charismatiques, jouent parfois un rôle essentiel dans les écosystèmes et ne pas les considérer, par manque de connaissances, représente une entrave à la compréhension globale de la biodiversité à l’échelle mondiale, nuit à la mise en place de plans de conservation efficaces et ralentit la découverte de nouveaux produits ou propriétés chez les espèces sauvages.
L’étude de la biodiversité est une tâche ardue et nécessite de déployer une main-d’œuvre considérable pour rassembler et analyser les données sur la biodiversité. Cependant, alors que la biodiversité diminue à un rythme sans précédent, le biais taxonomique représente un fardeau pour les études sur la biodiversité qu’il est urgent de prendre en compte et de dépasser pour avoir une idée plus exacte de la diversité du vivant.

Meubles, papier, emballages cartonnés… Tous ces produits du quotidien proviennent des forêts et ont souvent parcouru des milliers de kilomètres jusqu’à nous. Ainsi, une table peut avoir été fabriquée en Chine à partir de bois français – chêne, hêtre, sapin, épicéa – ou bien de bois tropicaux d’Afrique centrale ou d’Amérique du sud – hévéa, teck, wenge. Le papier, que chaque employé de bureau consomme à hauteur de 70 à 85 kg par an (ADEME), subit une transformation si importante qu’on en oublierait presque qu’il provient pour une large part de fibres de bois. Si les certifications ne renseignent pas les acheteurs sur la provenance ni sur les traitements appliqués, elles ont au moins le mérite – et c’est là leur objectif – de favoriser des pratiques forestières qui nuisent le moins possible à l’environnement.
“Les certifications favorisent des pratiques forestières nuisant le moins possibles à l’environnement”
Les principaux labels, FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) (voir encadré) garantissent que le bois utilisé pour un produit est issu d’une exploitation forestière qui respecte les lois locales, le bien-être des travailleurs et celui des communautés d’habitants, tout en préservant la biodiversité, les services et les valeurs associés aux écosystèmes. Leurs cahiers des charges prévoient de privilégier au maximum les essences locales, de conserver le bois mort au sol et les vieux arbres, ou encore de limiter le recours aux fertilisants. Reste à savoir ce que valent réellement ces certifications, quelle est leur réalité et comment sont réalisés les contrôles de conformité aux cahiers des charges.
Une équipe de recherche a comparé plusieurs standards de certification : celui du FSC, et deux autres reconnus par le PEFC en Amérique du nord, le Sustainable Forestry Management (SFM) et le Sustainable Forestry Initiative (SFI).
Leurs résultats montrent que le FSC propose des critères écologiques et sociaux plus performants, en particulier pour préserver les espèces rares et menacées, interdire ou limiter la conversion de forêts naturelles en plantations, et protéger les peuples autochtones. Le SFM et le SFI nord-américains reconnus par le PEFC s’avèrent quant à eux plus efficaces en termes de productivité et de longévité économique (Clark & Kozar 2011). Cependant, ces résultats sont à considérer avec prudence, puisqu’il ne s’agit que de critères prévus en théorie par chaque standard, et non de leurs effets réels, dont l’étude nécessiterait des données de terrain. De façon générale, les principes et critères du FSC seraient plus contraignants, alors que ceux du PEFC donneraient aux entreprises davantage de flexibilité (Auld, Gulbrandsen & McDermott 2008).
L’adoption de meilleures pratiques forestières est d’autant plus importante que plus de la moitié des espèces sur Terre vivent dans les forêts. Or chaque année, 3,3 millions d’hectares de forêts sont perdus (FAO 2015), et ce, y compris en Europe, notamment dans la taïga russe. Certaines forêts font place à des champs ou à des villes, tandis que d’autres persistent mais sont exploitées, ou bien converties en plantations d’arbres pour produire des meubles, du papier ou encore de l’énergie. Les plantations représentent aujourd’hui 7 % des couverts boisés du monde.
“Il y a en moyenne 29% d’espèces en moins dans les forêts gérées en comparaison à celles non gérées”
Des chercheurs ont étudié l’impact de la gestion des forêts, d’origine ou de plantation, sur leur biodiversité. Ils ont montré que les forêts gérées ont en moyenne une richesse spécifique – nombre d’espèces – de 29 % moins grande que celle des forêts non gérées (Chaudhary et al. 2016). Ainsi, les plantations établies pour la production de bois sont les moins diversifiées avec un nombre d’espèces réduit de 40 % par rapport aux forêts non gérées. Ce qui n’est guère surprenant lorsque l’on sait que la quasi-totalité des plantations sont des monocultures.
Les modes de gestion sont également très importants en terme d’impact sur la biodiversité. Une coupe claire, qui consiste à raser intégralement une zone, diminue le nombre d’espèces présentes en forêt de 22 %. La sélection conventionnelle en forêt tropicale, qui implique de ne couper que les arbres les plus grands et de meilleure qualité, le réduit de 13 %. Au contraire, la gestion par rétention – qui consiste à laisser sur-place quelques groupes d’arbres – ou encore, la sélection en forêt tempérée ou boréale – qui ne coupe que les arbres matures, créant des différences d’âge entre les individus et l’exploitation à faible impact – qui revient à sélectionner chaque arbre à abattre et guider sa chute pour en limiter les dégâts, dans le cadre d’un plan précis – altèrent beaucoup moins la biodiversité (Chaudhary et al. 2016).
“Gérer la forêt, c’est en modifier la structure d’âge des arbres, favoriser certaines essences, changer sa température, sa luminosité, son humidité, … des perturbations qui se répercutent sur tout l’écosystème”
Gérer la forêt, c’est en effet modifier la structure d’âge des arbres, favoriser certaines essences, mais aussi changer sa température, sa luminosité ou encore son humidité. Tous ces paramètres influent sur les êtres vivants qui la peuplent. Les perturbations se répercutent alors sur tout l’écosystème. Ainsi, des coléoptères, champignons, lichens et mousses participent à la décomposition du bois mort et dépendent de sa présence. Les souches et les branches coupées ou cassées forment pour eux des abris importants, mais également des moyens de déplacement ou des sites de nidification et d’alimentation pour d’innombrables oiseaux et mammifères. Dans les forêts boréales de Scandinavie, le retrait des résidus de bois sur le sol a réduit le nombre d’espèces de coléoptères (Gunnarsson et al. 2004) et affecté les espèces « spécialistes », dépendantes de ressources particulières (Nittérus et al. 2007). En effet, ces éléments, de moindre qualité pour l’industrie, sont de plus en plus souvent récoltés afin de produire de l’énergie ou bien des matériaux transformés comme le papier et les panneaux de particules. Pourtant, mieux vaudrait les laisser dans la forêt afin qu’ils jouent leur rôle pour la biodiversité (Bouget et al. 2012).
En attendant de pouvoir déterminer l’impact réel des labels FSC et PEFC sur la biodiversité, ceux-ci permettent tout de même à chacun d’encourager des pratiques plus durables dans ses achats de meubles en bois ou de papier (van Kuijk, Putz & Zagt 2009).

Le Forest Stewardship Council (FSC), association à but non lucratif créée en 1993 par des associations de protection de l’environnement, des commerçants et producteurs de bois et d’autres parties prenantes, offre un cahier des charges international. Initialement conçu pour les forêts tropicales, le label FSC s’applique désormais également aux forêts boréales et tempérées, et il se décline en trois catégories selon les produits : « 100 % issu de forêts bien gérées », « Mixte – papier issu de sources responsables » (mélange de bois issu de forêts FSC et de matériaux recyclés) et « Recyclé – fabriqué à partir de matériaux recyclés ».

Le Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), fondé par des propriétaires forestiers européens en 1999, reconnaît quant à lui un ensemble de standards dont chacun est défini à l’échelle d’un pays.
En 2014, les forêts certifiées PEFC et FSC représentaient respectivement 6,3 % et 4,5 % des forêts du monde. Les forêts ne sont pas contrôlées directement par le FSC ni par le PEFC, mais par des organismes certificateurs indépendants. Les audits sont réalisés, pour chaque exploitation, tous les ans (FSC) ou bien de façon aléatoire (PEFC).

Les Français consomment en moyenne plus de 30 kg par an de « poisson » (au sens commercial ou alimentaire, c’est-à-dire englobant poissons, mollusques et crustacés aquatiques). Dans l’Union Européenne, les ¾ de la consommation sont pêchés tandis qu’¼ est élevé, et à l’échelle mondiale, l’aquaculture assure un peu plus de la moitié de l’approvisionnement, le reste provenant de la pêche en eaux marines et continentales. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO)1 estime qu’1/3 des stocks2 halieutiques sont surexploités, c’est-à-dire soumis à une intensité de capture qui excède leur capacité à se renouveler. Si certaines espèces – telles que le thon rouge – se portent mieux grâce à des mesures de régulation de la pêche, d’autres sont au bord de l’effondrement et se retrouvent pourtant dans nos assiettes. Les travaux de recherche et rapports d’expertise scientifique peuvent cependant guider nos choix.
“Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation, 1/3 des stocks halieutiques sont surexploités.”
Préférer les poissons d’élevage à leurs équivalents sauvages n’est pas toujours une solution, car les seconds sont nécessaires pour nourrir les premiers. Plus précisément, plusieurs espèces de « petits pélagiques » sauvages (anchois, harengs, sardines, etc., aussi appelés « poissons fourrage ») entrent dans la composition de l’aliment des espèces carnassières d’élevage comme le saumon, ou encore les crevettes tropicales. Il faut un à plusieurs kg de poissons fourrage pour produire un kg d’une espèce d’élevage (dans le cas du saumon norvégien, environ 1 kg pour 1 kg). Les petits pélagiques « pèsent » près de 40 % des captures marines mondiales. Outre leur utilisation partagée, voire concurrente, entre fabrication d’aliments pour animaux d’élevage et consommation humaine (Majluf et al. 2017), ils sont aussi des proies indispensables aux prédateurs dans les écosystèmes marins.
Ainsi, la surpêche des petits pélagiques peut entraîner des conséquences dramatiques pour de nombreuses espèces de poissons, de mammifères et d’oiseaux marins comme le thon rouge de l’Atlantique, le manchot de Humboldt, le pétrel géant et la baleine à bosse (Pikitch et al. 2012, 2014). Or, les poissons fourrage, dont la vulnérabilité a été confirmée par des travaux scientifiques dans le cadre du projet Emibios, sont particulièrement affectés par les impacts combinés de la pêche et des changements climatiques (Travers-Trolet et al. 2014, Fu et al. 2018). Il ne faut cependant pas oublier que 30 % de la production aquacole mondiale de poissons d’élevage ne nécessite aucun apport d’aliment incluant du poisson fourrage : il s’agit en majorité de la carpe argentée et de la carpe à grosse tête. Il en est de même pour la culture des mollusques bivalves, principalement les moules, huîtres et palourdes.
Le maquereau et le hareng, ayant autrefois connu la surexploitation, auraient à présent des stocks suffisamment reconstitués pour que l’on puisse en recommander l’achat, d’autant plus que les qualités nutritionnelles des petits pélagiques sont avérées. Chez le poissonnier, plutôt que la dorade rose, classée comme quasi-menacée par l’Union internationale pour la conservation de la nature, il semblerait préférable de choisir la dorade grise ou la dorade royale3. Et plutôt que pour le thon rouge, dont l’état s’est certes amélioré mais reste fragile, mieux vaudrait opter pour la bonite à ventre rayé, également appelée « thon listao ». Les situations de ces espèces peuvent néanmoins basculer si les consommateurs ou les industriels se tournent trop massivement vers elles ! Pour acheter durable, le site www.ethic-ocean.org propose des guides pratiques et documentés, des fiches et une application mobile.
“Le label MSC est décerné aux pêcheries qui s’engagent à assurer une gestion durable des stocks afin d’éviter la surpêche.”
L’aquaculture étant assimilée à une activité agricole — ce qui n’est pas le cas de la pêche, les produits qui en sont issus peuvent être certifiés « Agriculture biologique », ce label ne tenant toutefois pas pleinement compte de leur incidence sur les écosystèmes marins. Concernant les poissons, mollusques et crustacés sauvages, le label MSC4 est décerné aux pêcheries qui s’engagent à assurer une gestion durable des stocks afin d’éviter la surpêche, et à ne pas détériorer les milieux aquatiques, par ailleurs très variés.
Car l’impact sur la ressource en elle-même n’est pas le seul qu’il faut considérer. Les fonds marins abritent les poissons dits « benthiques », à l’image des diverses espèces de raies, de soles et de plies (ou carrelets), ou encore de la baudroie commune, dont la queue est appelée « lotte ». D’autres poissons, dits « démersaux », vivent à proximité du fond, à l’instar du merlu commun5 et des différentes espèces de « gadidés », une famille de poissons dont le plus connu est la morue, ou cabillaud, et qui comprend également le merlan, le haddock et le colin d’Alaska (ce dernier atteignant le plus gros volume de capture parmi les poissons destinés à la consommation humaine).
La capture des poissons et de coquillages benthiques et démersaux nécessite des techniques qui raclent les sédiments marins (dragues et chaluts). La faune, constituée de coraux, d’éponges, de vers et de crustacés, est d’autant plus affectée que les engins pénètrent profondément dans le fond marin (Hiddink et al. 2017). Le temps mis par les écosystèmes pour se remettre des effets du chalutage varie entre près de deux ans et plus de six ans (Hiddink et al. 2017).
“La biodiversité de la petite faune est réduite de moitié dans les sédiments chalutés des grands fonds méditerranéens.”
Dans les sédiments régulièrement chalutés des grands fonds (-200 m et au-delà) du nord-ouest de la mer Méditerranée, la petite faune voit son abondance réduite de 80 % et sa biodiversité réduite de moitié (Pusceddu et al. 2014). Le renouvellement de la matière organique, processus crucial dans les écosystèmes benthiques, y est de 37 % plus lent. Or, le chalutage concerne des habitats toujours plus profonds, où l’impact est encore plus sévère et persistant (Clark et al. 2016). En Manche et au sud de la Mer du Nord, cette pratique affecte en particulier les espèces à durée de vie longue, du fait de leur croissance plus lente et de leur maturité plus tardive (Rijnsdorp et al. 2018). Cependant, pour certains poissons, plusieurs modes de pêche sont possibles. Mieux vaut alors choisir, par exemple, un bar de ligne plutôt qu’un bar de chalut.
Parmi les poissons dont les stocks sont largement surexploités figurent les espèces d’esturgeons (et leurs œufs, le caviar), l’espadon reconnaissable à son long rostre en forme d’épée, et surtout de nombreuses espèces de requins. D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un quart des raies et des requins sont fortement menacés d’extinction (Davidson et al. 2016, Dulvy et al. 2017). Il semble alors paradoxal que, selon la FAO, les débarquements (quantités rapportées au port) de requins et de raies aient décliné de près de 20 % en une décennie, après un pic en 20036.
“D’après l’UICN, un quart des raies et des requins sont fortement menacés d’extinction.”
En fait, si les pêcheurs capturent moins de requins et de raies, c’est bien parce que ces animaux se font plus rares dans les océans, et non parce que des mesures de régulation les y incitent ou obligent. En étudiant la situation dans 126 pays, des chercheurs ont en effet conclu que les débarquements de raies et de requins étaient étroitement liés à la demande des consommateurs, entraînant la pression de pêche sur les ressources, plutôt qu’à une meilleure gestion de leurs stocks. Ainsi, les pays présentant les plus forts déclins, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande, ont des côtes densément peuplées et exportent davantage de viande de raie et de requin (Davidson et al. 2016).
À l’heure où le commerce des produits issus de la mer est mondialisé et où 68 % des denrées alimentaires animales d’origine aquatique de l’Union Européenne sont importées (EUMOFA 2017), favoriser les produits locaux permet de diminuer le coût écologique du transport de l’océan à l’assiette. Et, à l’image des fruits et légumes, ils se consomment aussi de saison, selon leur période de reproduction (au cours de laquelle il faut éviter de les pêcher).
_______
1 Voir la récente édition du rapport biennal de la FAO (SOFIA 2018 : « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture), publié dans les 6 langues de l’ONU et téléchargeable à l’adresse :
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9540FR.
2 Le stock correspond à l’ensemble des individus d’une espèce susceptibles d’être pêchés, dans une zone géographique donnée.
3 Espèce carnivore sauvage, la daurade royale est aussi, avec le loup (ou bar), un produit « phare » de l’aquaculture en Méditerranée.
4 Le Marine stewardship council (https://www.msc.org/fr) est une ONG fondée par une entreprise, Unilever, et par le Fonds mondial pour la nature (WWF), mais indépendante de ces derniers depuis 1999. Aujourd’hui, 315 pêcheries sont certifiées MSC dans le monde, dont une dizaine en France.
5 Les merlus sont aussi appelés « colins », même s’ils sont assez différents du « colin d’Alaska » (gadidé).
6 Les captures de requins et de raies sont souvent déclarées par groupes d’espèces et non par espèce. On connaît des exemples où l’effondrement de l’une ou de plusieurs d’entre elles a été masqué par un report d’effort sur d’autres (Iglésias et al. 2010)

Sur Terre, si l’on considère la masse totale des êtres vivants, sept oiseaux sur dix sont des volailles, et six mammifères sur dix appartiennent à la catégorie du bétail – principalement bovin et porcin (Bar-On Philips & Milo, 2018). Un constat saisissant et révélateur du poids de l’élevage au niveau mondial, en particulier pour la viande1. Tous les ans, plus de 65 milliards d’animaux domestiques sont abattus dans le monde, dont 1 milliard en France. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, l’artificialisation, l’industrialisation et l’intensification ont touché l’ensemble des modes de production des aliments. Ainsi, la production globale de viande a quintuplé dans la deuxième moitié du XXe siècle, atteignant près de 330 millions de tonnes en 2016 (FAO, 2018). Et si la consommation a néanmoins baissé depuis quelques années en France, avec 84 kg par personne et par an (FranceAgriMer, 2018), ce n’est pas le cas dans les pays en transition, qui tendent à rattraper les tonnages consommés dans les pays du nord.
Parmi les alternatives à des régimes riches en produits carnés, outre les régimes de type végétarien (sans viande) et végétalien (sans aliments d’origine animale, y compris lait, œufs et leurs dérivés), le « flexitarisme » consiste à manger moins de viande mais à en privilégier la qualité. En effet, les cycles de production, plus lents dans les pâturages extensifs, ne sont pas suffisants pour que chacun puisse en consommer plus de deux à trois fois par semaine. Du point de vue de la santé, ce rythme correspond aux recommandations nutritionnelles de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine (ANSES2, 2017). Qu’il s’agisse de viande ou d’alternatives végétales, il est également possible de choisir de consommer des produits labellisés (agriculture biologique) ou issus de la vente directe à la ferme.
“L’élevage occupe 70 % de toutes les terres agricoles et 30 % de la surface terrestre globale, et motive une grande partie de la déforestation en Amazonie.”
Ces perspectives de changement du comportement alimentaire sont d’autant plus cruciales que la production de viande à grande échelle accapare les terres. À l’heure où la biodiversité subit la perte et la dégradation des habitats naturels, les animaux domestiques pâturent sur plus d’un quart de la surface des continents (hors glaciers), et un tiers des terres arables sont consacrées à cultiver leur alimentation. Au total, l’élevage occupe 70 % de toutes les terres agricoles et 30 % de la surface terrestre globale, et motive une grande partie de la déforestation dans des régions comme l’Amazonie (Steinfeld et al., 2006). Toutefois, cette activité constitue un moyen de subsistance important dans des territoires impropres à la culture de plantes comestibles pour l’Homme. En l’absence de grands herbivores, il s’agit aussi d’un mode de gestion de l’espace qui entretient des milieux ouverts, notamment en montagne.
“En moyenne, produire 1 kg de viande de bœuf revient à émettre plus de 46 kg d’équivalents CO2 dans l’environnement.”
Le pâturage trop intensif contribue néanmoins à la compaction et à l’érosion du sol, la dégradation des terres menaçant aujourd’hui directement la vie de plus de 3,2 milliards d’êtres humains (IPBES, 2018). En outre, l’élevage représente plus de 14 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (Gerber et al., 2014) et 12 % en France (Peyraud, 2011). Ce secteur d’activité émet notamment du méthane, issu de la fermentation dans l’estomac des animaux lors de leur digestion, et du protoxyde d’azote, issu de la fertilisation des champs de blé, de maïs et de soja destinés à nourrir les animaux. En moyenne, dans le monde, produire 1 kg de viande de bœuf revient à émettre plus de 46 kg d’équivalents CO2 dans l’environnement (Gerber et al., 2014). Un chiffre deux à quatre fois plus bas en France et qui dépend fortement du mode d’élevage (Peyraud, 2011), mais toujours plus élevé pour la viande que pour les céréales, les légumes ou les œufs.
En plus de son rôle dans le changement climatique, l’élevage contribue à la disparition des espèces sauvages par l’accaparement des ressources en eau. D’après l’Institut de l’UNESCO pour l’éducation relative à l’eau, en comptant l’eau bue par les animaux ainsi que le volume utilisé pour cultiver leurs aliments, il faut plus de 15 400 litres pour obtenir un kg de viande bovine, la plus gourmande en eau (Mekonnen & Hoekstra, 2010) [soit cinq à dix fois plus que pour les céréales, les légumes et les œufs], ou encore 550 litres d’eau, hors eau de pluie [soit 2,5 fois plus que pour les céréales] (Peyraud, 2011). Un chiffre plus faible lorsque l’animal se nourrit exclusivement d’herbe sur un terrain non irrigué. La production intensive de viande est également susceptible de générer des pollutions (voir encadré ci-contre).
“Il faut plus de 15 400 litres d’eau pour obtenir un kg de viande bovine, ou 550 litres hors eau de pluie.”
En compilant et en analysant 63 études scientifiques, des chercheurs britanniques ont identifié 14 régimes alimentaires qui réduiraient potentiellement l’occupation des sols et les émissions de gaz à effet de serre de 70 à 80 %, et diminueraient l’usage d’eau de moitié (Aleksandrowicz et al., 2016). Une alimentation végétarienne ou végétalienne serait ainsi bénéfique, de même que la substitution partielle de la viande et du lait par des produits d’origine végétale tels que les légumineuses (haricots, par exemple). Ces dernières ont l’avantage de contenir les acides aminés essentiels complémentaires de ceux renfermés par les céréales et nécessaires à un bon équilibre alimentaire. Or, leur empreinte écologique sur les ressources en eau est six fois plus faible que celle des protéines bovines (Mekonnen & Hoekstra, 2010).
“14 régimes alimentaires, végétarisme, végétalisme et flexitarisme, réduiraient l’occupation des sols et les émissions de gaz à effet de serre de 70 à 80 % et diminueraient l’usage d’eau de moitié.”
Cependant, d’autres chercheurs rappellent qu’évaluer la performance environnementale des régimes est complexe, puisqu’il faut prendre en compte les changements d’usage des terres, le stockage de carbone par le sol, et surtout, la variété des aliments consommés et la diversité des systèmes agricoles (Ridoutt, Hendrie & Noakes, 2017).
Une étude allemande a également démontré que le comportement alimentaire est influencé par les émotions, par les normes sociales et par la dissonance cognitive, c’est-à-dire lorsque les savoirs et les valeurs d’une personne sont en contradiction avec ses actes (Stoll-Kleeman & Schmidt, 2017). L’élevage et la consommation de viande font aussi partie des traditions culturelles dans de nombreux territoires. Les régimes diminuant ou excluant les produits carnés seraient donc plus faciles à adopter dans une société les ayant déjà intégrés dans ses pratiques ou son histoire, ou lorsque l’offre commerciale en alternatives attractives et équilibrées est suffisante.

La production intensive de viande est susceptible de générer des pollutions. Avec les effluents domestiques, les effluents agricoles constituent l’une des causes majeures des proliférations d’algues vertes (ou ulves) sur nos côtes. Les nutriments ingérés par les animaux se retrouvent dans leurs déjections, épandues dans les champs sous forme de fumier ou de lisier. Lorsqu’ils sont en excès, ces nutriments, notamment l’azote et le phosphore, ne sont pas absorbés par les plantes et se retrouvent soit dans les nappes phréatiques, soit dans les rivières, entraînés par les pluies ou par l’érosion des sols. Les rivières enrichissent alors l’océan, favorisant le développement excessif des algues vertes qui viennent ensuite s’échouer sur les plages (Pinay et al., 2017).
Par leur présence excessive, ces algues impactent la biodiversité en causant la disparition de certaines espèces de mollusques, de vers marins et de poissons. En émettant des gaz toxiques, méthane et hydrogène sulfuré, elles nuisent aussi aux activités telles que la conchyliculture et, potentiellement, à la santé humaine. Les écosystèmes ainsi affectés peuvent basculer brutalement dans un état difficilement réversible. La forte densité des cheptels, notamment de porcs et de volailles en Bretagne, accentue le processus (Pinay et al., 2017).
_______
1 L’action ici présentée est focalisée sur la viande d’animaux terrestres et exclut donc les poissons et autres organismes aquatiques, qui font l’objet d’une action distincte.
2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Près des ¾ des Français possédant un terrain jardinent régulièrement (Ifop / MEEDDM, 2010). Or, depuis janvier 20171, les collectivités locales et les établissements publics n’ont plus le droit d’utiliser de pesticides de synthèse pour entretenir les espaces verts dont ils ont la responsabilité2. Ainsi, en attendant l’interdiction de l’usage de ces substances par les jardiniers amateurs en 2019, ces derniers constituent la principale source de pesticides en milieu urbain. Une étude basée sur des données de sciences participatives s’est intéressée aux insectes qui visitent les fleurs des jardins privés. Selon celle-ci, les insecticides et les herbicides ont un impact négatif sur l’abondance des papillons et bourdons : les premiers atteignent directement les pollinisateurs, tandis que les seconds agiraient de façon indirecte en diminuant la disponibilité en ressources – nectar et pollen (Muratet & Fontaine, 2015).
« Les pesticides bio nuisent moins à la biodiversité, mais tout dépend des doses utilisées »
Pour préserver la biodiversité, serait-il alors préférable d’utiliser des pesticides autorisés en agriculture biologique ? Si ces produits nuisent moins à la biodiversité par rapport à leurs équivalents conventionnels, cela dépend toutefois étroitement des doses utilisées. Le cuivre de la bouillie bordelaise, par exemple, s’accumule dans les sols. Si l’on manque encore d’études sur son utilisation dans les jardins des particuliers, des travaux existent dans le cas des territoires agricoles. D’après l’expertise scientifique collective (ESCo) menée par l’Inra et par l’Institut technique de l’agriculture biologique (Inra / Itab, 2018), les sols viticoles européens contiennent jusqu’à 500 mg/kg de cuivre, contre 3 à 100 mg/kg dans les sols naturels. Les plantes cultivées peuvent alors en pâtir, de même que la biodiversité des sols : le cuivre fortement concentré nuit aux communautés de microbes et aux collemboles, des hexapodes proches des insectes.
Alors comment vaincre les ravageurs des cultures sans pesticides ? Le contrôle biologique peut faire partie des solutions, en utilisant des substances naturelles, comme le pyrèthre, insecticide extrait des chrysanthèmes, ou en favorisant des espèces « auxiliaires » qui parasitent ou consomment les ravageurs. Coccinelles, chrysopes, syrphes (mouches à bandes jaunes et noires), micro-guêpes, hérissons, vers nématodes sont d’utiles auxiliaires de culture. Il est possible d’en élever certains, comme les coccinelles, puis de les relâcher, mais sans certitude qu’ils resteront dans un lieu donné. En revanche, adapter le jardin et sa gestion pour qu’il leur soit favorable permet d’inciter les auxiliaires à venir chez soi et à y rester. Reste alors à diversifier les plantes de nos espaces extérieurs, et à former des réseaux de balcons et de jardins entre lesquels les organismes circulent librement.
« Des espèces « auxiliaires », coccinelles, chrysopes, syrphes ou hérissons, parasitent ou consomment les ravageurs »
D’autres solutions fondées sur l’observation des milieux s’avèrent aussi prometteuses. Des chercheurs suédois (Ninkovic et al., 2013) ont illustré la façon dont le comportement des ravageurs varie en présence de leurs prédateurs. Ainsi, les pucerons se laissent tomber au sol pour échapper aux coccinelles. En effet, ces dernières laissent derrière elles une trace chimique, telle une odeur, que détectent leurs proies. Les scientifiques ont donc placé des pucerons du merisier à grappes (Rhopalosiphum padi, un ravageur de céréales) au centre de boîtes de pétri dont seul un côté avait été mis en contact avec une ou plusieurs coccinelles à sept points (Coccinella septempunctata, l’espèce la plus commune en Europe). Il y avait alors significativement moins de pucerons du côté fréquenté par les coccinelles, un comportement d’évitement plus ou moins fort selon le nombre et le sexe des coccinelles ayant laissé leur odeur dans la boîte. La perspective de ce résultat permettrait d’envisager un jour de traiter les jardins et les cultures avec des odeurs de prédateurs.
Des techniques agricoles innovantes comme la permaculture visent également à cultiver autrement, sans produits de synthèse et sans utilisation de carburants fossiles (Guégan & Leger, 2015). Le concept de permaculture, développé dans les années 1970 par les australiens Mollisson et Holmgren, est issu de l’écologie scientifique et s’applique de façon concrète sur le terrain. Ses méthodes consistent à aménager et à piloter les écosystèmes dans une vision globale du site, de son fonctionnement et de sa dynamique, et ce en accord avec des aspirations sociales, écologiques et économiques. Des outils tels que ceux de la permaculture pourraient être adaptés aux jardins ou espaces verts urbains, afin d’élargir encore le champ des possibles pour jardiner sans pesticides.
_______
1 Plan français Ecophyto II, loi Labbé du 06 février 2014 et article 68 de la loi de transition énergétique.
2 Avec une exception pour certains espaces à contraintes particulières comme les installations électriques.

Que se passe-t-il pour une plante lorsqu’elle se fait marcher dessus ? La question peut sembler triviale, et pourtant elle fait l’objet de recherches scientifiques. Car dans les milieux les plus fragiles, notamment en montagne, toute activité humaine influence les écosystèmes. D’après une analyse qualitative de la littérature scientifique consacrée à l’impact du piétinement sur la végétation montagnarde (Martin & Butler 2017), les plantes les moins résistantes sont les arbustes qui, par leur taille, se retrouvent facilement sous les semelles des promeneurs mais dont la croissance est moins rapide que celle des herbes graminées (Yorks et al. 1997; Hill & Pickering 2009 dans Martin & Butler 2017). En marchant sur les plantes, les randonneurs les cassent, les écrasent et parfois les déracinent. Si certaines repoussent, d’autres meurent. Les plantes piétinées sont, en moyenne, moins hautes, et possèdent des feuilles moins grandes. Leur activité de photosynthèse est fragilisée et, par voie de conséquence, leur production de réserves nutritives également (Pickering & Growcock 2009 dans Martin & Butler 2017). En outre, elles produisent moins de graines, ce qui nuit à leur reproduction et donc, potentiellement, à la survie de leur espèce (Rossi et al. 2006, 2009 dans Martin & Butler 2017).
“La compaction du sol conduit au ruissellement des eaux à la surface, participant à l’érosion”
Si un piétinement modéré peut favoriser certaines plantes en éliminant celles avec lesquelles elles étaient en compétition, en revanche, le nombre total d’espèces observées – appelé richesse spécifique – diminue (Cole 2004). Le piétinement compacte également le sol dont la porosité se trouve réduite. En effet, le sol est à la fois composé de matière, mais aussi de vides appelés « pores », par lesquels l’eau de pluie s’infiltre. La compaction du sol conduit donc au ruissellement des eaux à la surface du sol qui emportent avec elles des particules de sol, participant ainsi à l’érosion. Ce phénomène est accéléré, en milieu montagnard, par la pente (Martin & Butler 2017). Des sols plus compacts sont aussi moins favorables à la germination et à la croissance de certaines plantes, puisque leurs racines peinent à circuler pour trouver des nutriments (Alessa & Earnhart 2000 dans Cole 2004). Par contre, ils en favorisent d’autres comme le rumex, la renoncule rampante, le pissenlit ou le chardon des champs (Ducerf 2013).
“La prévalence des maladies atteignant les coraux de Koh Tao est trois fois plus élevée dans les récifs régulièrement explorés par les touristes”
Dans l’eau aussi, les voyageurs causent des dégâts en s’éloignant des sentiers sous-marins ou en fréquentant des écosystèmes fragiles sans contrôle. La plongée sous-marine ainsi que le snorkeling ou randonnée palmée peuvent nuire aux récifs coralliens. Si les effets directement destructeurs de ces activités sont largement documentés par les scientifiques au moins depuis les années 1980, des travaux plus récents s’intéressent à des impacts indirects et moins évidents. Ainsi, des chercheurs australiens (Lamb et al. 2014) ont montré que la prévalence des maladies atteignant les coraux de l’île thaïlandaise de Koh Tao était trois fois plus élevée dans les récifs régulièrement explorés par les touristes que dans les récifs moins exposés. Et ce, en particulier pour une affection appelée SEB (skeletal eroding band), à laquelle les coraux abîmés sont plus vulnérables lorsqu’ils se trouvent dans des zones où la fréquentation est forte. Pour les auteurs, cela indique l’existence de facteurs de stress additionnels, causés par la randonnée palmée et la plongée, qui facilitent la progression de cette maladie. Limiter le nombre de visiteurs autorisés dans les espaces les plus sensibles s’avère donc parfois nécessaire. Pour préserver la biodiversité, tout particulièrement dans les aires protégées, mieux vaut rester sur les « sentiers battus », qu’ils soient terrestres ou marins.

« Je compte les papillons. C’est un peu comme une chasse au trophée, alors moins j’utilise d’insecticides, plus j’ai de chances d’en voir ». Ce témoignage provient d’une enseignante francilienne impliquée dans l’Opération papillons, un programme de sciences participatives lancé en 2006 par le Muséum national d’Histoire naturelle et l’association Noé dans le cadre de Vigie-Nature et qui a déjà rassemblé plus de 10 000 bénévoles. De tels programmes servent aux chercheurs en écologie à analyser un grand nombre de données recueillies selon des protocoles standards, et donnent lieu à des travaux scientifiques. Par exemple, l’Opération papillons a permis d’étudier les effets de l’urbanisation, de l’utilisation de pesticides dans les jardins privés et de l’aménagement du paysage sur les populations de lépidoptères (Muratet & Fontaine 2015). Mais leur point fort réside ailleurs : mieux connaître la biodiversité pourrait conduire à la protéger davantage.
“Un cercle vertueux : Plus les observateurs identifient les papillons, plus ils y font attention, et mieux ils les reconnaissent”
Selon une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Cosquer et al. 2012), 85 % des observateurs de papillons interrogés disent avoir appliqué des pratiques de jardinage bénéfiques aux lépidoptères, comme la plantation d’espèces de fleurs nourricières, la réduction du recours aux pesticides et de la fréquence de la tonte, ou encore la création de friches. Si les citoyens impliqués dans les suivis préservent les organismes qu’ils répertorient, cela a pour effet collatéral de biaiser les données. Cependant, ce biais peut-être pris en compte afin de garantir la rigueur scientifique. Si la plupart des contributeurs n’avaient aucune connaissance des papillons avant de commencer à les compter, leur participation à l’Opération leur a permis d’en acquérir et de devenir plus attentifs à leur environnement. Ils ont également pris conscience de l’appartenance de ces insectes à tout un écosystème, riche et dynamique. En outre, plus les observateurs sont capables d’identifier les papillons, plus ils y font attention, et plus ils parviennent à les reconnaître : un véritable cercle vertueux.
Comment tester si la contribution aux sciences participatives améliore les capacités d’observation ? Cette question a fait l’objet d’un article dans la revue Plos One (Kelling et al. 2015). eBird est un programme de suivi des oiseaux à l’échelle mondiale créé par le Cornell lab of ornithology aux États-Unis, dans lequel les observateurs remplissent et soumettent à une base de données en ligne la liste des oiseaux qu’ils ont repérés et identifiés en un temps et un lieu donnés. Or, à mesure du temps passé à observer les oiseaux sur un lieu, le nombre d’espèces listées par chaque participant augmente, jusqu’à un maximum qui correspond à la totalité des espèces présentes autour de lui. Mais la vitesse de cette accumulation varie, indiquant les compétences de chacun. Conformément à l’hypothèse des chercheurs, les différences entre les participants sont plus fortes dans le cas des oiseaux les plus discrets. Ils ont ainsi mis en évidence qu’une participation accrue à eBird augmentait cette vitesse, et donc les capacités d’observation.
Opération papillons, Observatoire des bourdons, Sauvages de ma rue… autant d’outils pour aider les scientifiques à suivre la biodiversité au cours du temps”
Opération papillons, mais aussi Opération escargots, Observatoire des bourdons, SPIPOLL (suivi photographique des insectes pollinisateurs), Sauvages de ma rue (plantes), Oiseaux des jardins et BioLitt (observatoire du littoral) constituent autant d’outils pour aider les scientifiques à comprendre et surtout à suivre la biodiversité au cours du temps, tout en transformant notre regard sur celle-ci. De nouveaux programmes de sciences participatives utilisent même des applications sur smartphone, à l’instar de BirdLab du MNHN et de NaturaList de la LPO. S’impliquer dans l’un d’entre eux est un excellent point d’entrée pour mieux comprendre et mieux aimer la biodiversité.

Souvent trop fins ou usés, 70 % des détritus plastiques ne sont pas recyclés (Commission européenne 2017). Une grande part finit alors dans les milieux aquatiques. Empruntant les cours d’eau, ou disséminés à partir de décharges littorales, ils rejoignent les océans et les déchets qui s’y trouvent déjà, tels que les filets de pêche. Des chercheurs ont simulé ce processus pour déterminer l’ampleur de cette contribution (Lebreton et al. 2017). Ainsi, ils estiment que les rivières drainent chaque année dans les océans entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique. Les 20 rivières les plus polluantes constituent deux tiers de cette masse, la plupart d’entre elles se trouvant en Asie (Lebreton et al. 2017).
Dans le monde, la production globale de résines et de fibres plastiques est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 380 millions de tonnes en 2015. Sur cette période, 8,3 milliards de tonnes ont été produites au total, dont les trois quarts sont devenus des déchets (Geyer et al. 2017). Parmi les plastiques les plus couramment utilisés, aucun n’est biodégradable (Geyer et al. 2017). Les emballages en constituent une grande part, et leur recyclage reste à améliorer. Ainsi, on trouve des débris plastiques dans la totalité des principaux bassins océaniques.
“Dans les récifs envahis par les déchets plastiques, le risque de maladie des coraux est multiplié par 20.”
Certaines espèces, telles que les tortues marines, confondent ces déchets avec leurs proies. D’autres ingèrent des organismes eux-mêmes contaminés. Les récifs coralliens sont aussi particulièrement touchés par cette pollution plastique. D’après une équipe internationale dont les résultats sont parus cette année, le plastique favorise la colonisation des récifs par des microbes pathogènes (Lamb et al. 2018). L’étude, qui porte sur 159 récifs d’Asie et du Pacifique, montre que dans les récifs envahis par les déchets plastiques, le risque de maladie des coraux est multiplié par 20, accentuant ainsi la dégradation de cet habitat complexe qui héberge de nombreuses espèces de poissons (Lamb et al. 2018).
Rejetés à la mer, les grands débris de plastique sont soumis aux rayons UV, aux contraintes mécaniques des vagues et aux agressions biologiques qui progressivement les fragmentent en pièces de plus en plus petites (Cózar et al. 2014) : les « microplastiques » (moins de cinq millimètres), puis les « nanoplastiques » de moins d’un micron (millième de millimètre). Ces minuscules débris, formés d’une variété de composés1 et additifs2, agrègent des microorganismes et diverses molécules dont les polluants organiques persistants comme les PCB et certains pesticides. Ils sont facilement ingérés par les animaux marins, affaiblissant leur croissance et leur reproduction (Galloway et al. 2017). Des résultats expérimentaux récemment obtenus par des chercheurs américains (Allen et al. 2017) suggèrent qu’une espèce de corail filtre préférentiellement les particules de plastique non recouvertes d’un film microbien, les auteurs invoquant un effet « phagostimulant » (qui stimule l’alimentation).
“Les microplastiques sont facilement ingérés par les animaux marins, affaiblissant leur croissance et leur reproduction”
Les formes de vie microscopiques des océans réagissent également à la présence de ces déchets. L’expédition Tara Méditerranée, coordonnée par l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer (UPMC-CNRS), a recueilli un grand nombre d’échantillons marins. Dans une étude qui vient de paraître, des chercheurs de l’Observatoire océanologique de Banyuls (UPMC-CNRS) et leurs collègues ont montré, à partir de ces échantillons, que les débris plastiques en mer Méditerranée abritaient des communautés de bactéries différentes de celles qui vivent librement dans l’eau ou accrochées à des particules organiques (Dussud et al. 2018). Ces communautés forment un ensemble appelé « plastisphère ». Certaines bactéries ne peuvent vivre que sur des déchets plastiques et exploitent spécifiquement ce nouvel habitat (Dussud et al. 2018). De tels travaux sont essentiels pour mieux comprendre la façon dont les communautés microbiennes réagissent au plastique en milieu marin.

© Alexandra TER HALLE / IMRCP / CNRS Photothèque
“Microplastique, colonisé par une communauté bactérienne appelée biofilm, observé en microscopie électronique à balayage. L’image est colorisée. Le biofilm qui se développe sur le plastique est visible en couleurs. Les plus gros objets sont des diatomées. Ce débris de plastique a été collecté dans le gyre océanique de l’Atlantique nord, zone où s’accumulent les déchets plastiques flottants, en mai 2014 lors des expéditions 7e Continent. Le biofilm est une communauté bactérienne qui se développe sur les microplastiques flottant en mer, il a été baptisé “plastisphère”.”
_______
1 polyéthylènes (PE), polypropylènes (PP), chlorures de polyvinyle (PVC), polystyrènes (PS, dont expansé, EPS), polyuréthanes (PUR) et polytéréphtalates d’éthylène (PET). Au-delà de leur « durée d’utilité » variable selon l’usage – de relativement brève pour le packaging (PE, PP) à longue pour le bâtiment (PVC) –, ces matériaux deviennent des déchets à « longue durée de vie » omniprésents dans l’environnement en l’absence de recyclage.
2 tels que le bisphénol A, le nonylphénol et les phtalates.

En près de trois décennies, les populations d’insectes volants ont chuté d’environ 80 % en Allemagne. Cette situation probablement très similaire à celle de notre pays a été dévoilée par une étude internationale en 2017 (Hallmann et al. 2017). Si l’agriculture est principalement mise en cause à travers l’usage de pesticides et d’engrais de synthèse, la destruction et la dégradation des habitats de façon plus large figurent en bonne place parmi les facteurs impliqués dans les pertes de biodiversité tant au niveau mondial qu’européen (IPBES 2018). Selon une étude fondée sur des données de sciences participatives (observatoire des papillons des jardins du Muséum national d’Histoire naturelle), l’urbanisation diminue fortement le nombre d’espèces et l’abondance des papillons (Fontaine et al. 2016). Mais à l’échelle locale, nos jardins et balcons pourraient changer la donne.
En effet, les plantes nectarifères et pollinifères produisent respectivement du nectar et du pollen. Aussi dites “mellifères” – car les abeilles domestiques peuvent transformer leur nectar en miel – elles favorisent également d’autres pollinisateurs comme les papillons. Les auteurs de cette étude (Fontaine et al. 2016) ont montré que les espèces de papillons les plus affectées par l’urbanisation étaient aussi les plus sensibles aux pratiques de jardinage. Planter des végétaux riches en nectar peut donc aider ces espèces vulnérables en contrebalançant en partie les effets délétères de l’urbanisation. Centaurées, lavande, ronces, framboisier, valériane, trèfles, lierre et plantes aromatiques forment alors des oasis pour les papillons dans un paysage globalement défavorable. D’autres plantes peuvent même être absolument indispensables lorsque l’espèce de papillons leur est inféodée, comme l’ortie, essentielle à des papillons tels que la petite tortue (Aglais urticae), le vulcain (Vanessa atalanta) ou, dans une moindre mesure, le Robert-le-Diable (Polygonia c-album). En revanche, le buddleia, une espèce exotique envahissante, attire les papillons mais ne leur offre pas autant de ressources alimentaires que les plantes citées précédemment.
“Les fleurs discrètes du lierre regorgent de nectar et de pollen avant l’hiver.”
Si de nombreuses plantes nectarifères et pollinifères exhibent des fleurs colorées ou parfumées telles que les chèvrefeuilles, la lavande, les bleuets et les digitales, d’autres essences parfois décriées recèlent de surprenants bienfaits. Ainsi, le lierre, une plante à la mauvaise réputation, fleurit en automne. Ses fleurs discrètes regorgent de nectar et de pollen avant l’hiver. Deux chercheurs britanniques se sont penchés sur le sujet en 2013 (Garbuzov & Ratnieks 2013). Outre les abeilles domestiques, dont près de 90 % du pollen collecté provenait du lierre, cette plante nourrit aussi une grande diversité de pollinisateurs sauvages. Parmi eux figurent des bourdons, des guêpes, des papillons et surtout des syrphes, ces mouches parfois confondues avec les guêpes dont elles imitent la forme et les bandes noires et brunes. En outre, les oiseaux affectionnent particulièrement les baies du lierre.
D’autres chercheurs britanniques ont mis en évidence la préférence des bourdons pour des espèces végétales méconnues du public, à l’instar de la ballote, ou peu appréciées par les jardiniers, à l’image du lamier blanc – souvent pris à tort pour une ortie et pourtant non urticant (Carvell et al. 2006). D’après leur inventaire, trois quarts des plantes fréquentées par ces insectes sont en déclin au niveau local, notamment les espèces les plus importantes comme le trèfle des prés (Carvell et al. 2006). Si les prairies non semées – qui se régénèrent naturellement – offrent parfois aux bourdons des ressources plus abondantes, celles qui sont entretenues selon un standard environnemental contiennent des plantes qui fleurissent plus tôt dans l’année, essentielles aux reines qui partent fonder leur nid (Lye et al. 2009). Chacun pourrait donc, dans son jardin, agir pour les pollinisateurs en favorisant deux types d’espaces complémentaires : des zones où l’on sème des plantes qui leur sont utiles, et d’autres laissées libres d’évoluer (friches).
“Jardins et balcons forment un corridor écologique pour les graines, oiseaux, arthropodes et petits mammifères.”
En plus des ressources alimentaires qu’elles offrent aux pollinisateurs, les plantes peuvent entrer dans un fonctionnement écologique à l’échelle des paysages. Les parcs urbains constituent par exemple des ensembles d’habitats dans lesquels des espèces animales et végétales vivent. Les jardins et balcons, adjacents ou proches les uns des autres, peuvent aussi former un « corridor » permettant aux graines, oiseaux, arthropodes et petits mammifères de passer d’un ensemble d’habitats à un autre. Le tout forme un réseau connecté, parfois indispensable au bon équilibre écologique de ces milieux fragmentés par les activités humaines. En étudiant les araignées et les coléoptères dans quatre villes franciliennes (Vergnes et al. 2012), des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle ont montré, en particulier pour l’une des familles de coléoptères étudiées, que le nombre d’espèces et l’abondance étaient moins élevés dans les jardins isolés que dans ceux connectés à un corridor. Ils ont ainsi mis en évidence le rôle des corridors écologiques pour maintenir la biodiversité « ordinaire » dans des paysages très fragmentés.
À l’heure où plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, où les campagnes s’uniformisent du fait de l’intensification agricole et où la biodiversité s’effondre, nos espaces verts, jardins, balcons ou terrains privés pourraient devenir des « oasis » de biodiversité (dont l’association Humanité et Biodiversité s’est fait le porte-parole avec les Oasis Nature, rejoignant ainsi l’initiative des Refuges LPO initiée en 1921) qui permettraient à celle-ci de s’adapter, au moins pour partie, aux pressions anthropiques croissantes.

Valérianes (en haut à gauche), centaurées comme le bleuet (en haut au centre), lavandes (en bas à gauche), fleurs de lierre (en bas au centre) et ballote (à droite) attirent les papillons, les abeilles, les bourdons, les syrphes, etc. Avec une diversité de plantes sur les balcons et dans les jardins, chaque pollinisateur y trouve son compte.

Depuis près d’une quinzaine d’années, l’impact des crèmes solaires sur les coraux est dans le viseur des chercheurs. La première étude d’envergure remonte à 2008 (Danovaro et al. 2008). Les scientifiques se sont notamment penchés sur les zooxanthelles, qui vivent en symbiose avec les coraux. Ces petites algues ont pour particularité de tirer leur énergie des rayons du soleil par photosynthèse, et d’apporter aux coraux des nutriments essentiels. Si les algues meurent ou quittent la colonie de corail, cette dernière blanchit et succombe. L’étude, réalisée en laboratoire et in-situ dans différentes mers du monde, conclut que quels que soient le lieu et la concentration testée de crème solaire, cette dernière a systématiquement abouti à un rejet par les coraux de mucus contenant des zooxanthelles, rejet suivi d’un blanchissement complet dans les 96 heures (Danovaro et al. 2008). Un phénomène d’autant plus rapide que la température du milieu était élevée.
“Les larves de coraux exposées à l’oxybenzone s’ossifient de façon anormale et s’enferment dans leur propre squelette.”
En testant séparément différents composants présents dans les crèmes solaires, les auteurs ont montré que certains d’entre eux, des filtres organiques à UV comme le butylparaben et l’oxybenzone, se révélaient particulièrement néfastes, sans toutefois en expliquer le mécanisme précis. Or, selon une étude de Downs et al. (2016), à la lumière, l’oxybenzone détruit directement les zooxanthelles tandis qu’à l’obscurité, les coraux se mettent à les digérer. En outre, lorsque les larves de coraux sont exposées à cette substance, elles s’ossifient de façon anormale et s’enferment alors dans leur propre squelette. De plus, l’oxybenzone induit des lésions dans leur ADN. Les filtres minéraux (oxydes de zinc ou de titane) sous forme de nanoparticules seraient eux aussi toxiques pour la vie aquatique, car ils produisent des molécules appelées ROS (reactive oxygen species) qui détruisent les cellules (Lewicka et al. 2013 dans Wood 2018). Des études sont en cours pour évaluer leur effet sur les récifs coralliens (Tagliati et al. non publié, dans Wood 2018).
Il reste à savoir si les concentrations de crème solaire dans l’eau autour des récifs, probablement plus faibles que celles testées par les chercheurs en 2008, sont suffisantes pour entraîner de tels effets. Des études sont en cours. Cependant, certains blanchissements dans le monde semblent déjà ne pouvoir être expliqués que par la fréquentation des récifs par des touristes (Wood 2018). De prochaines études devraient aussi s’intéresser aux effets de ces produits à l’échelle de récifs coralliens entiers, voire d’écosystèmes, et non seulement aux effets distincts de chaque molécule, mais plutôt à leur « effet cocktail » lorsqu’elles agissent en mélange, comme c’est le cas en milieu naturel. Ces recherches seront cruciales : elles devront permettre de caractériser le risque de diminution de la résilience des coraux spécifiquement dû à ce stress écotoxicologique, sachant que les récifs sont déjà affaiblis par le réchauffement, l’acidification, ou encore par les ravages causés par l’étoile de mer Acanthaster, un redoutable « brouteur » de corail.
“Les récifs sont déjà affaiblis par le réchauffement, l’acidification, ou encore par les ravages causés par l’étoile de mer Acanthaster.”
Les filtres minéraux, lorsqu’ils ne sont pas formulés en nanoparticules, pourraient constituer une option plus favorable aux récifs – ce qui reste à confirmer par la science. Aujourd’hui, des crèmes solaires sont ainsi déclarées spécifiquement sans composants nuisibles aux coraux. Si aucun label n’existe encore pour certifier ces allégations, celles-ci marquent une volonté de certains industriels de prendre en compte l’impact de leurs produits sur la biodiversité. Cette démarche est à saluer.

© Lauric Thiault
Les récifs coralliens n’occupent que 0,1 % de la surface des océans, et représentent pourtant 30 % de la biodiversité marine mondiale. Les filtres contenus dans les crèmes solaires peuvent causer le blanchissement des coraux. Cependant, ce sont bien les changements globaux, avec la hausse des températures des océans, qui menacent le plus les récifs sur notre planète.

En France, près des ¾ de la population consomment des aliments bio au moins une fois par mois (Agence Bio / CSA 2018). Si la motivation principale des acheteurs de produits bio est de “préserver leur santé” (69 % des répondants), la seconde est de “préserver l’environnement” (61 %). Mais l’agriculture biologique répond-elle à ces objectifs ? En 2014, une équipe de recherche (Tuck et al. 2014) a analysé près d’une centaine d’études publiées au cours des trois dernières décennies en comparant des systèmes d’agriculture biologique avec des systèmes agricoles conventionnels. En moyenne, le nombre d’espèces présentes dans le milieu, appelé richesse spécifique, est d’un tiers supérieur en bio par rapport à l’agriculture conventionnelle (Tuck et al. 2014). Il faut toutefois considérer ce résultat avec précaution, du fait de données hétérogènes. En effet, si le nombre d’espèces est toujours plus élevé en bio qu’en agriculture conventionnelle, il varie en fonction du type de cultures. Ainsi, la différence entre bio et conventionnel est plus élevée dans un champ de céréales – où les pesticides sont très fréquents – que dans un verger (Tuck et al. 2014).
Selon cette étude, les plantes présentes dans l’environnement bénéficient davantage de l’agriculture biologique que les oiseaux, les arthropodes et les micro-organismes (Tuck et al. 2014), peut-être en raison d’un usage plus massif d’herbicides dans les cultures conventionnelles. Cependant, d’autres éléments de biodiversité seraient probablement favorisés par l’agriculture biologique, en particulier les oiseaux, dont les pesticides diminuent les ressources alimentaires. De façon plus globale, sur les 38 études consacrées à l’impact de la réduction des engrais, herbicides et autres pesticides dans plusieurs pays européens répertoriées par des chercheurs, 34 ont montré un effet positif sur certains invertébrés, plantes et oiseaux (Dicks et al. 2018).
Si les pratiques de l’agriculture bio s’illustrent par l’interdiction ou la limitation stricte de l’usage d’engrais synthétiques et de pesticides, elles présentent aussi d’autres avantages pour la biodiversité. Les rotations de cultures permettent par exemple de contrôler les ravageurs, tandis que l’usage de compost, d’engrais animal ou végétal enrichit les sols.
“Il serait possible de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture biologique, à condition de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de produits d’origine animale.”
Consommer bio permet donc bien d’agir en faveur de la biodiversité. Mais ce type de consommation pourrait-il se généraliser ? En effet, d’après ses détracteurs, l’agriculture biologique présenterait des rendements insuffisants pour subvenir aux besoins d’une planète à la démographie galopante (Connor 2008). Une idée répandue que réfute une étude publiée en novembre dernier par la revue Nature Communications (Muller et al. 2017). D’après les chercheurs, il serait possible de nourrir plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture biologique, à condition de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de produits d’origine animale. Par ailleurs, les travaux de Vincent Bretagnolle et son équipe sur la zone atelier « Plaine et Val de Sèvre » depuis 1994 démontrent que réduire les apports d’herbicides et d’engrais azotés de 30 à 50 % peut être effectué sans réduction des rendements (Gaba et al. 2016). De même, d’autres chercheurs ont estimé qu’il était possible, dans près de deux tiers des 946 fermes françaises étudiées, de réduire la quantité de pesticides de 42 % sans aucun effet négatif sur la productivité ni sur la rentabilité économique (Lechenet et al. 2017).
Il serait donc possible, en termes de rendement, de se tourner vers le bio. Outre le bénéfice pour la biodiversité, c’est aussi notre santé, voire même nos capacités mentales, que nous protégerions. Le quotient intellectuel (QI) de certaines populations humaines aurait baissé de deux points par décennie, d’après des études danoises et norvégiennes, dont une toute récente (Bratsberg & Rogeberg 2018). Or, une cause plausible d’une telle diminution réside dans l’interférence de certains polluants environnementaux – notamment des pesticides contenus dans les aliments – avec l’action des hormones thyroïdiennes (Bellanger et al. 2015). Ces dernières jouent un rôle crucial dans la myélinisation des nerfs, processus qui accélère la transmission entre les neurones. C’est pourquoi l’exposition à ces substances allonge probablement notre temps de réaction face aux situations. Selon Barbara Demeneix, professeure au Muséum national d’Histoire naturelle, interrogée par France Culture, manger bio constituerait une bonne solution en attendant d’adopter des mesures législatives contre ces polluants. En outre, manger bio préserverait notre système cardio-vasculaire. La proportion de personnes souffrant d’un syndrome métabolique – un ensemble de troubles, dont l’hypertension artérielle, qui augmentent les risques cardio-vasculaires et de diabète de type II – est d’environ 12 % chez ceux qui se nourrissent le plus fréquemment d’aliments bio, contre plus de 20 % chez ceux qui n’en consomment que très peu (Baudry et al. 2017).
En France, à la suite des États généraux de l’alimentation, le gouvernement a annoncé l’attribution d’une enveloppe de 1,1 milliard d’euros sur cinq ans pour financer le programme Ambition bio 2022. Objectif : atteindre 15 % de surface agricole utile cultivée en bio et 20 % de produits labellisés bio en restauration collective publique (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 2018). Des mesures nécessaires pour préserver notre environnement et notre santé.

Derrière chaque label se cache un cahier des charges. AB France et Agriculture biologique européenne ont les mêmes exigences, interdisant l’utilisation des pesticides de synthèse. Ils fixent aussi un pourcentage maximum de 0,9 % d’OGM, et les produits transformés doivent contenir au moins 95 % d’ingrédients certifiés bio. D’autres labels, bio ou écologiques (“écolabels”), vont plus loin, en imposant par exemple une provenance nationale, des pratiques spécifiques favorisant la biodiversité, la fertilité des sols et le bien-être animal ou encore des revenus équitables pour les producteurs. Entre deux produits bio, préférons les denrées locales et de saison.
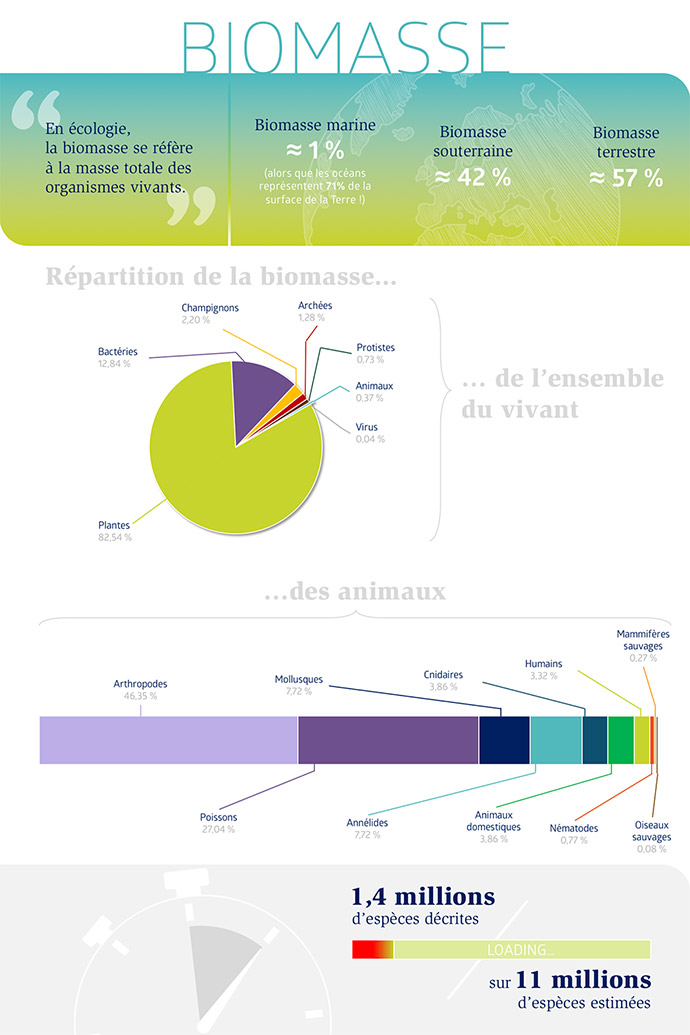
La quantification de l’abondance de chaque composant individuel est essentielle pour décrire un système complexe comme la biosphère (c’est-à-dire les espèces ou les groupes taxonomiques plus larges). Les premiers efforts pour estimer la biomasse mondiale ont principalement porté sur des groupes uniques comme les plantes, les procaryotes1 (Whitman et al., 1998) ou les poissons avec une révision récente de leur biomasse grâce à de nouvelles techniques d’échantillonnage (Irigoien X et al., 2014). Il manque parfois des données sur des groupes importants comme les arthropodes.
Deux tentatives d’une comptabilité globale de tous les composants de la biomasse mondiale ont été publiées, celle de Whittaker et Likens au début des années 1970, qui n’incluait pas la biomasse bactérienne et fongique, et celle de Smil en 2013. Wikipedia fournit également une gamme d’estimations sur divers taxons. Mais aucune de ces études ne donne une vue complète et intégrée et c’est ce qui fait l’originalité du présent travail.
Le progrès des techniques de séquençage permet actuellement la détermination de la composition des communautés naturelles sur la base de l’abondance relative des génomes. L’amélioration de la télédétection autorise également une appréhension de l’environnement à l’échelle mondiale avec une résolution sans précédent. Enfin, les grandes expéditions comme l’expédition Tara Oceans ou les observatoires locaux (comme le Réseau national d’observatoires écologiques en Amérique du Nord) concourent aux efforts d’échantillonnage global et à la connaissance fine des habitats naturels.
La présente analyse est basée sur des centaines d’études portant sur les principaux groupes taxonomiques constituant le vivant. Les chercheurs ont choisi d’utiliser la biomasse terrestre comme mesure de l’abondance des différents groupes d’espèces (les taxons) et de leur importance relative au sein du vivant. Elle résume les connaissances actuelles sur la distribution de la biomasse mondiale.

Certains services essentiels à la vie et au bien-être humain fournis par les écosystèmes comme la production de nourriture, de combustibles, l’épuration ou la mise à disposition de l’eau, la production d’oxygène, la régulation des maladies sont le produit de processus biologiques rendus possibles par la diversité des organismes vivants qui les peuplent. À partir des années 1990, le déclin accéléré des espèces sauvages a suscité un effort concerté pour répondre à la question suivante : comment les changements dans la diversité biologique affectent-ils le fonctionnement des écosystèmes et la production de biens et services ?
Des méta-analyses réalisées sur la base de plus de 500 expériences montrent comment la diversité génétique, spécifique et fonctionnelle, influence le fonctionnement des écosystèmes. Elles ont pu mettre en évidence que des dispositifs expérimentaux incluant plusieurs espèces étaient, en moyenne, 50% plus efficaces et productifs que des systèmes mettant en jeu une seule espèce, et qu’ils étaient plus à même de fournir des biens et services essentiels.
L’idée que la biodiversité est le moteur du fonctionnement des écosystèmes, quoi qu’assez intuitive, n’avait pas encore été objectivée et pouvait dans certains cas rester controversée. Des critiques ont soutenu que les premières expériences réalisées ne contrôlaient pas de manière adéquate les variables confondantes, ce qui a conduit les chercheurs à améliorer leurs protocoles et leurs analyses au fil des années. Nonobstant ces améliorations, certains experts sont restés préoccupés par le fait que les expérimentations avaient été menées à des échelles trop petites, étaient trop limitées dans le temps et trop irréalistes dans leurs conditions pour être significatives dans le monde réel. D’autres ont suggéré que, bien que la biodiversité affecte les processus écosystémiques dans des expériences simplifiées, des effets similaires seraient peu probables dans la nature, ou seraient faibles comparés à la régulation de la productivité et de la stabilité des écosystèmes par les facteurs abiotiques, un processus bien documenté.
Les deux principales questions à résoudre restaient donc de déterminer :
Ces questions étaient restées non résolues en partie parce que l’identification des causes, sans passer par des expérimentations, est notoirement difficile dans le cas de systèmes où les forçages sont complexes, en interaction et souvent non linéaires.
Pour lever ces interrogations, les auteurs présentent une synthèse de 133 estimations du rôle de la biodiversité dans la productivité des écosystèmes provenant de 67 études empiriques ayant mesuré la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes naturels dans 623 464 sites d’échantillonnage dans le monde.
Ces études ont bénéficié de nouvelles avancées analytiques pour quantifier les effets des espèces ou de la diversité fonctionnelle sur le fonctionnement des écosystèmes après contrôle statistique des co-variables environnementales. Les auteurs se sont concentrés sur la biomasse1 et la production à l’échelle des communautés en tant que fonctions écosystémiques, car ce sont les variables de réponse les plus fréquemment mesurées dans les expérimentations passées, et elles sont fondamentalement importantes pour la fourniture de presque tous les biens et services écosystémiques.
La synthèse de données a abordé trois questions :
Premièrement, l’étude montre qu’une biodiversité plus élevée est communément associée à une production plus élevée de biomasse dans les écosystèmes naturels et que cette relation positive a tendance à être statistiquement plus significative lorsque les co-variables environnementales sont contrôlées.
Cette constatation va à l’encontre d’une critique courante des études de terrain reliant la biodiversité à la productivité, qui est que les corrélations entre la richesse spécifique et la biomasse des communautés pourraient n’être qu’un effet collatéral des conditions environnementales qui améliorent simultanément la diversité et la productivité. Si cette hypothèse de covariance était vraie, les effets apparents de la biodiversité sur la productivité devraient s’affaiblir ou disparaître lorsque les facteurs environnementaux sont pris en compte. Or, l’analyse montre le contraire. Parmi les études qui ne tenaient pas compte des co-variables, 69% ont détecté une relation significative entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, tandis que cette proportion atteignait 82% lorsque les co-variables environnementales étaient contrôlées statistiquement. Pour tenir compte de la non-indépendance potentielle des données dans certaines études, les auteurs ont effectué 10 000 tirages au hasard et recalculé la proportion des études montrant des effets de diversité significatifs avec et sans prise en compte des co-variables. Ce test de ré-échantillonnage a confirmé qu’une proportion significativement plus élevée d’effets de diversité était détectée après la prise en compte des co-variables.
Deuxièmement, les auteurs ont constaté que, dans 75% des études, la relation entre la diversité et la production de biomasse était positive lorsqu’on contrôlait les co-variables, la plupart augmentant de façon monotone.
Ces résultats correspondent à des prédictions a priori de la théorie écologique ainsi qu’aux résultats de la plupart des expérimentations. Toujours selon une approche de ré-échantillonnage, la proportion d’études montrant des effets positifs de la diversité était significativement plus élevée parmi les études qui contrôlaient les co-variables environnementales, alors que les effets non significatifs étaient moins nombreux (P = 0,03) et que les effets négatifs sont restés inchangés (P = 0,33). Par conséquent, non seulement les observations reflètent qualitativement les résultats des expérimentations antérieures sur la biodiversité, mais l’accord entre les observations et les expérimentations augmente après la prise en compte des co-variables environnementales.
Après avoir réalisé un important travail afin de vérifier que les données des différentes études étaient comparables, les auteurs ont analysé l’intensité des effets de la biodiversité sur la productivité de la biomasse dans la nature. Malheureusement, dans de nombreux cas, les effets de la richesse spécifique sur la production de biomasse n’ont pas pu être croisées. Après élimination d’un certain nombre d’études les auteurs ont pu toutefois identifier des mesures comparables de l’incidence de la biodiversité pour quatre cas particuliers :
Les effets de la biodiversité dans les écosystèmes naturels se sont révélés plus forts que ceux documentés dans des expérimentations contrôlées pour les quatre comparaisons. Ce résultat résulte pour partie de l’éventail plus large de la diversité présente dans les études d’observation par rapport aux expérimentations.
Étant donné que les écosystèmes naturels présentent souvent des associations plus fortes entre la biodiversité et la production de biomasse que celles documentées dans les expérimentations, les auteurs ont étudié l’importance du rôle de la biodiversité par rapport aux facteurs abiotiques associés au changement global. Ils ont identifié 28 études de terrain qui ont fourni 65 estimations dans lesquelles les auteurs quantifiaient simultanément les effets statistiques de la biodiversité et des variables climatiques (généralement la température) sur la biomasse ou la productivité, et 10 études avec 22 estimations qui quantifiaient simultanément les effets de la biodiversité et la disponibilité des éléments nutritifs (généralement l’azote).
Lorsque les études séparaient statistiquement les effets, la biodiversité avait une incidence supérieure aux variables climatiques dans 51% des estimations de terrain et supérieure à celle des variables relatives aux éléments nutritifs dans 64% des estimations. Ces résultats restent robustes après la prise en compte de la non-indépendance des données (test de ré-échantillonnage). Étant donné que les travaux d’observation couvrent différentes aires latitudinales et longitudinales, la gamme des co-variables abiotiques n’est pas directement comparable dans toutes les études. Cependant, on note que plusieurs études qui vont de l’échelle continentale à l’échelle mondiale ont mis en évidence des effets de la biodiversité comparables ou plus forts que ceux du climat.
Compte tenu du scepticisme relatif à l’idée que la diversité des espèces puisse affecter la productivité des écosystèmes naturels, la force et la cohérence des résultats présentés ici n’étaient pas prévisible. Dans tous les cas, les auteurs ont démontré l’inverse des opinions exprimées pendant longtemps dans la littérature écologique. Les écosystèmes riches en espèces présentaient généralement une biomasse et une productivité plus élevées dans les données d’observation de terrain pour un large éventail de taxons et d’écosystèmes, y compris les plantes des prairies, les arbres, le phytoplancton et le zooplancton des lacs et les poissons marins.
Les associations positives observées entre la biodiversité et la production de biomasse dans la nature étaient :
Ces résultats corroborent ceux d’une récente synthèse de données expérimentales, citée par les auteurs, démontrant que les effets de la biodiversité étaient comparables dans leur ampleur à ceux des principaux facteurs du changement mondial.
Ces résultats permettent d’étendre à un large éventail d’écosystèmes des conclusions similaires basées sur les données d’observation de forêts et de plantes de zones arides.
En effet, toutes les études incluses dans la présente synthèse ont utilisé des approches statistiques conçues b. De plus, toutes les études incluses ici impliquaient des gradients de diversité résultants des processus d’assemblage de communautés naturelles, ce qui permettait de réfuter l’argument ancien selon lequel les effets de diversité sur la productivité sont des artefacts des combinaisons d’espèces aléatoires utilisées dans les expériences.
Comme pour toutes les analyses basées sur des données non expérimentales, on ne peut pas complètement exclure la possibilité que les études examinées aient négligé une ou plusieurs variables environnementales importantes augmentant la diversité et la production en parallèle, générant ainsi une corrélation parasite (non causale) entre elles. Les auteurs considèrent toutefois qu’il est peu probable que les différents écologues impliqués dans toutes ces études n’aient pas pris en compte les principaux moteurs de la production de biomasse dans les écosystèmes qu’ils étudient et connaissent bien.
Une limitation plus réaliste de cette synthèse est que, sauf rares exceptions, les études disponibles n’ont pas abordé le potentiel de rétroaction entre la richesse spécifique, la biomasse et les facteurs environnementaux tels que les ressources. De telles rétroactions pourraient générer des associations plus complexes entre la diversité et la productivité, et l’évaluation de leur fonctionnement dans la nature doit être un objectif pour les recherches futures.
En conclusion, la cohérence des résultats pour plusieurs taxons et écosystèmes au sein de centaines d’expérimentations et leur concordance avec les prévisions théoriques concourent collectivement à conclure que la biodiversité joue un rôle majeur en soutenant la productivité des écosystèmes terrestres.
Au regard de ces différents résultats et en lien avec l’utilisation de solutions fondées sur la nature, il est donc important que la biodiversité soit pleinement prise en compte dans les décisions de gestion et surtout dans les trajectoires de transformation de nos modèles agricoles, comme un facteur majeur de réussite de la transition agro-écologique.
___

Malgré leurs capacités remarquables, les ostréiculteurs français font face, depuis le début du 20e siècle, à d’importantes vagues de mortalité chez les huîtres. Le responsable ? Un virus (ostreid herpes virus 1 OsHV-1) particulièrement virulent évoluant dans l’eau de mer. Pour pallier à ce problème, il a été décidé d’importer dans les années 1970 des huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) : une espèce particulièrement robuste vivant dans l’estran, la zone du littoral agitée par les marées.
Si cette nouvelle espèce s’est révélée plus résistante au virus sous l’eau, la mortalité dans les élevages ostréicoles est restée élevée… alors que faire ?
Un poste est ouvert à l’Ifremer, dans les années 2000, pour mener des recherches et tenter de mieux comprendre à la fois le fonctionnement du virus et les stratégies de défenses mises en place par l’huître. C’est ainsi que la scientifique Charlotte Corporeau, après une thèse en embryologie humaine et 8 années de recherche en biologie médicale, a commencé à s’intéresser à Crassostrea gigas. Rapidement, elle découvre que l’animal survit dans ce milieu difficile notamment en activant et désactivant un mécanisme alternatif de croissance cellulaire qui permet au mollusque de poursuivre son développement aussi bien à marée haute qu’à marée basse. La découverte est double puisque ce même mécanisme est détourné par le virus meurtrier pour son propre développement !
L’”effet Warburg”, c’est ainsi qu’il se nomme, se met en place dans les cellules en situation de stress et leur permet de continuer à se multiplier lorsque les conditions du milieu ne sont plus favorables. Elles n’utilisent alors plus uniquement la respiration pour se diviser, mais également la fermentation, qui nécessite beaucoup plus de glucose, mais moins d’oxygène. Cet effet est par ailleurs bien connu en médecine humaine, puisqu’il s’avère être l’une des huit caractéristiques des cellules cancéreuses. À la différence de l’huître, l’Homme est incapable de désactiver le processus, ce qui entraine la prolifération des cellules “défectueuses”.
Ainsi, l’huître creuse du Pacifique, importée pour la consommation, est aujourd’hui devenue une piste de recherche dans le traitement du cancer ! Comprendre comment l’animal active et désactive l’effet Warburg et quels rôles jouent les facteurs physiques comme la température sont les deux questions auxquelles va désormais tenter de répondre Charlotte Corporeau, grâce au soutien de l’Ifremer et la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Peut-on se passer des énergies fossiles et préserver la biodiversité ? Comme l’ont montré les échanges lors des journées FRB 2017 et de nombreux travaux de re- cherche sur le sujet, la réponse est loin d’être aisée. À l’occasion de la sortie du pro- chain rapport de l’IPBES sur l’état de la biodiversité en Europe et en Asie centrale, la FRB a synthétisé l’une des rares études à avoir compilé et analysé un ensemble de travaux sur la question de production de bois-énergie et de ses impacts poten- tiels sur la biodiversité européenne : Effects of fuelwood harvesting on biodiver- sity — a review focused on the situation in Europe de Bouget, Lassauce et Jonsell, 2012. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie possible parmi d’autres, les auteurs se sont ici placés dans un contexte d’intensification de cette filière.

« Je n’irai jamais vivre dans cette ville. Même si je reste un indito [pauvre indien], chaque matin, quand je vais à ma milpa [champ de maïs et haricots mélangés], j’y suis heureux. Je vois tant d’arbres, de plantes, d’oiseaux et de ruisseaux avec des poissons, et le bleu du ciel… Je me sens bien. Dans la ville de Mexico, les murs sont gris, les routes sont grises, le ciel est gris, même les bruits sont gris. Là-bas, il n’y a pas de plantes, et je me sens triste. ». Voilà la réaction de Gonzalo, chef de famille Amérindien Totonaque de la région subtropicale du Golfe du Mexique, à son retour de Mexico où il a rendu visite à sa fille.

À l’instar des récifs coralliens des pays tropicaux, les récifs coralligènes, dénommés ainsi pour le corail rouge qu’ils abritent, ont tout pour devenir un emblème pour les pays côtiers Méditerranéens. En effet, la riche et belle biodiversité qu’ils abritent présente un intérêt de conservation en soi, mais aussi des avantages pour la pêche et le tourisme. Les connaissances sur ces écosystèmes sont longtemps restées parcellaires, mais se développent aujourd’hui, soulignant la beauté et la vulnérabilité de ces habitats.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.

De nombreux stocks de poissons des mers et océans du globe ont longtemps été – et sont encore – surexploités, notamment en Méditerranée. Cette surexploitation représente un gaspillage des ressources naturelles et aussi une menace pour la biodiversité. Cependant, des travaux de recherche montrent qu’une partie des espèces pêchées vont mieux, grâce aux mesures de régulation de la pêche. C’est le cas pour les thons rouges de Méditerranée et de l’Atlantique Est. Ces bons résultats ont d’ailleurs incité la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a autoriser l’augmentation des quotas de pêche pour cette espèce . La question posée est alors : « le thon rouge peut-il supporter cette augmentation des quotas » ?


La mise en place d’aires marines protégées est l’une des mesures phares de conservation de la biodiversité marine. Il s’agit principalement de définir un espace au sein duquel les activités humaines pourront être restreintes et la lutte contre la pollution renforcée, dans l’objectif de protéger un écosystème particulièrement remarquable ou sensible. Adoptée en 1992, la Convention sur la diversité biologique mentionne comme premier outil de conservation in situ l’établissement d’un « système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique ». Les objectifs d’Aïchi (CDB, 2010) pour la biodiversité prévoient ainsi la conservation d’au moins 10% des zones marines et côtières par des réseaux d’aires protégées. Aujourd’hui, il existe quelques aires marines protégées situées en haute mer – ce vaste espace, au delà des zones économiques exclusives des États côtiers – qui représente 64% des mers et océans et qui constitue un enjeu crucial pour la biodiversité. Un nouveau traité est actuellement en cours de discussion pour introduire des mesures juridiquement contraignantes pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer. En effet, il est impossible de contraindre juridiquement des États à appliquer un accord s’ils n’en sont pas Partie. Comment, dans ces conditions, traiter ce problème et ainsi préserver la biodiversité des écosystèmes fragiles et méconnus qui s’y trouvent ?

Alors que le monde change en termes de climat, de paysages, d’usage de l’eau et de politiques environnementales, les mares sont des « points chauds » de biodiversité. Elles abritent en effet une grande diversité d’espèces et de caractéristiques, ou « traits », biologiques (cycle de vie, physiologie, morphologie, comportement, préférences, etc.). En outre, elles jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services écosystémiques.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.

Des ruisseaux le long des jardins aux fleuves qui traversent les villes, les cours d’eau façonnent nos paysages et forment des habitats essentiels pour la biodiversité aquatique. Les milieux humides et les services qu’ils rendent ont fait l’objet d’une évaluation à l’échelle française (Efese) qui paraîtra au cours du premier trimestre 2018.
Jérémy Devaux, chargé de mission « Eau et milieux aquatiques » au ministère de la Transition écologique et solidaire a coordonné cette évaluation nationale et nous en présente ici, en avant-première, quelques éléments.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.

La déforestation massive est une réalité sur l’ensemble des continents. Longtemps cantonnée aux forêts tropicales humides du bassin de l’Amazone et de l’Asie du Sud Est, elle concerne maintenant le bassin du Congo et même l’Europe, où la taïga russe est touchée. Dans son rapport de 2015 sur l’état de la ressource forestière dans le monde, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que 3,3 millions d’hectares de forêts sont perdus chaque année, soit 6 hectares ou encore 9 terrains de football chaque minute. Les sources non gouvernementales sont encore plus pessimistes, évaluant la perte de surface forestière à 30 millions d’hectares en 2016.

Dans le monde, 64 % des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle. Si les grands projets d’infrastructures et d’urbanisation ainsi que l’intensification de l’agriculture ont conduit à l’assèchement de ces zones, nos sociétés prennent aujourd’hui un peu plus conscience de la nécessité de les préserver. Ainsi, 74 % des Français se sont montrés favorables à l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, situé sur une zone humide. A l’occasion de la journée mondiale des zones humides et en lien avec le prochain rapport de l’Ipbes sur l’état de la biodiversité en Europe, Pierre Caessteker, chargé de mission à l’Agence française pour la biodiversité (AFB), revient sur les effets bénéfiques de ces écosystèmes, essentiels au cycle de l’eau et à la biodiversité.
L’article est consultable dans les ressources ci-dessous.

Au cœur des forêts congolaises et ougandaises, les chimpanzés malades se livrent à un véritable travail de pharmacien ; ils sélectionnent avec minutie des plantes qu’ils utilisent, selon le contexte, pour nettoyer leurs plaies, réguler leur digestion ou encore soulager leurs maux. Un individu infesté par des parasites s’éloigne de façon inhabituelle de son groupe pour mastiquer de l’écorce d’Albizia, un arbre qui ne fait pourtant pas partie de son régime alimentaire habituel. Peu de temps après, il est guéri et ses selles ne présentent plus de trace du parasite.
Les chimpanzés ne se contenteraient pas de se soigner ; ils pourraient également prévenir les maladies. Il leur arrive ainsi de mastiquer les feuilles très amères de Trichilia rubescens, celles-ci n’ayant pourtant aucune valeur nutritive. Ces feuilles contiennent des molécules qui peuvent les protéger du paludisme. Comme les plantes médicinales peuvent s’avérer toxiques lorsqu’elles sont consommées en grande quantité, il faut donc que les chimpanzés dosent la quantité ingérée en fonction de leurs besoins, de leur condition physique et des propriétés de la plante. Dans plus d’un tiers des cas, les plantes qu’ils sélectionnent sont similaires à celles utilisées par les Hommes en médecine traditionnelle dans des contextes semblables.
Ces quelques exemples témoignent de la capacité des chimpanzés à choisir des plantes ou parties de plantes qui contribuent au maintien ou à l’amélioration de leur santé, et à éviter celles qui pourraient empirer leur état. Ces conclusions ont pu être formulées grâce à la mobilisation de plusieurs expertises. Les analyses vétérinaires des fèces couplées à des observations comportementales fournissent ainsi des indications précieuses sur l’état de santé des animaux. En mettant ces données en relation avec celles issues de la récolte et l’analyse botanique, biologique et chimique des plantes sélectionnées par les primates, l’équipe de recherche de Sabrina Krief a mis en évidence la capacité d’automédication chez les grands singes.
La consommation de plantes médicinales se vérifie même dans le cas de chimpanzés orphelins élevés par l’Homme et relâchés en milieu naturel, ce qui amène à s’interroger sur l’origine de cette capacité. L’apprentissage se fait-il par transmission de savoir entre générations ou individus d’un même groupe ? Résulte-t-il d’un phénomène de mimétisme ou d’un apprentissage individuel par essai-erreur ? Quelle est la part innée de cette capacité ? Pour tenter de répondre à ces questions, Sabrina Krief et son équipe ont mené des études comparatives chez plusieurs espèces de grands singes africains, en milieu naturel comme en captivité. Celles-ci confirment l’existence d’essai-erreur individuel mais également l’importance de la transmission sociale dans le choix des substances à activités biologiques chez les chimpanzés.
Cette faculté des chimpanzés à adapter leur alimentation en fonction de leur état de santé est une belle découverte en matière de comportement animal ; elle s’avère également être une source d’espoir en termes de santé humaine. A ce jour, les Hommes n’ont en effet exploré qu’environ 10% des plantes à la fois pour leurs propriétés chimiques et biologiques. L’observation des choix médicinaux des chimpanzés permet de découvrir plus rapidement des plantes aux principes actifs intéressants, qui pourraient servir à la création de nouveaux remèdes. Encore faut-il que ces mêmes hommes ne détruisent pas les forêts tropicales, trésors de biodiversité et habitat des chimpanzés, aujourd’hui menacés de disparition dans un futur proche !

L’équipe a examiné attentivement la littérature scientifique, le financement de la recherche et les articles de presse des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni sur les changements climatiques et la biodiversité entre 1991 et 2016. Elle a constaté que la couverture médiatique du changement climatique est jusqu’à huit fois plus élevée que celle consacrée à la biodiversité, un écart que les différences entre les publications scientifiques sur l’un ou l’autre thème ne peuvent expliquer. Les chercheurs ont noté que la couverture médiatique sur le changement climatique est souvent liée à des événements spécifiques, du type plénière du Giec ou événement climatique exceptionnel, lien que l’on ne retrouve pas pour la couverture médiatique sur la biodiversité.
Les auteurs ont quantifié avec précision leurs observations et en ont dégagé des pistes d’action pour que les chercheurs et leurs services en charge de la communication puissent mieux communiquer les points saillants de leurs travaux au grand public et aux politiques.
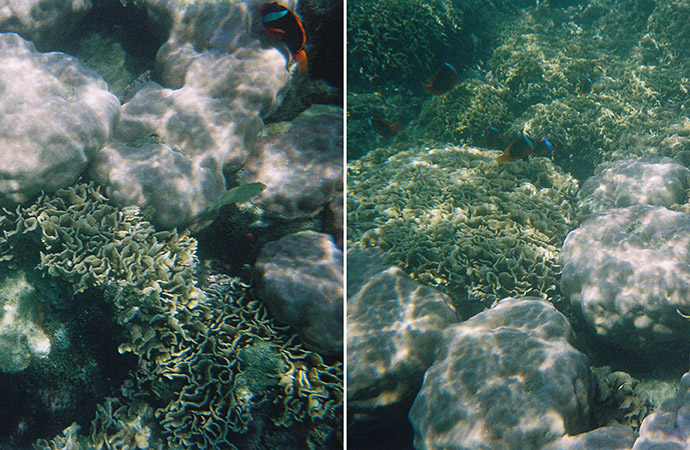
Les coraux peuvent fournir des informations sur les variations de certains paramètres au cours du temps, tels que la température des eaux de surface, la salinité ou encore la présence de pollutions d’origine humaine. Comment de simples échantillons de coraux permettent-ils de recueillir autant d’informations ?
Les coraux massifs du genre Porites sp. sont les plus fréquemment utilisés en paléoclimatologie. Ces organismes, vivant à faible profondeur, sont particulièrement sensibles aux variations physico-chimiques de leur milieu. Leur squelette calcaire, qui peut atteindre plusieurs mètres de diamètre, incorpore tout au long de leur croissance des éléments chimiques contenus dans l’eau de mer environnante. La radiographie de ce squelette permet d’établir la chronologie de leur croissance. Celle-ci se matérialise, à la manière des cernes d‘un arbre, sous la forme d’une alternance saisonnière de bandes sombres et de bandes claires de périodicité annuelle. Ainsi, l’analyse des éléments chimiques suivant l’axe de croissance du corail apporte des informations sur les variations des paramètres environnementaux et des pollutions anthropiques au cours du temps.

Radiographie d’un squelette calcaire de Porites (© IRD-C.E. Lazareth)
L’originalité de l’utilisation des coraux par rapport à d’autres archives (carottes sédimentaires ou de glace, stalagmites, etc.) réside dans leur précision temporelle ; en effet, ils permettent d’obtenir des données à une résolution plus fine, à l’échelle mensuelle. Par ailleurs, les Porites forment des colonies très denses à durée de vie longue. Celles-ci permettent de reconstituer des séries temporelles des variations environnementales qui dépassent parfois les 100ans. Grâce à certains fossiles datant du Trias, il est même possible de retracer les conditions climatiques et chimiques des océans pour des périodes géologiques très anciennes. Cela permet de valider ou de réfuter les résultats des modèles servant à estimer les variations futures du climat.
Une raison de plus pour protéger ces témoins du passé !

Le devenir de l’agriculture et de la biodiversité sont intimement liés. Les impacts de l’agriculture sur la biodiversité sont massifs : transformation des habitats, prélèvements de biomasse et d’eau (plus de 80 % des prélèvements dans ces deux cas), eutrophisation et écotoxicité, émissions de gaz à effet de serre.
Réciproquement, la biodiversité est indispensable à l’agriculture. Elle contribue au maintien de la diversité des ressources génétiques des espèces cultivées et élevées, elle est nécessaire au fonctionnement des agroécosystèmes, à la fertilité des sols et à la pollinisation. Elle offre par ailleurs des perspectives agronomiques majeures, en termes de maintien et d’amélioration du contrôle biologique des ravageurs, d’accroissement de la fertilité des sols, de contribution potentielle à la sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté dans le monde agricole et plus largement rural. En conséquence, si les enjeux liés à la conservation de la biodiversité n’apparaissent directement que dans l’ODD 15, on peut cependant retrouver leur présence indirecte dans près de la moitié des ODD, notamment ceux concernant l’agriculture (ODD 1, 2, 8, 10, 12 et 13).
Face à la diversité des enjeux qui lient agriculture et biodiversité, des réponses contrastées sont proposées. C’est notamment l’alternative entre séparation des espaces agricoles et des territoires dédiés à la biodiversité (land sparing en anglais) ou la réconciliation au sein des milieux ruraux des enjeux de production alimentaire et de conservation de la biodiversité (land sharing en anglais). Dans cet article, les auteurs reviennent brièvement sur ces deux options et examinent les points de controverse qui semblent représentatifs des enjeux de la transition écologique.
Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) se sont imposés comme un des instruments-clé dans les politiques de protection de la nature. Derrière ces trois lettres maintenant bien connues, les PSE abritent néanmoins des concepts différents. L’article propose de distinguer entre la logique de “compensation” qui revient à payer les personnes pour qu’elles changent leur comportement et celle de “récompense” d’un comportement écologique vertueux. La première se rattache à l’efficience économique, autrement dit obtenir le plus de résultats à moindre coût, tandis que la seconde renvoie à des considérations de justice. Ces deux logiques sont intrinsèquement contradictoires. Nombre de PSE rémunèrent notamment les producteurs pour ne pas mener des activités prohibées, ce qui introduit une autre tension, entre la logique d’incitation et le principe d’égalité devant la loi. Les auteurs proposent une approche pour tenter de surmonter ces tensions.

Finalement, c’est une petite abeille tout droit venue de Sumatra qui s’est avérée être le bon remède. Cibdela janthina, dite “la mouche bleue”, a suivi depuis 1997 toute une batterie de tests menés par le Cirad, avant d’être déclarée apte à soigner la biodiversité réunionnaise. Ce petit hyménoptère a la particularité de s’attaquer exclusivement au genre Rubus, dont fait partie la vigne marronne. Suite à son introduction sur l’île en 2007, les résultats ne se sont pas faits attendre ; 700 hectares autrefois colonisés ont aujourd’hui été rendus à la nature ! La vigne marronne ne prospère désormais plus qu’au-delà de 1 200 mètres d’altitude, dans les zones difficilement accessibles pour la mouche bleue.
La lutte biologique contre une population envahissante s’apparente au test d’un nouveau traitement. Elle doit être étudiée, adaptée, spécifique. Parfois c’est une réussite, comme ce fut le cas pour la vigne marronne avec la mouche bleue. Dans d’autres cas, le traitement agit de la manière voulue mais entraîne des effets secondaires désastreux.
Être en mesure de soigner la biodiversité sans jouer au savant fou est une des ambitions du projet Coreids, développé au Cesab et porté par le chercheur en écologie François Massol et Patrice David. Il analyse à la loupe le fonctionnement des écosystèmes ; quelles sont les différentes espèces qui contribuent à leur équilibre ? Comment interagissent-elles ? Quels pourraient être les effets d’un perturbateur comme ce fut le cas avec la vigne marronne ? Tous ces éléments permettront, à terme, de mieux comprendre et anticiper les menaces qui pèsent sur la biodiversité… pour mieux prévenir et moins guérir.

Si vous vous allongez sur un matelas de mousse, les pieds qui pendent depuis une falaise haute de 200 mètres, sous un ciel sub-antarctique gris et venteux, vous entendrez le piétinement de l’albatros hurleur (Diomedea exulans) alors qu’il se prépare à décoller pour son long voyage. Le vent s’engouffre dans ses ailes d’une envergure de 3 mètres de long et élève l’oiseau gigantesque dans les airs, le propulsant pour un nouveau voyage dans les vastes étendues de l’Océan Austral.
Son incroyable voyage dure plusieurs mois pendant lesquels il fait le tour du globe. Pour nous, l’océan austral est un endroit difficile d’accès, dangereux même, mais pour les albatros, les conditions de vent extrêmes sont une aubaine. Leurs corps profilés et leurs longues ailes étroites leur donnent la possibilité d’utiliser le vent comme nul autre oiseau, extrayant l’énergie des vagues pour se maintenir aéroportés. Ce mode de locomotion est si efficace que les oiseaux peuvent voyager pendant des milliers de kilomètres sans battre une seule fois des ailes !
Que se passe-t-il pendant ce long voyage ? Comment l’oiseau navigue-t-il autour du globe ? Où trouve-t-il sa nourriture ?

Grâce à un petit enregistreur de données parfois relié aux satellites et qui est porté par l’oiseau, ces questions trouvent progressivement leurs réponses. L’appareil fournit des emplacements très précis plusieurs fois par jour. A l’aide de ces données combinées avec celles issues d’autres albatros, de phoques et de manchots, les chercheurs du groupe d’analyse et de synthèse « RAATD » pourront identifier quelles zones de l’immense Océan Austral sont particulièrement importantes pour tous ces animaux et, ainsi, mieux guider la conception de nouvelles stratégies de gestion pour protéger l’oiseau, ses descendants, et son écosystème pour de nombreuses générations à venir.

En apparence, le rat taupe nu n’a rien pour plaire. Il n’est ni grand, à peine 33 cm de long, ni imposant, tout juste un petit kilo, ni beau avec sa peau fripée et ses dents saillantes. Par contre, sa physiologie est une énigme que les chercheurs tentent de décrypter depuis plusieurs années. En effet, non seulement il vit 10 fois plus longtemps que ses congénères murins, mais il reste fertile jusqu’à sa mort, résiste aussi aux polluants les plus agressifs et il ne développe jamais de maladies. Récemment, des scientifiques ont aussi démontré qu’il pouvait survivre près de 20 minutes sans oxygène.
L’ambition de la Fondation pour la recherche en physiologie, dont le siège est situé à Woluwe-Saint-Lambert en Belgique, est de créer le premier élevage de rat taupe nu au niveau mondial pour promouvoir les recherches sur les mécanismes de protection développés par cet animal.
En effet, cette petite souris nue qui vit dans les sous-sols de l’Afrique de l’est est un excellent modèle pour étudier les mécanismes du vieillissement, du cancer, des maladies cardiovasculaires ou neurodégératives et des maladies liées à l’âge pour à terme, lutter contre l’ensemble de ces pathologies chez l’Homme.
Ce petit animal est un bon exemple des extraordinaires services que la biodiversité peut rendre à l’humanité. Préserver le potentiel de découvertes scientifiques passe donc par la préservation de la biodiversité en milieu naturel.

Et si la biodiversité nous permettait de lire notre avenir ? C’est le constat de l’équipe de Régis Ceregino, chercheur à l’université de Toulouse qui étudie à la loupe les broméliacées. Nombre de ces plantes à fleur contiennent de petits réservoirs d’eau de pluie qui abritent algues, bactéries, champignons, larves d’invertébrés et petites grenouilles. Véritables versions miniatures des lacs, les broméliacées ont, entre autres avantages, de répondre rapidement au changement. Alors qu’il faut des dizaines voire des centaines d’années à un grand lac pour réagir à une mutation, les broméliacées répondent, quant à elles, en quelques semaines.
Ainsi suffit-il de manipuler leur environnement pour simuler une déforestation ou le changement climatique. De leur réponse, les chercheurs tirent des règles écologiques. Lorsqu’ils simulent le changement climatique où les pluies se font rares, les broméliacées s’assèchent. Les premières espèces à être touchées sont les petits prédateurs qui vont alors relâcher la pression sur leurs proies. Les conséquences vont être nombreuses, y compris pour l’homme. Dans ces systèmes stagnants se trouvent des larves de moustiques qui, en l’absence de prédateur, risquent de pulluler, et potentiellement transmettre des virus. La morale de l’histoire ? La biodiversité est un ensemble d’espèces en interaction. L’élimination d’espèces dans un contexte de changement global peut avoir des conséquences en cascade et un coût (très) élevé pour la société.
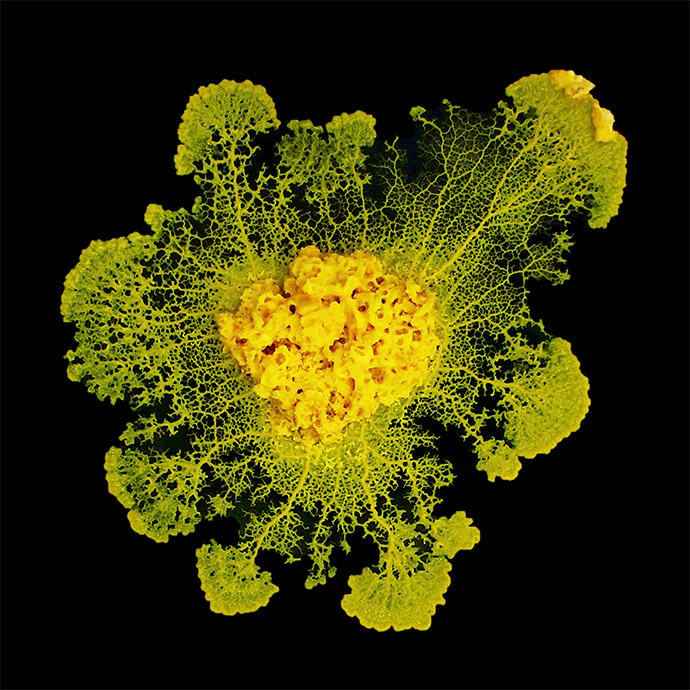
Je vis dans les sous-bois et suis composé d’une seule cellule de 10 mètres carré, je ne suis ni un animal, ni une plante, ni un champignon, ni une bactérie, je résiste au feu, mais je crains la lumière ou la congélation, je cicatrise en deux minutes, j’ai 720 types sexuels et plus de 1000 espèces, je suis dépourvu de système nerveux, mais je sais résoudre des problèmes : qui suis-je ?
Il s’agit d’un amibozoaire du genre Physarum surnommé le blob.
Cet organisme primitif de un milliard d’années présente des caractéristiques extraordinaires y compris en terme d’apprentissage et de mémorisation qui lui permettent de résoudre des problèmes d’accès à la nourriture de façon extrêmement rapide et efficace.
Cet organisme est étudié depuis plusieurs années par Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS (Université Toulouse III – Paul Sabatier) qui cherche à évaluer ses capacités “d’habituation”, une forme d’apprentissage rudimentaire qui semble être très développée chez les blobs.
Un ouvrage grand public est sorti fin avril 2017 aux éditions Equateur-science et présente sur un mode vulgarisé les dernières avancées scientifiques incroyables sur la biologie et les capacités d’adaptation de cet organisme très particulier.
(À se procurer ici ou là)

Les changements environnementaux associés aux activités humaines impactent la biodiversité terrestre. Aujourd’hui, 80 % des espèces de mammifères et d’oiseaux sont menacées par les pertes d’habitats associées à l’agriculture. En “Asie”1, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud tropicale, ces espèces présentent des risques d’extinctions majeurs qui, sans important changement de pratiques, atteindront des niveaux sans précédent au cours des prochaines décennies. Ces menaces – mais aussi les pistes pour les réduire – ont été examinées par l’équipe de David Tilman dans l’article Prédiction des menaces futures sur la biodiversité et pistes pour les réduire paru dans la revue Nature au mois de juin. D’après les auteurs, la combinaison des solutions présentées pourrait annuler entre la moitié et les deux-tiers des risques prévus en 2060 pour ces animaux.
Deux facteurs principaux sont corrélés avec un risque d’extinction des mammifères et les oiseaux : l’accroissement des surfaces cultivées et le revenu par habitant. Ces facteurs sont étroitement liés à la croissance démographique à l’origine de l’augmentation de la demande en protéines animales et par voie de conséquence de la demande en terres agricoles, de la destruction des habitats et de leur fragmentation. La région « Asie », dont le PIB a été multiplié par 7 ces 30 dernières années, voit ainsi le risque d’extinction de ses grands mammifères porté à 62 % au cours des 5 prochaines décennies.
Par ailleurs, entre 2010 et 2060, la population humaine devrait croître de 3,2 milliards d’habitants, dont 1,7 milliards en Afrique sub-saharienne.
Les auteurs ont calculé la demande de terres pour chaque pays en 2060 et le taux de besoin de terres par pays, ceci sous l’hypothèse « business as usual ». Les Land Demand ratio les plus élevés sont attendus en Afrique sub-saharienne. Les pays de cette région devront disposer de 380 à 760 % de terres agricoles supplémentaires en 2060. 710 millions d’ha de terres agricoles seront nécessaires sur la planète dont 430 en Afrique sub-saharienne, une surface équivalent à celles des Etats-Unis.
Pour prévoir les risques en 2060, les auteurs ont réalisé une projection en prenant en compte ces taux de changement d’usage des terres et les prévisions de revenu par habitant envisagés pour 2060 pour les régions les plus à risques, c’est à dire l’Asie, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique du Sud tropicale. Pour plus de la moitié des pays concernés de ces régions, les menaces d’extinction seront sans précédent. Selon les régions, et selon les tailles de mammifères et d’oiseaux les risques d’extinction devraient croître d’une à deux catégories de la liste rouge de l’UICN.
Dans l’objectif de réduire de tels risques, les auteurs distinguent deux grands types de mesures, d’une part la poursuite et l’expansion des pratiques de conservation basées sur les aires protégées et d’autre part des actions qui privilégient des changements de pratiques humaines susceptibles de réduire l’impact de l’homme sur la nature.
Quatre pistes sont présentées par les auteurs :
Accédez à la transcription des éléments essentiels de l’article de David Tilman par Jean-François Silvain directeur de recherche à l’IRD et président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
D. Tilman et al., Future threats to biodiversity and pathways to their prevention. Nature 546, 2017.
—
1. Dans le cadre de cet article, l’Asie comprend l’Asie du sud est, la Chine et l’Inde.